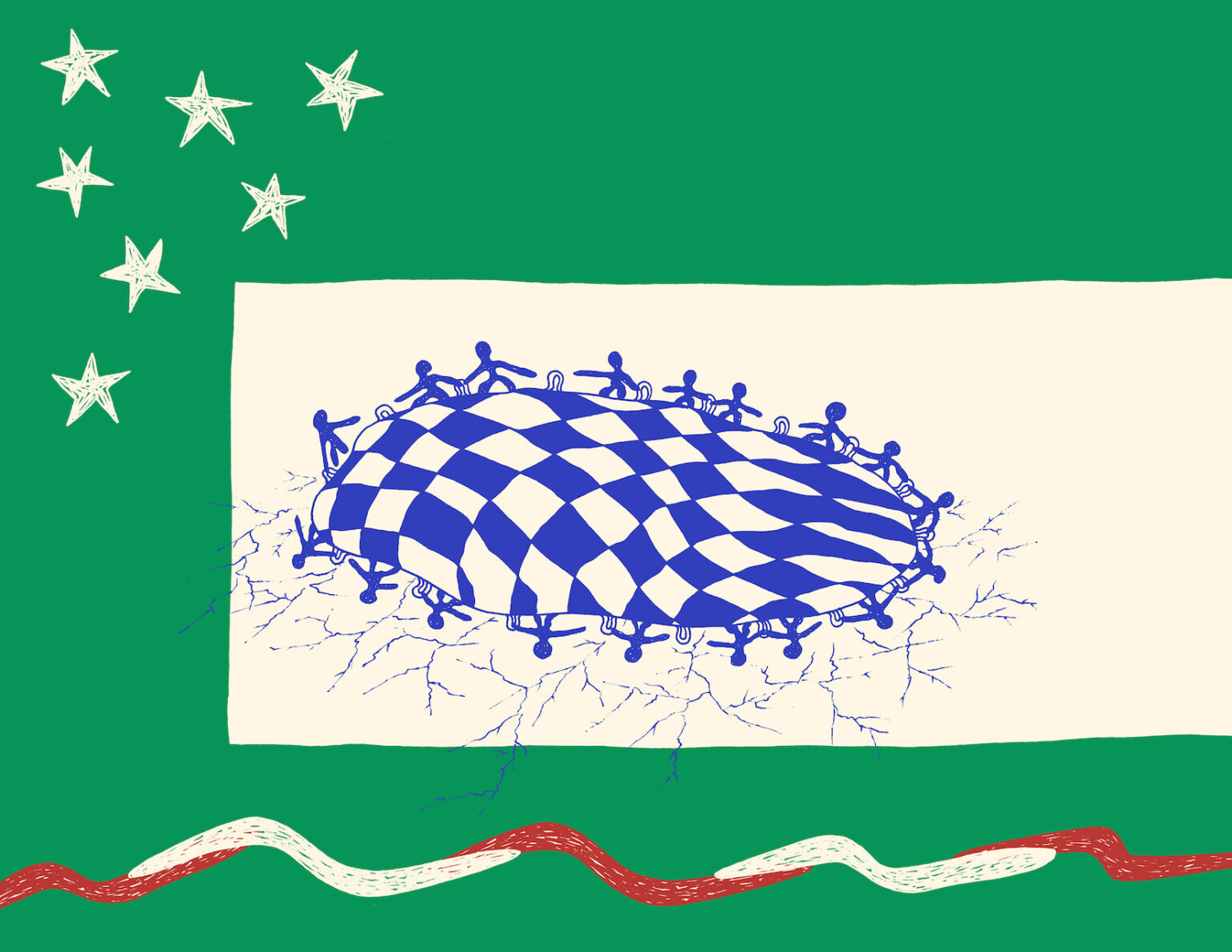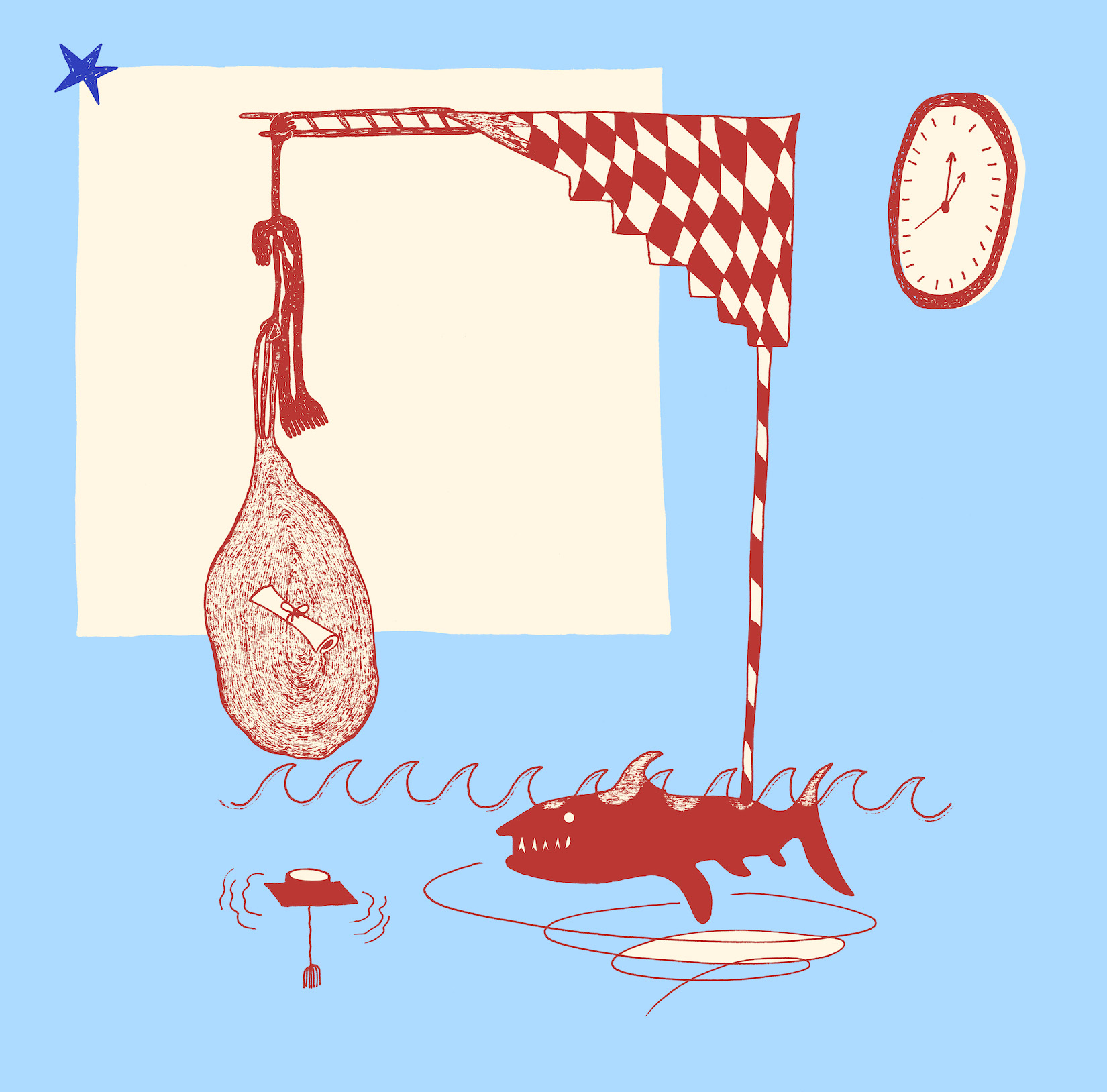13 Avr « Les luttes pour un salaire doivent continuer d’exister » : Discussion avec Silvia Federici et George Caffentzis
Par CAMILLE MARCOUX et ETIENNE SIMARD
Publié le 14 avril 2021
Au mois de mars de l’an 2020, nous nous dirigeons vers New York à la rencontre de Silvia Federici et George Caffentzis. À leur initiative, un panel organisé par le Debt Collective et Free CUNY était prévu au People’s Forum. La discussion publique était programmée pour aborder les mouvements pour le salaire étudiant et des ponts à construire avec la grève de la dette en cours de redéploiement à la grandeur des États-Unis. L’avant-veille de l’événement, l’état de pandémie est déclaré et les lieux de regroupements commencent à fermer. L’événement est aussitôt annulé.
Pour éviter un rendez-vous manqué, nous proposons à nos hôtes de tenir une discussion enregistrée dans un lieu privé. Nous nous retrouvons ainsi dans un salon tout près de Prospect Park, devant du thé et des biscuits, pour discuter d’enjeux qui se sont vite bousculés à l’avant-plan dans l’espace public et les sphères oppositionnelles : suspension des dettes et des loyers, dévalorisation du travail de reproduction sociale et particulièrement celui des femmes et des personnes racisées, mise en place d’un revenu de quarantaine, difficultés d’organisation des luttes en contexte d’isolement, explosion du travail gratuit en contexte de crise économique.
Nous vous présentons des extraits de cette discussion qui a eu lieu quelques heures avant notre retour d’urgence à Montréal et le début d’une période de quarantaine. Mais, d’abord, quelques mots pour présenter la campagne pour la rémunération des stages, point de départ de notre discussion. En 2016, une campagne s’initie pour améliorer les conditions de travail des étudiant·e·s de tous les niveaux et toutes les disciplines. Des demandes concrètes vis-à-vis du gouvernement sont formulées l’année suivante dans quelques universités et cégeps au Québec, au Nouveau-Brunswick, et puis bientôt dans plusieurs institutions d’enseignement de par le monde. Les demandes se multiplient et varient, mais toutes visent pour le moins la rémunération des stages. Dans plusieurs régions du Québec, les mobilisations atteignent leur sommet durant l’année 2018-2019. À l’automne comme à l’hiver, des étudiant·e·s font la grève de leurs stages et/ou de leurs cours.
Pour la première fois, des stagiaires se mettent en grève alors que les stages étaient exclus ou carrément ignorés des mobilisations étudiantes précédentes. Les stages, pour plusieurs militant·e·s de la campagne, représentent la partie visible (ou plus consensuelle) du travail étudiant, et permettent d’amorcer une discussion plus large sur la salarisation de tout le travail étudiant. Les inspirations les plus importantes étaient sans aucun doute les campagnes Wages for Housework et Wages for Students, l’une visant un salaire pour le travail domestique et l’autre un salaire pour le travail étudiant1. – CM et ES
Camille Marcoux : Malgré le consensus qui pouvait entourer la revendication de rémunérer les stages, la rémunération de l’ensemble des activités scolaires et des activités domestiques est quant à elle, hier comme aujourd’hui, sujette à de nombreux débats au sein même des mouvements de gauche. George et Silvia, vous êtes tou·te·s les deux intervenu·e·s à différents moments passés pour partager vos expériences. Lorsque vous étiez de passage à Montréal, vous avez répondu à différentes critiques sur les revendications pour un salaire étudiant qu’avaient reçues les comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE). L’une d’entre elles concernait par exemple le caractère universel de la revendication qui allait à la fois profiter à des étudiant·e·s en technique policière ou en gestion. Une autre posait le caractère aliénant du rapport salarial ou encore sa contribution à la marchandisation des études. Avez-vous reçu des critiques similaires dans le cadre de la campagne Wages for Students?
Silvia Federici : Il faut se rappeler que la campagne pour un salaire étudiant était d’abord une réaction à plusieurs transformations du milieu de l’éducation qui s’opèrent depuis les cinquante dernières années. Traditionnellement, ou du moins depuis la fin du XIXe siècle, la classe ouvrière ne pouvait fréquenter l’université. Elle recevait l’éducation élémentaire suivie d’une formation (technique, école des métiers, «vocational»), et puis c’était tout.
Or, à partir des années 1960, les universités deviennent des usines. Elles représentent un passage obligé, concrétisé par l’obtention d’un diplôme qui n’est plus dorénavant une marque de privilège. La démocratisation de la fréquentation universitaire faisait d’ailleurs partie d’un plan explicite et élaboré du capital: la classe ouvrière recevra une éducation supérieure. D’où l’absurdité de contester la reconnaissance des étudiant·e·s comme des travailleurs et des travailleuses. Cette obstination est mal fondée pour deux raisons. La première est que la grande majorité de la population étudiante est aussi composée de travailleurs et de travailleuses. Même s’il y en a qui ne le sont pas, allons-nous priver tout le reste pour cette raison? Le même débat a eu lieu aux États-Unis durant la campagne de Bernie Sanders pour une assurance maladie universelle, on disait : «des riches pourront aussi en profiter». Mais, on s’en fout! La réalité est que la grande majorité des personnes à l’université fait partie de la classe ouvrière. La deuxième raison est que l’éducation s’inscrit dans le processus du travail «productif», c’est-à-dire dans le but de produire une main-d’œuvre qui se mettra au travail. L’éducation n’est pas un projet d’émancipation de l’esprit, on y va pour pouvoir travailler.
Depuis les années 1950, la population étudiante du secondaire jusqu’à l’université provient de la classe ouvrière. Elle doit suivre une formation préparée pour elle et à sa place, parfois pour occuper des emplois qui ne nécessitent une formation particulière que depuis récemment. On peut penser aux éducatrices dans les garderies publiques. Il n’y a pas si longtemps, le simple fait d’être femme suffisait pour travailler auprès de la petite enfance. On les savait pour la plupart mères. Aujourd’hui, les formations se multiplient et s’allongent, et il est de plus en difficile d’obtenir un emploi sans elles. C’est pourquoi la division entre travail et étude n’a pas lieu d’être.
Etienne Simard : Croyez-vous que l’augmentation incessante des frais de scolarité au Québec comme aux États-Unis confirme votre hypothèse?
SF: Tout à fait! Les luttes pour un salaire ne pourraient être plus d’actualité. Au-delà des études, dans plusieurs cas, il faut débourser de l’argent pour obtenir un emploi. Partout à travers le monde, on peut constater une croissance des situations d’emplois sans salaire. Par exemple, en Grèce, il y a déjà quelques années, des travailleurs et des travailleuses témoignent devoir travailler plusieurs mois voire une année complète sans salaire avant d’espérer recevoir une rémunération. C’est la logique «d’avoir le pied-dans-la-porte»2; d’avoir une longueur d’avance sur ses pair·e·s lorsqu’il y aura embauche d’un·e salarié·e. Cela dit, pour plusieurs, leur travail bénévole n’aboutit pas en un emploi salarié, mais plutôt par leur licenciement.
Le coût du travail, comme le coût de la reproduction, est transféré aux travailleuses et aux travailleurs. Selon moi, les transformations nommées s’intéressent toutes au même processus, au continuum des activités visant à reproduire la main-d’œuvre. L’État providence représente un compromis entre la contribution individuelle et la contribution étatique à la reproduction des individus. L’État contribue au régime de pension, prévoit une assurance maladie, etc. Depuis l’ère du néolibéralisme, toutes ces contributions sont coupées. De ce fait, les coûts de «reproduction» doivent être assumés par les travailleurs et les travailleuses. C’est une façon de contourner les limites aux coupures de salaires. Au lieu de diminuer la rémunération, les coûts de la vie sont augmentés. Un bon exemple est les frais de garderie. Aux États-Unis, beaucoup de parents ne sont pas suffisamment fortunés pour inscrire leur(s) enfant(s) à la garderie. Quelles sont les alternatives dans une telle situation? Souvent, une femme de leur communauté restera à la maison pour s’occuper des enfants de plusieurs familles contre une modique somme d’argent. Toutes ces stratégies se déploient pour un dessein clair, soit que la main-d’œuvre se forme à ses frais.
ES: Un autre exemple de ce transfert de coûts peut s’observer dans l’imposition du télétravail3. Dans la fonction publique québécoise, par exemple, le télétravail devient un aménagement de plus en plus obligatoire. Avec son implantation, l’employeur abandonne la responsabilité d’assurer des espaces de travail ergonomiques et rend difficile l’application des mesures visant à éradiquer le harcèlement en milieu de travail.
SF: Et tu ne connais pas tes collègues! Quand tu travailles à partir de la maison, en ligne, tu es complètement isolé·e, tu es déjà vaincu·e. Il devient facile de négocier les contrats de travail de manière individuelle alors que les tâches et les conditions de chacun·e sont méconnues des autres.
George Caffentzis: Pour vous donner une idée des changements structurels liés à l’éducation et à la revendication pour un salaire étudiant. La revendication d’un salaire pour les études a été élaborée durant les années 1970. Par exemple, lorsque j’ai commencé mon emploi comme enseignant à l’université, je n’avais alors pas dépensé un sou pour mon éducation, de la maternelle au doctorat. Beaucoup de collègues avaient la même expérience que moi. Aujourd’hui, au moment de ma retraite comme enseignant, les étudiant·e·s américain·e·s vont débourser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour obtenir une éducation universitaire. Ainsi, sur une période d’environ 30 ans, l’éducation est passée de la gratuité à des coûts faramineux. C’est un échec majeur.
À l’époque, nous n’avions pas cerné l’importance du débat que nous tentions de poser. Il y avait une division de classe au sein de la gauche, qui se concentrait davantage à contester l’hégémonie étudiante. Beaucoup ne voyaient pas l’intérêt de mettre à l’avant-plan les conditions d’études. C’était même vu comme déraisonnable. On a combattu l’asservissement. Et, notre défaite a été grande, et l’est toujours.
Aujourd’hui, tellement d’énergie doit être consacrée non seulement à l’école, mais aussi au paiement de ses frais que la question devient à nouveau un sujet d’actualité : devrait-on payer pour accéder à une éducation? On l’a notamment vue apparaître dans la campagne de l’investiture démocrate pour la présidentielle de Bernie Sanders. Malheureusement, on présente le scénario de la gratuité comme une utopie, comme une idée farfelue. Mais, il n’y a pas si longtemps, c’était notre réalité.
SF: En Amérique latine, il est encore possible dans plusieurs pays d’accéder à l’université sans frais. Pour bien comprendre le statut de travailleur et de travailleuse des étudiant·e·s, il est important de regarder l’ensemble du travail qui est exigé par les études. C’est ainsi qu’on doit aborder la lutte pour un salaire étudiant. Les étudiant·e·s qui ne travaillent pas représentent de rares cas. La plupart occupent plus d’un emploi, et travaillent un grand nombre d’heures en plus de leur horaire d’école. Ce n’était pas ainsi au moment de mes études alors que les étudiant·e·s mêmes de milieux modestes ne travaillaient pas nécessairement durant leur scolarité. J’ai personnellement commencé à travailler durant mes dernières années d’études pour payer les quelques factures que je commençais à avoir. S’ajoutent à ces obligations les stages, les taxes, les devoirs et le travail à la maison; c’est un horaire extrêmement chargé. Et, ce fardeau est devenu un passage obligé sous la menace d’être sans emploi, ou plutôt sans salaire. Quel stratagème sadique!
GC: Et, sans oublier, disciplinaire! Un plan qui repose en grande partie sur la dette. À la fin de leur étude, les étudiant·e·s auront pour la plupart contracté une dette de plusieurs milliers jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars. Son remboursement pourra représenter le travail d’une vie. À un certain moment, tu commences à craindre de ne pas pouvoir payer tes factures, mais aussi de ne pas être en mesure de rembourser entièrement ta dette. Et puis, tu fais face aux mesures de recouvrement des dettes, une réelle industrie de la peur qui repose sur la discipline. Les techniques employées par les huissiers en témoignent : les menaces, la notification de la dette aux employeurs, les visites à domicile, etc.. On te hante, ça s’apparente à du harcèlement.
ES: Nous avons rencontré un étudiant à l’école de travail social de Silberman, et il nous confiait les difficultés à organiser une grève auprès de ses pairs. Malgré toute la conviction qu’il pouvait avoir ou celle de ses collègues, l’organisation d’une grève représentait un prix cher à payer, c’est-à-dire qu’ils et elles assument presque l’entièreté des frais de scolarité durant leur grève. Au Québec, alors que nous payons une partie des frais et que le reste est assumé par l’État, une grève représente aussi un prix pour le gouvernement. Comment faire pression sur un gouvernement qui ressent peu les conséquences d’une grève?
SF: Il est certain que la grève doit ainsi s’organiser sur un plan plus large, dans une perspective qui dépasse le cadre des études. En ce moment, avec les frais et le fardeau que représentent les études, les étudiant·e·s tentent avec raison de les terminer le plus rapidement possible. Certain·e·s tenteront même de gonfler le nombre de cours entrepris par session. Le climat est toxique et les étudiant·e·s sont malades. Dans une ville comme New York, il faut aussi ajouter le fardeau financier que représente le loyer. Il est extrêmement difficile de trouver un logement abordable à proximité des universités. La question doit se poser: qui a le temps ou les moyens de faire la grève?
Lorsque tu as un travail en plus de l’école, tu n’as pas le temps de faire autre chose; de te rendre à une réunion, de rester à l’école après ton cours. Il se termine, et tu files. Tu vis avec tes parents, et non dans une commune avec tes camarades, tu te rends à ton job et à l’école. Tu as du temps pour rien d’autre.
CM: En ce sens, l’étudiant que nous avons rencontré insistait que le seul moyen de faire quoi que ce soit était de réduire les heures de stage. Personne n’a de temps pour s’organiser. Le premier pas à prendre pour tendre vers une organisation avec ses collègues était donc de réduire le temps de travail de toutes et de tous. Cette stratégie était un des moyens mis de l’avant durant la campagne pour la rémunération des stages. La grève était autant un moyen de pression, qu’un temps libéré du travail pour pouvoir s’organiser. Il était admis dès le départ que beaucoup des collègues ne pourraient pas participer à l’organisation de la campagne sans une réduction de leur temps de travail, donc qu’on les retrouverait après les votes de grève passés. On peut penser à ceux et à celles qui ont plusieurs emplois, qui ont des enfants à la maison; leur participation aux réunions d’organisation ne pourra parfois se réaliser que si celles-ci se déroulent durant les heures d’école ou de stage. D’où l’importance d’utiliser les journées de grève comme un temps pour s’organiser. Pour plusieurs personnes, l’organisation commence à ce moment.
ES: J’ai vu quelque part que vous disiez que l’imposition de frais de scolarité à la CUNY était une stratégie pour désorganiser le mouvement de contestation au sein de l’université. Pourriez-vous nous en dire plus?
GC: Cette période (1974-1976) a été une période décisive pour la City University of New York (CUNY) où j’ai étudié. Avant cela, il n’y avait pas de frais de scolarité. Durant cette période, l’imposition de frais de scolarité, qui mettait fin au droit historique à une éducation universitaire gratuite, était non seulement liée aux luttes étudiantes, elle découlait d’une transformation de la totalité du système capitaliste. Une transformation dans la stratégie du capital qui délaissait l’approche keynésienne, qu’on désigne aujourd’hui comme le passage au néolibéralisme. Un moment crucial de cette transformation a eu lieu à la CUNY. En 1975-1976, quand il y a eu le grand crash de la ville de New York qui faisait face à la faillite [bankruptcy], la CUNY, pour trouver de l’argent pour payer les installations, a annoncé qu’elle allait imposer des frais de scolarité. En réponse à quoi un mouvement s’est organisé pour s’y opposer, un peu comme ce qui s’est passé au Québec. Malheureusement, ce mouvement a échoué. Et en peu de temps, en 1976, des frais étaient imposés pour la première fois. C’était une sorte de coup d’État où des gens ont imposé des mesures pour recouvrir la dette de la ville de New York. Dès lors, nous avions conscience de la grande transformation qui avait cours et de l’importance que pouvait avoir son blocage sur les développements historiques qui allaient suivre. Mais il ne s’est pas produit.
SF: Il ne s’est pas produit parce qu’ils ont créé de toute pièce cette faillite de la ville. À l’époque, on disait que pour toutes les transformations envisagées par le capitalisme aux États-Unis ou dans le monde, New York allait être le terrain d’essai, puisque New York était l’un des endroits les plus combatifs. Ainsi, si une mesure passe à New York, elle peut passer ailleurs. Et ça s’est avéré puisqu’ils ont créé les conditions pour imposer des ajustements structurels un peu partout sur la base d’une faillite. Une panique totale créée de toute pièce. On suspecte que c’est un mensonge, que quelque chose ne tourne pas rond, mais nous ne sommes pas suffisamment organisé·e·s pour y faire face. Je vis ce rapport aux événements comme une défaite. Il y a davantage de cohésion au sommet qui leur permet d’imposer ces mesures, pour pousser un pays entier ou une ville à un état de siège. C’est effectivement un état de siège quand, soudainement, les normes habituelles sont suspendues : «c’est une urgence, il n’y a plus d’argent, maintenant il faut rouvrir le contrat».
ES: Certains qualifient la désindustrialisation comme un gain des mouvements de contestation des années 1960 et 1970. Par exemple, Marcello Tari considère le départ des usines comme une victoire de l’autonomie italienne, en diriez-vous autant?
SF: Les autonomes italiens aiment se déclarer vainqueurs. Ils gagnent toujours. La classe ouvrière victorieuse a poussé le capital à nous mettre au chômage. Le 9 à 5 était terrible et maintenant que nous sommes sans emploi nous n’avons plus à faire de 9 à 5. Bref, si on veut qualifier la fin du travail comme une victoire, c’est vrai que l’autonomie a été gagnée. On ne voulait plus travailler, on refusait le travail d’usine, et il n’existe plus. Ainsi, nous pouvons nous organiser de manière autonome. Par contre, il y a la pauvreté et les divisions. Si vous voyagez à travers les États-Unis, vous verrez un peu partout des campements de gens qui vivent dans la rue. Vivre dans la rue n’est plus marginal; le logement n’est plus un droit.
CM: Effectivement, il semble que même dans les pays «riches», où on peut présumer l’accès à des espaces pour s’abriter, les campements se multiplient. Dans plusieurs grandes villes, ces mêmes campements sont devenus des espaces d’organisation visant à déposséder les villes et commerces de ces espaces où on peut vivre.
SF: Exact. De la Nouvelle-Orléans jusqu’à l’Oregon et San Francisco, il y a des camps partout. Des gens qui vivent dans des tentes, dans leur voiture ou seulement sous des couvertures. On revient à l’époque où les travailleurs et les travailleuses étaient qualifié·e·s de pauvres, mais avec davantage de divisions. Il est ainsi plus difficile d’avoir un projet commun.
ES: Je sais que vous avez parlé de l’abandon de la reproduction par le capital et que vous travaillez l’une et l’autre sur la communisation; les communs. Silvia, ton livre Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons a été très populaire à travers le monde, et a influencé plusieurs tendances au sein de la gauche à tenter l’autonomie. Les initiatives d’autonomie se multiplient, et comme le suggère ton ouvrage, elles visent à dépasser le simple milieu de travail productif. Plusieurs vont jusqu’à revendiquer une vie autonome, ou un style de vie autonome du reste du monde. Cette autonomie devient elle-même un refus du travail et un style de vie révolutionnaire. Est-ce possible de revendiquer une telle autonomie sans nier les luttes du Sud global, ou son exploitation? Par exemple, plusieurs des possibilités qui s’offrent à nous sont le résultat de l’expropriation des ressources du Sud. On peut penser au surplus alimentaire dans les épiceries ou au faible coût de certaines commodités. Ainsi, une telle autonomie est-elle possible, et même souhaitable?
SF: La politique des communs n’a jamais été un projet pour redistribuer ce qu’il reste, ou distribuer les restants entre pauvres. Dans un premier temps, elle doit être réfléchie comme un projet de réappropriation des terres, des lieux, des ressources et des richesses, et non des restants. Et, la réappropriation est un projet local; reprendre les ressources où nous nous trouvons et non celles de Buenos Aires ou du Paraguay. Il est aussi question de se réapproprier ce qui est jeté parce qu’on ne devrait pas jeter autant, mais pas seulement. Dans un deuxième temps, la vie en utopie – en communs – ne doit pas justifier un désintéressement pour le reste du politique. Il n’est pas possible de s’extraire du système capitaliste global, c’est absurde. Par exemple, les luttes pour un salaire doivent continuer d’exister. Ces luttes ne sont d’ailleurs pas contradictoires avec une politique des communs qui est, somme toute, une façon de s’organiser. The commons for the struggle and the struggle for the commons 4 est, selon moi, une bonne façon de concevoir ma proposition. Il s’agit d’un objectif et d’un moyen. Le commun est utilisé dans notre façon de s’organiser puisqu’il représente ce qu’on vise à organiser : l’ensemble de la vie. Les espaces de lutte ne sont donc pas limités aux relations salariales, et ils permettent de développer de nouvelles formes de collaboration. L’organisation doit aussi viser à poser les bases d’une structure. Les conceptions de la résistance souffrent souvent d’une vision idéalisée ou même naïve, j’en ai souffert aussi. On peut avoir beaucoup d’enthousiasme, de belles réunions et de grandes manifestations, mais il doit y avoir beaucoup plus. Il doit y avoir une infrastructure, et j’entends par là des espaces qui nous permettent de réfléchir et d’entreprendre des actions concrètes pour s’outiller des ressources nécessaires à nos luttes.
J’ai vu ce genre d’initiatives notamment dans des favelas en Argentine ou en Amérique latine. Je n’en ai pas encore vu en Amérique du Nord, mais il est possible que ça existe. À titre d’exemple, lorsque l’état de routes en terre battue causait des problèmes de santé dans la communauté avoisinante, leur transformation a été prise en charge par les personnes de cette communauté. À travers ce processus, les personnes ont appris des techniques, elles ont développé un réseau de communication, elles ont appris à travailler ensemble, ou encore à se réunir dans des espaces publics. Mais, ça ne doit pas s’arrêter là. On ne peut pas simplement se substituer à l’État. Les communs sont donc un projet politique de réappropriation, et non de remplacement, qui vise à créer et solidifier un tissu social pour mieux servir nos luttes.
CM: Durant la campagne pour la rémunération des stages, une partie des personnes organisées ont commencé à mettre de l’avant la proposition de carrément abolir les stages. Cette analyse s’est étendue de manière à envisager la fin de la séparation entre les études et le travail, et elle a abouti à une perspective d’abolition de l’université. Elle n’était alors plus considérée comme une sphère séparée du travail, et l’éducation était intégrée dans tous les milieux de travail. Les réactions ont été multiples, et plusieurs voix antagoniques provenaient du milieu universitaire ou encore de tendances «autonomes», par exemple pour revendiquer l’université comme leur milieu de vie, le lieu qu’elles habitent. Quelle position auriez-vous prise dans ce débat?
SF: Pour moi, c’est oui et non. Selon notre analyse, l’université est une usine et doit, bien sûr, être abolie. En même temps, c’est également un milieu de lutte. L’ensemble du système est une usine — on parle en termes d’usine sociale — donc idéalement, si on abolit le travail capitaliste, on abolit les milieux du travail capitaliste et on les transforme de manière à les rendre utiles. Dans cette perspective, l’université est non seulement une institution, mais un milieu de travail, et un milieu d’exploitation et d’endoctrinement. Comme l’usine ou autres articulations de l’organisation capitaliste du travail, il s’agit d’un milieu de lutte où on peut revendiquer des choses. On peut tenter d’utiliser le temps consacré aux études pour accomplir ce que l’on veut plutôt que ce qu’ils veulent qu’on fasse. Les ressources, soit le papier, le téléphone, la photocopieuse de l’université, etc., peuvent être utilisées pour nos propres fins. Ainsi, l’idée d’abolition de l’université est une perspective, de la même manière que l’abolition de l’usine. L’université est une pièce de la machine capitaliste, et on doit se poser la question : comment doit-on agir en son sein pour tendre vers cette perspective?
Puisque nous n’avons pas actuellement le pouvoir pour décider qu’il n’y ait plus d’université, de déclarer la fermeture de l’ensemble des universités aux États-Unis. Alors, que faire? On peut décider de ne pas aller à l’université, comme choix individuel; mais peut-on vraiment décider cela quand on s’attend de nous à atteindre un certain niveau de scolarité et une certaine façon de penser? Dans ce cas, l’idée c’est plutôt d’être à la fois dans l’université et contre l’université. Selon moi, cela implique d’agir à l’université de manière à utiliser l’université contre l’usage qu’«ils» veulent qu’on en fasse. C’est ce que l’endettement étudiant et les stages servent à empêcher. Dans les années 1960, l’université est devenue un milieu d’organisation, un milieu d’apprentissage de tout ce qu’«ils» ne voulaient pas qu’on apprenne. Un lieu d’assemblées et de réunions constantes, un milieu de collectivisation des connaissances. C’était un moment de radicalisation des populations étudiantes. C’est ce qui est combattu dans la mise en place de mesure pour s’assurer qu’on fréquente l’université pour des fonctions très spécifiques de manière à ce qu’on ne puisse pas utiliser cet espace. C’est pour cette raison qu’il faut se battre pour l’éducation gratuite, etc. L’université est une usine à éducation [education factory] et il faut combattre cette conception de l’éducation pour l’exploitation.
Beaucoup plus de luttes créatives peuvent se faire au sein de l’université qu’à l’heure actuelle. Par exemple, pour abolir la hiérarchie dans la production du savoir. Qui produit le savoir? Les profs, les étudiant·e·s ou le personnel de soutien comme les employé·e·s de la cafétéria.
GC: Aux États-Unis, la plupart des travailleuses et des travailleurs dans les cafétérias ont lutté ou vécu la guerre civile, et en connaissent bien plus que les profs. Ils et elles viennent du Nicaragua, du Salvador, et ont échappé aux escadrons de la mort. Les ajustements structurels leur sont familiers, la migration et beaucoup d’autres sujets aussi; leurs savoirs sont riches.
SF: Mais la hiérarchie les écarte de la production du savoir. À ce sujet et pour de multiples autres raisons, des luttes doivent s’organiser. L’université est un microcosme des divisions qui existent dans l’ensemble de la société. Certaines initiatives se font durant les grèves étudiantes ou les grèves du personnel de la cafétéria, mais ce n’est pas suffisant, car elles n’ont pas cours sur une base quotidienne.
Cette question est intéressante parce qu’il devrait y avoir quotidiennement dans tous les milieux de travail des moments d’apprentissage et de partage de connaissance. Vous connaissez l’histoire de la lutte pour les 150 heures en Italie? En 1974, des travailleurs et des travailleuses du secteur de la métallurgie en Italie avaient tant de pouvoir qu’ils et elles étaient arrivé·e·s à obtenir un contrat de travail qui leur permettait d’avoir 150 heures payées par l’employeur pour étudier à l’intérieur de l’usine. C’était dans le même esprit que ce que vous formuliez durant votre campagne: ramener le partage du savoir dans les milieux de travail. Une partie de la semaine était ainsi consacrée aux études, une classe au sein de l’usine. Et ce sont les gens qui décidaient ce qui allait être étudié, par exemple pour mieux comprendre leur exploitation par l’employeur, ou sur l’usage de ce qui était fait des biens produits dans l’usine. Cette période fut brève, mais très intéressante. C’est le genre de revendications qu’on pourrait ramener dans n’importe quel endroit qui sert un collectif. Nous ne pouvons pas en faire autant lorsque le travail se fait à partir de la maison ou que les horaires de travail sont trop divergents.
CM: Les remises en cause de l’université visent aussi à contester sa fonction de reproduction de la gauche ou de milieux de gauche, dans sa forme actuelle. Les profs réfractaires à l’abolition de l’université prétendent jouer un rôle important dans la reproduction de la gauche. Dans les faits, leur rôle est certain, mais pas pour autant souhaitable. La gauche reproduite dans les universités est somme toute hégémonique. Et malheureusement, en ce moment à Montréal, il n’existe pas vraiment de sphères alternatives qui jouent le même rôle. Même dans le cas où l’éducation serait gratuite, comme c’était le cas dans les années 1960, le personnel enseignant exerce un contrôle important sur cette hégémonie.
SF: En effet, les luttes étudiantes des années 1960 sont intéressantes pour certains aspects. Premièrement, l’université était perçue comme un lieu important pour l’organisation, mais il fallait toujours en sortir. L’université n’était pas une enclosure. Les gens impliqués dans le mouvement étudiant ou dans le mouvement anti-guerre sortaient de l’université pour créer des liens avec les gens luttant dans les lieux de recrutement pour le Vietnam, par exemple, ceux et celles qui entraient en conflit avec les G.I., pareillement pour les personnes impliquées dans les luttes pour les libertés civiles avec les communautés noires. On n’en faisait pas assez, mais beaucoup de liens étaient créés à l’extérieur des campus. J’ai pu vivre cette expérience quand je travaillais à Hofstra, qui est un campus particulièrement radical. Surtout dans les dernières années, on martelait l’importance de créer des liens au-delà des murs, alors que l’université était entourée par une importante communauté immigrante. On a entre autres fait venir des gens de la communauté, et la population étudiante se rendait dans la communauté. Un autre exemple est le campus à Amherst, au Massachusetts, lui aussi assez radical quoique beaucoup moins de nos jours. Le mouvement étudiant s’est battu pour la mise sur pied d’un programme où tu reçois des crédits pour travailler dans la communauté. Tu vas peut-être me dire que c’est de la cooptation, mais les fondements de l’initiative étaient de ne pas encloîtrer la communauté universitaire et d’assurer des allers-retours continus.
Deuxièmement, on considérait que l’université nous revenait. Les bâtiments, le papier, les machines, tout a été acheté avec l’argent de la classe ouvrière. Elle ne peut être réservée aux riches, ce sont nos ressources. À partir du moment où il est admis qu’elle est financée par les prélèvements sur les salaires de la classe ouvrière, la conception de l’université devient tout autre.
Les profs conservent leur contrôle en raison de la faiblesse des forces organisées. Plusieurs luttes passées peuvent servir d’exemples. En Italie, on a été capable d’imposer les examens collectifs, c’est-à-dire l’évaluation à plusieurs, ce qui a continué de se faire pendant un certain moment. L’idée de faire de l’université un outil de sélection était complètement rejetée. De la même façon, les examens ouverts ont été imposés. Lorsque j’étais étudiante dans une université italienne, on se retrouvait seul·e dans une petite pièce avec le professeur, et n’importe quoi pouvait arriver; puis on en ressortait diplôme en poche. C’est un gain que ce ne soit plus le cas. Il va sans dire que les profs peuvent toujours commettre des injustices, mais les façons de faire ont changé. Les notes collectives, je suis convaincue que ça doit encore exister à certains endroits. Ce sont différentes façons d’employer l’idée selon laquelle l’université est le résultat d’une somme d’argent; c’est nous qui la produisons; elle est à nous; c’est l’argent tiré de l’exploitation de nos parents; vous n’avez pas le droit de l’utiliser de cette manière.
Un autre fait à garder en tête: de façon courante aux États-Unis et assurément au Canada, l’université est le lieu de recherches très, très dangereuses. Il y a une importante présence militaire à l’université, et des luttes importantes se sont faites sur cette question. Le gouvernement cherche d’ailleurs à diminuer le financement des universités où il y a eu de l’opposition étudiante à un programme d’études destiné à l’armée.
Bref, plusieurs terrains de batailles se retrouvent à l’université. Je ne veux pas glorifier l’université, mais des choses y sont possibles, du moment qu’on va au-delà de la conception selon laquelle l’université est importante pour élever l’esprit et le savoir.
GC: En Italie, dans les années 1970, une des choses particulièrement dangereuses pour le capitalisme était la formation de groupes un peu partout dans les universités à travers le pays qui se réunissaient sur une base régulière pour faire de la recherche pratique sur comment transformer le développement économique et social en une société d’un type nouveau. Par exemple, certains de ces groupes abordaient la question de l’eau, à savoir comment planifier l’approvisionnement en eau dans une société nouvelle. Même chose pour d’autres enjeux, on se questionnait sur les décisions à prendre par le prolétariat. En avril 1979, c’est l’une des choses qui a été écrasée. Ce n’est pas l’histoire «bang bang!» qui a été cruciale, mais plutôt un sentiment grandissant qu’il est maintenant temps pour le prolétariat d’enlever sa couche et de commencer à tendre vers un projet sérieux. Ce qui se passe présentement en Amérique latine est similaire et c’est très important d’y prêter attention et de s’assurer que ces développements ne soient pas écrasés.
SF: En Amérique latine, dans les dernières années, les universités ont été cruciales. À Porto Rico, au Brésil, où Bolsonaro a fermé une grande partie des universités publiques occupées par des étudiant·e·s qui s’y organisaient.
Nous nous sommes retrouvé·e·s à deux reprises face au dilemme à savoir si on reste à l’université ou si on l’abandonne. Ce propos a généré de longues discussions. Pas tellement dans les années 1960 et 1970 où il n’était pas question d’abandonner l’université qui était un lieu central. Je me souviens de ne pas avoir eu une présence régulière en classe. L’université était très différente à l’époque. Mais lorsque nous étions au Nigeria en 1983-84, nous sommes arrivé·e·s à un moment où s’organisaient de nombreuses luttes étudiantes. Certains profs et certain·e·s étudiant·e·s en sont venu·e·s à dire: « laissons tomber l’organisation dans les universités». Le mouvement étudiant africain étant composé en grande partie de la classe moyenne et supérieure, il s’agissait d’une élite. Pour la gauche, la disparition des universités était un bon débarras. Mais, nous nous sommes battu·e·s contre cela. Nous n’étions pas d’accord à l’effet que l’université n’était destinée qu’à une élite alors que plusieurs venaient de familles paysannes ou marchandes. Et, pour moi, l’université est un espace capitaliste, mais aussi un espace qui est à nous, en ce sens qu’elle est le résultat de moult expropriations – les bâtiments – et non dans le sens d’une hégémonie que nous sommes capables d’utiliser. Les richesses de l’université sont des richesses qui nous ont été retirées.
GC: Au Nigeria, c’était particulièrement clair. Le campus était entouré d’une population qui s’était vu voler ses terres, et qui ne s’y était pas résignée. Alors, elle y apportait son bétail, elle continuait d’occuper les lieux.
SF: Les villageois·e·s se réappropriaient des parcelles du terrain pour y planter toutes sortes de choses. Je me souviens qu’en me rendant à l’école en bicyclette, je voyais des femmes cultiver de la nourriture le long du chemin et j’en suis venu à les questionner. C’est là que j’ai appris l’histoire de l’expropriation du village et de la lutte contre celle-ci. La relation entre les étudiant·e·s et les villageois·e·s en était teintée.
ES: De notre côté, le débat qu’on a pu avoir autour de l’abolition de l’université était d’une autre nature. Je considérais intéressant que la discussion pousse les étudiant·e·s en sociologie ou en philosophie à considérer l’université comme leur milieu de travail, ce que la plupart ne reconnaissaient pas, même celles et ceux qui étudiaient pour devenir professeur·e·s ou chercheur·e·s. Il s’agissait en quelque sorte d’une rhétorique pour les provoquer à l’assumer, puisqu’on défendait que l’enseignement théorique et pratique devrait être renvoyé dans les milieux de travail. J’espérais aussi que les luttes que nous avons pu mener à l’intérieur de l’université, par exemple pour prendre le contrôle sur un café étudiant ou sur des locaux plus grands pour les associations, puissent être organisées dans nos milieux de travail à l’extérieur des universités.
CM: La stratégie du salaire impliquait également l’acquisition de pouvoirs pour lutter contre les violences sexuelles. Il s’agissait d’un contexte intéressant, la campagne ayant commencé juste après le mouvement #metoo et parallèlement à l’adoption en juin 2017 d’une législation stipulant que désormais les universités québécoises doivent se doter d’une politique contre le harcèlement sexuel. Nous nous sommes même présenté·e·s à différentes discussions publiques à ce propos pour confronter la ministre de l’éducation à nos revendications. Nous avançions alors que le meilleur moyen pour contrer le harcèlement était de redonner du pouvoir aux étudiantes qui étaient harcelées dans leur rapport avec les professeurs, et ce en leur reconnaissant un statut de travailleuses. Étant donné que nous sommes dans une position très précaire au sein de l’université, dénoncer un prof ou une supervision de stage n’est souvent pas une option envisageable. Tout comme il n’est pas envisageable de continuer les études dans la même université quand la majorité des profs contestent la dénonciation et que les rapports sur l’incident sont privatisés et confidentiels. La dénonciation de professeurs agresseurs ou harceleurs est réprimée. Je serais intéressée d’avoir votre point de vue à ce sujet, en rapport à votre analyse en ce qui concerne l’autonomie du corps et des attaques contre celui-ci.
SF: Une des critiques que j’ai formulées à l’endroit du mouvement #metoo est qu’il consacrait beaucoup trop d’attention à des hommes en particulier, des hommes de pouvoir. La violence sexuelle est omniprésente et elle est multiple. Lorsqu’on va à l’université, que ce soit en tant qu’enseignante ou étudiante, beaucoup d’enjeux sont liés aux relations familiales, aux enfants, au travail, au type de soutien offert par l’université pour les femmes enceintes ou avec des enfants et des obligations familiales, ce sont d’importants enjeux tous liés aux disparités de genre. Je ne sais pas comment c’est au Canada, mais ici aux États-Unis c’est presque rien, ça se résume à quelques universités qui ont un service de garde, c’est le plus qu’on peut s’attendre à avoir. Il y a aussi l’enjeu de l’horaire des études, du moment d’étudier, à savoir comment est-il possible d’organiser son temps pour étudier, en termes d’aménagement de l’espace pour créer la possibilité d’étudier. Les questions liées aux enjeux de production et de reproduction réapparaissent dans les études, les heures de travail, etc.
Ainsi, l’enjeu de la violence de la part des profs est complexe. Les problématiques ne se limitent pas aux cas flagrants de professeurs qui contraignent des étudiantes à avoir des relations sexuelles avec eux. La violence est aussi beaucoup plus subtile; c’est dans le langage, dans les messages indirects qui sont envoyés, etc. Je pense que nous sommes très loin du type d’organisation convenable sur les campus. Particulièrement en ce moment, je pense qu’il y a un important désavantage, précisément en raison de la difficulté à se réunir, à créer des formes de solidarité et de coopération, nécessaires aux femmes pour créer une situation dans laquelle elles peuvent éviter de subir les risques individuellement encourus lors d’une dénonciation. Il est difficile de confronter le système qui crée la possibilité de ces commentaires de la part des profs et ensuite de démontrer qu’elles ont été violentées dans une telle situation. Elles devraient aussi pouvoir obtenir une compensation monétaire et des congés, comme pour un accident de travail par exemple. On doit donc réfléchir à ce qu’est un accident de travail. Il ne s’agit pas seulement d’une situation où une personne répare un toit et se brise un membre, c’est aussi lorsqu’une personne étudie et qu’elle est minée par le type de relations qu’elle subit à l’université. C’est relativement plus facile de prendre en charge les cas flagrants, les attaques et transgressions flagrantes de la part des professeurs; c’est plus difficile quand on a à faire avec des situations plus systémiques, qui concernent la totalité de la dynamique de la salle de classe. Je crois qu’on ne peut les adresser qu’avec une collectivité forte et organisée par les femmes. Ce sont là deux éléments cruciaux pour combattre les violences sexuelles.
CM: Justement, on peut penser aux mobilisations à l’occasion du 8 mars. Tu nous as partagé plus tôt que la mobilisation à New York avait été difficile. Il en était tout autrement à plusieurs endroits en Amérique latine, mais aussi ailleurs, où les mouvements contre les violences sexuelles ont rassemblé les foules lors de cette journée. Au Québec, on tentait d’ancrer le mouvement de grève des stages dans la mouvance des grèves des femmes à l’international, ce qui je crois a assez bien fonctionné. Qu’est-ce qui explique qu’on ne retrouve pas cette convergence féministes aux États-Unis?
SF: Effectivement, dimanche dernier nous étions seulement 300 femmes au Washington Square, la plupart latino-américaines. Il y avait aussi quelques activités ici et là dans les quartiers. Mais il n’y avait pas de terrain commun. On retrouve de grandes divisions entre femmes blanches et femmes noires, entre femmes immigrantes et non immigrantes, les aides domestiques font leur propre truc aussi. Il y a bien sûr des points de rencontre, mais nous n’avons pas vraiment un mouvement féministe, dans le sens d’un mouvement qui se reconnait comme espace commun. Nous avions un tel mouvement féministe dans les années 1970. Malgré de nombreuses divergences et débats, il y avait l’idée d’un certain intérêt commun qui dépassait les divisions, et nous avions toutes intérêt à trouver des stratégies. Ces dernières étaient diverses, mais il y avait tout de même un espace commun dans lequel les femmes pouvaient se réunir toutes ensemble. Le 8 mars, entre 1970 et 1973, nous nous retrouvions réunies par milliers sur la place où dimanche dernier nous n’étions que 300. Il y a aujourd’hui d’importantes divisions, des groupes organisés de façon très belligérante. C’est très conflictuel. Ces divisions ont leurs origines au sein de certains syndicats. Aujourd’hui, la lutte contre la violence envers les femmes est organisée dans certains réseaux à travers le pays, mais demeure très petite.
CM: Pourtant, lorsque nous sommes venu·e·s il y a deux ans, en 2018, quelques jours avant le 8 mars et un appel à la grève des femmes était lancé par le collectif Women’s Strike NYC. Les femmes étaient invitées à quitter le travail plus tôt. La mobilisation semblait importante, et le collectif semblait rassembler beaucoup de militant·e·s.
SF: En fait, à la suite de l’élection de Trump, il y a eu de très grosses manifestations à Washington et à New York. Cela a eu une influence sur la taille du collectif Women’s Strike NYC dans les années qui ont suivies, gonflé par l’anti-Trump. La mobilisation n’a toutefois pas duré. Aujourd’hui, on se retrouve dans ce qu’on peut appeler un féminisme diffus, avec un grand nombre de collectifs faisant toutes sortes de choses, ce qui est bien. Ce n’est pas mort, mais ce n’est pas comme en Argentine, où on peut se rendre dans de grandes assemblées dans lesquelles se côtoient des femmes de l’économie solidaire, des syndicats, des intersyndicales, de Ni Una Menos. Les 12 au 14 octobre de chaque année, elles choisissent une ville où elles se rencontrent, environ 70 000 femmes étaient présentes l’an dernier. Il y avait bien sûr de nombreux débats et conflits. La semaine précédente, à La Plata, nous étions réuni·e·s et il y avait débat quant à l’appel du rassemblement. Devrait-il être désigné comme national ou plurinational, la seconde option dans le but de reconnaître la nation mapuche et favoriser la présence de ses membres dans le mouvement? Il y avait également un débat à savoir s’il s’agirait d’un appel au mouvement des femmes ou un appel plus large pour inclure les membres de la communauté LGBTQ+. Malgré ces débats, l’appel a réuni énormément de personnes. Mais bien sûr l’histoire du mouvement des femmes est différente en Argentine, avec une conception différente, une compréhension de l’impérialisme et du capitalisme.
ES: J’en comprends que tu discutes un peu de tout ça dans ton nouveau livre Par-delà les frontières du corps. Pour ta part George, tu me disais que le mouvement contre l’endettement se réorganise à l’échelle nationale. Peux-tu nous en parler un peu?
GC: Occupy New York a été un mouvement très important, pas seulement sur le plan tactique, mais aussi en termes de réseaux sociaux qui en sont issus. Beaucoup de choses se sont passées à la fin d’Occupy, quand le mouvement s’est effondré sous la pression de la police et compagnie. Une de ces choses est le développement d’une organisation appelée Strike Debt, la grève de la dette, en 2011. J’y ai consacré le plus gros de mon temps pendant quelques années jusqu’à sa dissolution en 2017. La dissolution ne s’est toutefois pas faite par rupture et n’a pas été documentée. On a toutefois publié un livre pour expliquer le mouvement et ses stratégies, notre conception de ce qu’est la dette et du mouvement politique qui peut supprimer l’endettement. Puis récemment, il y a eu la création du Debt Collective, issu d’une partie de Strike Debt. Le collectif en est à ses débuts, mais je prévois de m’y impliquer.
ES: Sinon, as-tu des projets en cours?
GC: Ces dernières années, je travaillais à un gros projet, gros pour moi, mais peut-être pas pour le monde, qui consistait à démontrer que l’argent, dans ses différentes formes, surgit de la lutte des classes. Mes efforts ont été consacrés à terminer la rédaction d’une trilogie à ce sujet. D’ailleurs, un premier tome est prêt pour l’impression. J’y présente un portrait complet de l’argent, de la lutte des classes et de ce qui s’ensuit. Je me concentre sur trois philosophes : John Locke, George Berkeley et David Humes. Je fais la démonstration que l’argent fait partie de la lutte des classes, mais aussi que la philosophie est, en fait, une discussion sur l’argent.
CM: Merci, Silvia et George, pour l’organisation d’une discussion publique au People’s Forum et de nous avoir reçu·e·s aujourd’hui pour qu’on ne rentre pas à Montréal complètement bredouilles. On se reprendra après la pandémie.
New York, 12 mars 2020
Les illustrations sont tirées de l’oeuvre de Stéphanie St-Jean Aubre alias L’ensemble vide.
NOTES
1. Plusieurs matériaux originaux utilisés lors des campagnes pour la rémunération du travail domestique et du travail scolaire sont disponibles en ligne : http://zerowork.org/.↩
2. Traduction libre de l’expression popularisée en anglais : «to have a foot in the door».↩
3. Au moment de cette entrevue, le télétravail au Québec n’en était qu’à ses débuts. Les réticences quant à son déploiement étaient partagées par les travailleurs, les travailleuses et les employeurs. La pandémie a évidemment tout changé. Depuis, le télétravail s’est imposé pour tous les contextes de travail qui le permettait. Etienne Simard a fait part de son expérience et théorisé les problématiques qui en découlent notamment dans une perspective d’organisation sur son lieu de travail, à lire ici : http://www.revue-ouvrage.org/teletravail-dystopie/. ↩
4. Traduction libre : Les communs pour la lutte et la lutte pour les communs. ↩
5. Voir texte de Silvia Federici, «Les racines africaines des luttes étudiantes aux Etats-Unis : du mouvement d’occupation à la campagne contre la dette des étudiants», Transversal, 2012 : https://transversal.at/transversal/0112/federici/fr : «Si les luttes des étudiants africains dans les années 1980 et 1990 étaient aussi virulentes, c’est que les étudiants prenaient conscience que les coupes drastiques dans les budgets universitaires, réclamées par les programmes d’ajustement structurel (PAS) de la Banque mondiale, marquaient la fin du « contrat social » qui définissait leur relation à l’Etat pendant la période postérieure à l’indépendance, et faisait de l’éducation la clé de l’avancement social et de la citoyenneté participative. Ils comprenaient aussi, surtout en entendant les dirigeants de la Banque mondiale affirmer que l’Afrique n’avait « pas besoin d’universités » (comme l’ont fait certains d’entre eux lors d’ une réunion tenue à Harare, en 1986, en présence des vice-chanceliers des universités africaines), que derrière ces coupes se profilait le spectre d’une nouvelle division du travail au niveau international, visant à recoloniser les économies africaines et à dévaluer en conséquence l’apport des travailleurs africains. A bien des égards, l’expérience africaine a marqué le début d’un processus appelé à affecter, en trois décennies, les systèmes éducatifs de toute la planète. C’est pourquoi il est opportun que nous en tirions les leçons.»↩