11 Mai Quelques leçons du militantisme anti-SIDA pour s’organiser dans le contexte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)
Par GARY KINSMAN
Publié le 11 mai 2020
Tandis que nous traversons la crise du Coronavirus/COVID-19, je suis frappé par les rapprochements qui peuvent être faits avec la crise du SIDA (qui n’est toujours pas terminée). Ces parallèles sont pourtant peu soulignés dans les différentes réflexions et analyses que j’ai pu lire. Toutefois, des différences importantes entre ces deux crises sanitaires existent aussi, notamment quant au mode de transmission du virus, à ses conséquences sur le corps et la santé des personnes atteintes et à la population la plus touchée. Dans les décennies 1980 et 1990, j’ai été activement impliqué dans l’organisation et le militantisme autour du SIDA, en plus de me consacrer à archiver et à documenter de ces histoires. Je propose ici une ébauche des apprentissages tirés de l’organisation politique et du militantisme contre le SIDA, qui peuvent être utiles dans le contexte de la pandémie actuelle. Devant l’urgence, cette contribution est bien entendu incomplète. Je vous invite donc à y apporter des correctifs et des critiques. Cette contribution et les échanges qui en découlent sont appelés à évoluer. — GK

Lorsque je fais référence à l’organisation et au militantisme contre le SIDA, il s’agit d’abord (mais pas seulement) des actions directes organisées pour appuyer les revendications sur la recherche et l’accès aux traitements (dans un sens large) et menées par une base militante conscientisée au sein d’une variété de groupes rassemblés sous la bannière de la AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) organisés aux États-Unis, au « Canada » et à travers le monde (dont certains existent toujours) et d’autres groupes comme AIDS ACTION NOW! (AAN!) basé à Toronto. Ces groupes organisés autour du principe « Silence=Mort, Action=Vie » luttent pour que les individus vivant avec le VIH/SIDA aient accès aux traitements leur permettant de combattre l’infection qui menace de les tuer. Les besoins des personnes affectées par le SIDA étaient ainsi placés au centre de la réponse sociale à l’épidémie. Il est aussi question de la première vague de groupes communautaires fondés au début des années 1980 afin de soutenir les personnes aux prises avec le VIH/SIDA et de développer des initiatives éducatives et des campagnes pour contrer la discrimination, tandis que les gouvernements laissaient les gens mourir. Ce sont ces initiatives communautaires, mises de l’avant par des homosexuels et des lesbiennes et, dans une certaine mesure, des mouvements féministes et progressistes en faveur de la santé, qui ont apporté un soutien aux personnes touchées par le SIDA face à l’inaction de l’État et à l’indifférence des élites de la profession médicale. Ces formes d’activisme ont prolongé et sauvé la vie des gens.
Comme toute urgence sanitaire, la crise du SIDA mettait/met en confrontation un condensé de réalités et de rapports sociaux — notamment liés à la sexualité, à la race, au genre, à la classe, à la pauvreté, au sous-développement, au colonialisme et au néocolonialisme, à la santé physique et mentale, à la consommation, au travail du sexe, au pouvoir des compagnies pharmaceutiques, au caractère de la profession médicale, à la problématique de la santé publique, et bien d’autres encore. Lorsqu’il est question de santé publique, la question qu’il importe de poser est : de quel « public » parle-t-on et la « santé » de qui souhaite-t-on protéger ? Dans le cas de la crise du SIDA, il faut tenir compte de l’ensemble de ces rapports et de ces réalités.
La pandémie actuelle soulève les mêmes enjeux et bien d’autres encore, mais dans un contexte où le capitalisme néolibéral est encore plus avancé dans la destruction du système de santé, de l’assistance sociale et de l’État providence, et a créé une ère de travail précaire dans plusieurs pays. Les multinationales pharmaceutiques exercent un pouvoir encore plus insidieux dans nos vies.
En particulier, il est possible de faire les liens suivants :
Les « populations superflues » et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation
Dans les premières années de la crise du SIDA, l’État montrait peu d’empressement à agir puisque la maladie ne semblait affecter que des « populations superflues », que l’on pouvait sacrifier — les hommes homosexuels ou ceux qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, les personnes qui consomment des drogues, les communautés haïtiennes ou d’autres communautés racisées (sans oublier la construction raciste du « SIDA africain ») et les travailleur·se·s du sexe. Ces groupes étaient tous considérés comme des « groupes à risque élevé », un terme puisé à même le champ de l’épidémiologie afin de justifier la discrimination et la stigmatisation. Pour les gouvernements de la droite morale (souvent néolibéraux), ces groupes étaient considérés comme superflus, ce qui a retardé de nombreuses années l’organisation des soins et du soutien social dans la lutte contre le SIDA. Au contraire, on a considéré qu’il fallait protéger la population générale (c’est-à-dire, blanche, issue de la classe moyenne et hétérosexuelle) de ces « vecteurs » et « sources » de contamination. Les premiers efforts d’organisation ont donc été concentrés autour d’activités à risques auxquelles tout le monde pouvait s’adonner et à valoriser la vie et les besoins des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des communautés les plus affectées par la maladie. Les militant·e·s contre le SIDA confrontaient les réponses racistes et discriminatoires à la crise. La réponse militante a aussi mis de l’avant les préoccupations des personnes ignorées par la société dans la lutte contre l’épidémie, notamment les besoins des femmes et des personnes racisées. Ce sont donc les besoins des personnes directement et principalement affectées qui étaient priorisés au lieu des besoins de celles non infectées.
Dans le contexte de l’actuelle pandémie, c’est contre la Chine, la Corée et les autres pays d’Asie que se sont organisés la discrimination, le racisme et la stigmatisation, notamment par l’insistance du président américain Trump à faire référence au virus « chinois » (ou pour d’autres, au virus « asiatique »). Localement, la population iranienne a aussi été ciblée et, plus largement, le Moyen-Orient. Le fait d’avoir considéré la pandémie comme un problème qui n’affecte que les « autres » populations (et de considérer ces « autres » populations comme l’unique « menace ») a entraîné un important délai dans l’élaboration, par de nombreux États et cercles officiels, d’une réponse organisée.
Les plus vulnérables au coronavirus — les personnes vieillissantes ou immunodéprimées — notamment les personnes cancéreuses, infectées par le VIH, diabétiques, celles qui ont des problèmes cardiaques ou d’autres handicaps — sont aussi considérées comme « superflues ». Cette prise de position était particulièrement claire dans la mise à l’épreuve de l’hypothèse d’une « immunité communautaire » par Boris Johnson et le parlement britannique, ce que d’autres, tentés par l’eugénisme, appellent le « tri » de la population. Les personnes âgées sont ainsi considérées comme des êtres « non productifs » (selon la perspective de la production capitaliste) ou encore comme des personnes qui siphonnent les ressources collectives — une conception à mille lieues des traditions autochtones selon lesquelles les ancêtres possèdent la sagesse et méritent le plus grand respect — et les personnes immunodéprimées, incluant celles atteintes du cancer ou infectées par le VIH, et souvent les personnes vivant avec un handicap sont considérées comme des personnes que l’on peut « sacrifier ».
Lorsqu’on adopte comme principales mesures de prévention la consigne « lavez-vous les mains », toutes les communautés qui n’ont pas accès à l’eau courante et potable (c’est le cas dans de nombreuses réserves des Premières Nations au « Canada ») deviennent elles aussi « superflues ». Lorsque la « distanciation sociale » ou « l’isolement social » est la directive officielle pour prévenir la transmission, toutes les personnes qui n’ont pas les conditions matérielles pour respecter cette directive deviennent à leur tour « superflues ». L’expression « distanciation sociale », c’est maintenant clair, participe à la dissolution des liens sociaux. Comme, au contraire, il est essentiel de maintenir et de solidifier ces liens pendant la pandémie, il importe de plutôt utiliser des termes comme « distanciation spatiale » ou « distanciation physique ». Les personnes qui ne peuvent pas se distancier ou s’isoler sont les personnes pauvres et sans-abri (souvent des personnes racisées), et celles qui se trouvent dans les institutions publiques, notamment les CHSLD et les résidences pour ainé·e·s, dans les prisons, ainsi que toutes les personnes qui, à cause de la multiplication des emplois précaires sans avantages sociaux ni congés de maladie payés abolis par les réformes néolibérales, ne peuvent s’absenter du travail lorsqu’elles sont malades. Il est impossible d’ignorer les dimensions de classe et raciales en jeu. Finalement, la fermeture des frontières menace la sécurité et la santé des personnes réfugiées, migrantes et sans-statut, qui sont, pour la plupart, des personnes racisées.
Selon toutes ces mesures, c’est la vie des personnes les moins à risque de mourir du coronavirus qui est priorisée — les jeunes, les corps sains, fringants et capables, qui ont un système immunitaire vigoureux, et les riches, encore plus que tous les autres. C’est leur santé qui est protégée. C’est ce « public » qui est défendu contre les personnes pour lesquelles la COVID-19 peut être létale. Afin de contrer cet état de fait, il faut attirer l’attention sur les besoins spécifiques des nations et des communautés autochtones, des sans-abri et des organismes qui les soutiennent, des réfugié·e·s et des migrant·e·s, sur la nécessité pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs de bénéficier de congés de maladie payés, de ne pas payer le loyer ou l’hypothèque et de ne pas être évincé·e·s, de pouvoir refuser de travailler dans des conditions dangereuses, et pour tou·te·s d’avoir accès à un réseau de solidarité et à des mesures de soutien adéquates. Ces préoccupations devraient être au centre de la réponse sociale à la pandémie.
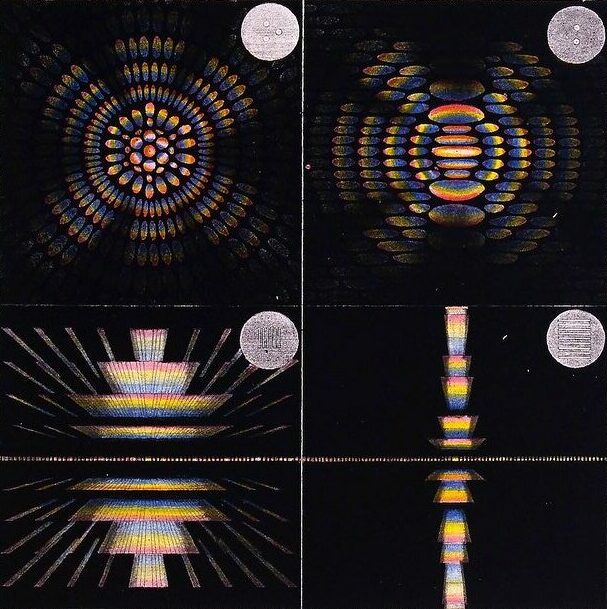
Solidarité et responsabilité sociales — des pratiques sécuritaires à la « distanciation physique »
Lorsque plusieurs, dont Michael Callen (militant de la première heure autour de la question du SIDA et lui-même atteint), ont commencé à comprendre que peu importe ce qui causait le SIDA (c’était avant que ne soit identifié le VIH) se transmettait par certaines pratiques sexuelles et par échange sanguin direct, les efforts se sont tournés vers le développement et la diffusion de connaissances sur les pratiques sexuelles sécuritaires. Plus tard, une attention similaire a été portée à la création de consignes pour l’injection sécuritaire de drogues et pour d’autres pratiques afin d’éviter les échanges de fluides corporels ou sanguins. Ces efforts se sont avérés efficaces pour diminuer la transmission du VIH. Il ne s’agissait pas d’une solution individuelle, mais bien d’une responsabilisation sociale et collective qui démontrait qu’avec du soutien, il était possible de modifier ses comportements pour le bien être de toute la collectivité. Et ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup d’éducation populaire et beaucoup de soutien communautaire. Nous partions de la prémisse que tout le monde était infecté, ce qui éliminait la barrière entre infecté·e·s et non infecté·e·s. La réduction des méfaits est devenue l’approche au centre de la consommation de drogues, jusqu’à devenir une sorte d’éthique communautaire. La même chose s’est produite avec les pratiques sexuelles sécuritaires : en les érotisant et en proposant une représentation positive et amusante de ces dernières, elles devenaient la seule façon de vivre sa sexualité.
Bien que les efforts et les mesures soient différents dans le contexte de cette nouvelle pandémie, il demeure nécessaire que la réponse soit à la fois sociale et collective pour être efficace. La distanciation physique ou spatiale, combinée au lavage des mains, à l’utilisation de gants et à la pratique de tousser ou d’éternuer dans sa manche, etc., sont maintenant les pratiques sociales nécessaires et responsables pour réduire la propagation et le taux de mortalité. Il est aussi nécessaire pour nous tou·te·s de poursuivre le travail essentiel de reproduction sociale (entre autres, en intensifiant le travail de care) malgré la distance et l’isolement. C’est sur ce travail incessant de reproduction sociale — le plus souvent accompli gratuitement par des femmes (cis et trans) dans la division genrée du travail — que repose la possibilité même de notre survie. Nous devons changer nos pratiques sociales et nous avons besoin de support et de solidarité pour y arriver, particulièrement pour protéger les personnes les plus à risque de mourir de la COVID-19. Ceci est à l’opposé de l’individualisme et de l’égoïsme qui caractérisent souvent les réponses aux crises sanitaires dans les sociétés capitalistes.
Comme ce fut le cas pour les pratiques sexuelles et de consommation de drogues sécuritaires, cette réponse collective nécessite de mener des campagnes d’éducation populaire et d’organiser le soutien communautaire. Bien que le gouvernement et les autorités officielles peuvent encourager de telles initiatives, l’élan doit surtout provenir de la base et beaucoup d’énergie doit y être consacrée. Les premiers groupes de soutien pour les personnes atteintes du VIH/SIDA, les systèmes de parrainage et les premiers efforts initiés par la base afin de combattre l’épidémie du SIDA constituent une bonne source d’inspiration. Dans le contexte de la pandémie actuelle, des réseaux d’entraide et de solidarité ont d’ailleurs été créés et il est nécessaire d’y contribuer. Nous devons être solidaires et aider les personnes tout en respectant la distanciation physique. Il importe aussi d’aider les personnes qui doivent s’isoler. Ces initiatives sont essentielles pour freiner la propagation de l’infection et l’augmentation des morts : à l’échelle mondiale, les prochains mois seront déterminants.
L’accès aux soins de santé pour tous et toutes! — Passer du paradigme des soins par le haut aux soins par la base.
L’accès universel et gratuit au système de santé était au centre du militantisme dans la lutte contre le SIDA. Aux États-Unis, les groupes ACT UP s’organisaient activement autour de cette question. Dans le contexte « canadien » et d’autres gouvernements interventionnistes, les soins de santé étaient plus accessibles, mais des problèmes persistaient (l’accès limité aux citoyen·ne·s, l’absence de couverture pour les médicaments, le coût exorbitant des traitements, l’absence de couverture pour les soins dentaires, etc.). Et, suite aux attaques répétées du néolibéralisme qui ont conduit à la restructuration des services publics et limité l’accès aux soins de santé depuis les années 1980-1990, la situation s’est sérieusement aggravée. Les infrastructures de soins ont été fragilisées et démantelées. Comme le souligne Mike Davis par rapport à l’actuelle pandémie :
« En l’absence d’une infrastructure de santé publique véritablement internationale, la mondialisation capitaliste apparaît comme non viable biologiquement. Mais une telle infrastructure ne peut exister que si la population s’organise afin de briser le pouvoir des multinationales pharmaceutiques et du système de santé à but lucratif »1.
Pour Davis, une transformation importante du système de santé et des politiques sociales est nécessaire à la survie et à la réponse efficace à la pandémie. C’est-à-dire, un accès universel, gratuit à des soins de santé de qualité, un accès gratuit aux tests de dépistage, aux traitements et aux vaccins lorsqu’ils seront disponibles, et un financement public massif à la recherche pour développer les traitements et les vaccins. En s’appuyant sur les approches féministes en santé et sur le militantisme contre l’épidémie du SIDA, ces transformations impliquent aussi de développer des soins de santé contrôlés par la base, qui laissent à la population le contrôle de leur corps et de leur santé, en rupture avec les compagnies pharmaceutiques et le système de santé capitaliste. Il s’agit d’un renversement majeur, d’une santé dirigée par le haut à une santé contrôlée par la base. Michel Foucault a développé la notion de « biopolitique », une forme d’exercice du pouvoir qui, à partir du XIXe siècle, s’approprie non plus seulement les territoires, mais les corps et les populations en tant que ressources mises à la disposition des classes dirigeantes. L’organisation politique à la manière ACT UP a quant à elle développé une forme de « biopolitique » de la base sur laquelle nous devons nous appuyer pour mettre fin à cette pandémie.
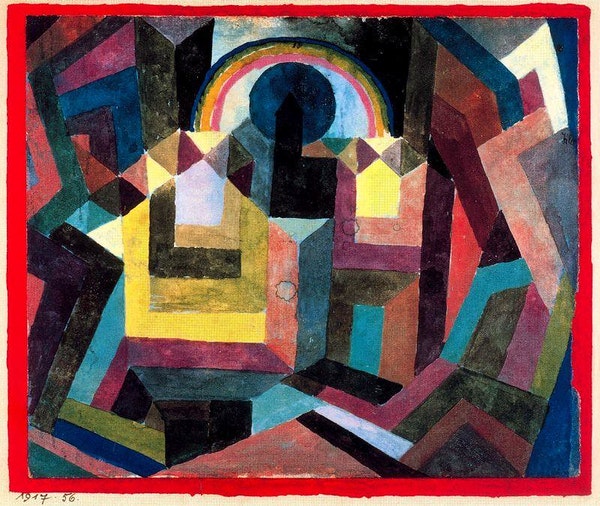
Transférer des ressources vers les pays du Sud
Dans le manifeste de Montréal (publié par ACT UP NYC et AIDS ACTION NOW! dans le cadre de la conférence internationale sur le SIDA tenue à Montréal en 1989), des militant·e·s sur la question du SIDA ont appelé à transférer massivement des richesses et des ressources aux populations du Sud afin de contrer efficacement les ravages du SIDA. Cet appel s’appuyait sur le fait que le sous-développement au Sud est surtout dû au pillage des richesses et des ressources dans le contexte du colonialisme et de l’impérialisme entraînant un « surdéveloppement » au Nord. Il était impossible de combattre l’épidémie au Sud sans les richesses et les ressources des pays riches du Nord. Bien que cet appel ait reçu peu d’écho, il soulevait tout de même un enjeu important.
La situation par rapport à la pandémie actuelle est toutefois un peu différente ; bien que la Chine ait été la première à subir les conséquences du virus, elle semble maintenant être la seule, avec Cuba, à avoir les compétences et les ressources pour venir en aide aux populations d’Iran, d’Italie, d’Iraq, du Venezuela, du Nicaragua et d’autres pays. Ceci constitue la démonstration que le démantèlement des programmes sociaux et du tissu social par le capitalisme néolibéral a compromis la capacité des pays comme les États-Unis et plusieurs autres en Europe à combattre efficacement cette pandémie. Reste que le colonialisme et l’impérialisme sont toujours responsables du « sous-développement » de plusieurs régions du Sud et il est encore nécessaire et urgent d’y acheminer des ressources, richesses et expertises.
Une des avenues pour ce faire est de mettre immédiatement fin aux sanctions contre l’Iran et contre le Venezuela qui complexifient encore plus la gestion de la pandémie dans ces pays. Les sanctions envers Cuba bloquent quant à elles la possibilité pour d’autres pays de se prévaloir des compétences médicales cubaines. Ces sanctions doivent elles aussi être levées. Le contrôle de l’approvisionnement de Gaza et des territoires occupés par Israël met également la survie des Palestinien·ne·s en danger. Israël doit permettre l’acheminement de l’aide internationale afin de ne pas laisser les Palestinien·ne·s mourir.
Le problème avec la distanciation et l’isolement
Les solutions proposées pour contrer la propagation du coronavirus posent plusieurs problèmes. Bien que nécessaires, la « distanciation sociale » (qu’il faut nommer distanciation physique) et « l’isolement social » (qu’il faut nommer isolement physique) peuvent être interprétés d’un point de vue bien individualiste. Il est bien plus aisé de se distancer et de s’isoler pour les personnes qui possèdent beaucoup de ressources matérielles que pour les autres et il importe de tenir compte des enjeux de classe et raciaux qui entrent en jeu. Ces mesures pavent aussi la voie à plus de solitude et à la dépression et elles peuvent amplifier les problèmes de santé mentale des personnes qui ont besoin de contacts fréquents avec les autres. L’« isolement social » avec un·e partenaire abusif·ve contribue à exacerber la violence domestique et la violence envers les femmes, et il est urgent de développer des façons de répondre à ces problèmes. Nous devons aussi reconnaître que l’isolement et la distanciation exigent une importante quantité de travail qui mérite d’être reconnue. Nous devons collectivement organiser le soutien nécessaire à cet isolement et insister sur la pertinence et la nécessité de ce soutien en tant que mesure sociale. Au contraire d’un geste individuel, nous devons considérer ce soutien comme une responsabilité sociale et communautaire. Communiquer fréquemment par téléphone, par courriel ou via les réseaux sociaux pour vérifier que tout va bien ; s’assurer que les courses de tout le monde sont faites et qu’il ne manque rien à personne ; il importe de mettre en place des réseaux d’entraide et de solidarité afin de faciliter ces contacts. Les scènes de chants sur les balcons, en Italie et au Liban, sont des exemples inspirants qui rappellent la possibilité et l’importance de rester en contact. Nous devons constamment nous rappeler que nous sommes collectivement engagé·e·s dans les efforts pour assurer la survie et y trouver du plaisir, de la joie et de l’amusement, partout, et chaque fois que c’est possible.
Refuser l’effacement des mouvements sociaux et l’organisation sociale de l’oubli — reprendre la rue dès que possible.
La « distanciation sociale » est aussi utilisée afin de bannir tout rassemblement public dans les rues et pour mettre fin aux luttes et aux mouvements sociaux. Pendant la crise du SIDA, nous avons combattu toutes les tentatives de nous faire taire, celles qui pensaient qu’en nous laissant tellement accablé·e·s par le deuil nous abandonnerions l’organisation collective. Nous avons résisté en politisant et en organisant la colère, la rage et le deuil, parfois en organisant des funérailles politiques. Toutefois, il était encore possible, pendant l’épidémie du SIDA, d’exprimer publiquement notre réponse sociale et collective, de publiciser le pouvoir de la base par l’intermédiaire d’actions directes. Cette fois, durant la pandémie, ce n’est plus possible.
Les personnes au pouvoir essaient d’utiliser la pandémie pour faire disparaître les luttes sociales et afin de servir leurs intérêts de classe et de race. Bien que nécessaires d’une certaine façon, les déclarations d’état d’urgence accordent des pouvoirs institutionnels qui peuvent être utilisés contre les collectivités et les individus. Nous devons nous rappeler comment les mesures de quarantaine ont été utilisées contre les communautés de personnes les plus affectées par la crise du SIDA dans les années 1980 et 1990.
Cette démobilisation est très claire lorsqu’on prend l’exemple de la lutte des Wet’suwet’en pour la reconnaissance de leur souveraineté et contre les gazoducs et l’implantation de camps de travail ; les luttes des enseignant·e·s en Ontario ; et peut-être plus claire encore dans la lutte contre la réforme néolibérale des retraites et celle, plus large, des Gilets Jaunes, en France. Ces mouvements ne doivent pas s’effondrer, même si cela implique de développer de nouvelles tactiques. Par exemple, la semaine contre l’apartheid israélien (une semaine internationale d’actions et de formations pro-Palestinien·ne·s) a dû être annulée, mais s’est transportée sur les réseaux sociaux. La lutte des Wet’suwet’en se poursuit par téléphone et dans les médias sociaux. Des caravanes et des manifestations de bruits afin de revendiquer la libération des détenu·e·s ont été organisées dans plusieurs villes, parfois même, en simultané. L’éducation populaire se réalise à travers une diversité de médium.
Ces luttes doivent être gardées vivantes et la pandémie doit être une occasion de faire le plus d’éducation populaire possible, à propos de ces luttes et d’autres. En utilisant les médias sociaux comme terrain de lutte, tout en reconnaissant ses limites, entre autres le fait qu’ils ne sont pas accessibles à tou·te·s, encore moins depuis la fermeture des bibliothèques. Internet et les médias sociaux doivent être utilisés comme des espaces de mémoire, de diffusion et de production d’analyses critiques. Il ne faut pas permettre qu’on nous fasse oublier les luttes dans lesquelles nous étions engagé·e·s avant la pandémie ni les apprentissages qui seront tirés de l’expérience du confinement et de la pandémie, et qui confirment la nécessité de se débarrasser du capitalisme et de transformer radicalement la société. Lorsque la situation le permettra, il faut se rassembler à nouveau massivement dans les rues afin de poursuivre, d’intensifier et de lier les luttes pour la justice et la dignité, à la sagesse nouvellement acquise pendant la crise.
Traduction par Valérie Simard.
Article paru en anglais sur le site Radical Noise sous le titre Some Notes on Learning from AIDS Activism for our Responses to the Coronavirus (COVID-19) Pandemic (18 mars 2020).
Les illustrations appartiennent au domaine public.
NOTES
1. Mike Davis, Covid-19: Le monstre est à la porte, traduit de l’anglais par R.D.R Cahen, Parti des Indigènes de la République, 14 mars 2020. http://indigenes-republique.fr/covid-19-le-monstre-est-a-la-porte/↩
2. The AIDS Activist History Project : https://aidsactivisthistory.ca/
3. ACT UP (NYC) et AIDS ACTION NOW! (Toronto) The Montreal Manifesto, https://aidsactivisthistory.omeka.net/items/show/67
4. Richard Berkowitz et Michael Callen, How to Have Sex in an Epidemic : One Approach, News From the Front Publications, 1983.
5. Mike Davis, « In a Plague Year », Jacobin, 14 mars 2020 : https://jacobinmag.com/2020/03/mike-davis-coronavirus-outbreak-capitalism-left-international-solidarity
6. Nick Dyer-Witheford, Cyber-Marx : Cycles and Circuits of Struggle in High-Technology Capitalism, Champaign, Illinois, University of Illinois Press, 1999.
7. Michel Foucault, History of Sexuality : Volume One, An Introduction, New York, Vintage, 1980.
8. Gary Kinsman, The Regulation of Desire : Homo and Hetero Sexualities, Montreal, Black Rose, 1996.
9. Gary Kinsman, « Managing AIDS Organizing : ‟Consultation,” “Partnership,” and “Responsibility” As Strategies of Regulation » dans Organizing Dissent : Contemporary Social Movements in Theory and Practice, édité par William K. Carroll, deuxième édition, Toronto, Garamond, 1997, pp. 213-239.
10. Gary Kinsman, « AIDS Activism : Remembering Resistance versus Socially Organized Forgetting » dans Seeing Red, HIV/AIDS and Public Policy in Canada, édité par Suzanne Hindmarch, Michael Orsini et Marilou Gagnon, Toronto, University of Toronto Press, 2018, pp. 311-333.
11. Gary Kinsman et Patrizia Gentile, The Canadian War on Queers, National Security as Sexual Regulation, Vancouver, University of British Columbia Press, 2010.
12. Eric Mykhalovskiy et George W. Smith, Hooking up to social services : A report on the barriers people living with HIV/AIDS face assessing social services, Toronto, Community AIDS Treatment Information Exchange, 1994.
13. Ontario Coalition Against Poverty, « Rapid & Dramatic Shelter and Drop-in Expansion Necessary », 18 mars 2020 : https://ocap.ca/covid-19-homeless-response/
14. Cindy Patton, Sex and Germs : The Politics of AIDS, Montreal, Black Rose, 1986.
15. Cindy Patton, Inventing AIDS, New York et London, Routledge, 1990.
16. Panagiotis Sotiris, « Is a Democratic Biopolitics Possible » The Bullet, 14 mars 2020 : https://socialistproject.ca/2020/03/is-a-democratic-biopolitics-possible/#more


