06 Juin Vivre en féministe – Extrait
Par Sara Ahmed
Publié le 6 juin 2024
Parue en mars dernier aux Éditions de la rue Dorion, la version francophone de Living a Feminist Life de Sara Ahmed propose une réflexion au quotidien sur les implications politiques, sociales et professionnelles de vivre sa vie comme féministe. À partir de son récit personnel, des anecdotes et des recherches principalement menées par des chercheuses racisées, l’autrice rapporte les contradictions, les heurts mais aussi les joies collectives du « vivre en féministe ». On retrouve dans ce livre des idées centrales du travail de Sara Ahmed, comme le concept de « féminisme rabat-joie » (feminist killjoy) et sa critique du milieu académique qui a tiré un certain profit des politiques de diversité et d’inclusion, sans ébranler les assises de l’exclusion et la domination dans l’institution universitaire.
C’est d’ailleurs sur ce sujet qu’on la retrouve dans cet extrait du chapitre Des murs de brique. Elle porte ici un regard sur la blanchité des milieux universitaires dits « critiques », mais aussi sur celles et ceux qui les composent et qui balayent trop souvent les accusations de racisme ou de sexisme du revers de la main parce que celles-ci seraient « identitaires ». L’analyse proposée dans cet extrait démontre que personne n’échappe aux structures de domination qui permettent au cadre universitaire de se maintenir intact et donne à voir, qu’au-delà des mots et des idées défendues, les universitaires de gauche participent aussi édifier le « mur de briques » qui empêchent les femmes et les personnes racisées d’y accéder. – A.B.
La blanchité : réassemblée, brique à brique.
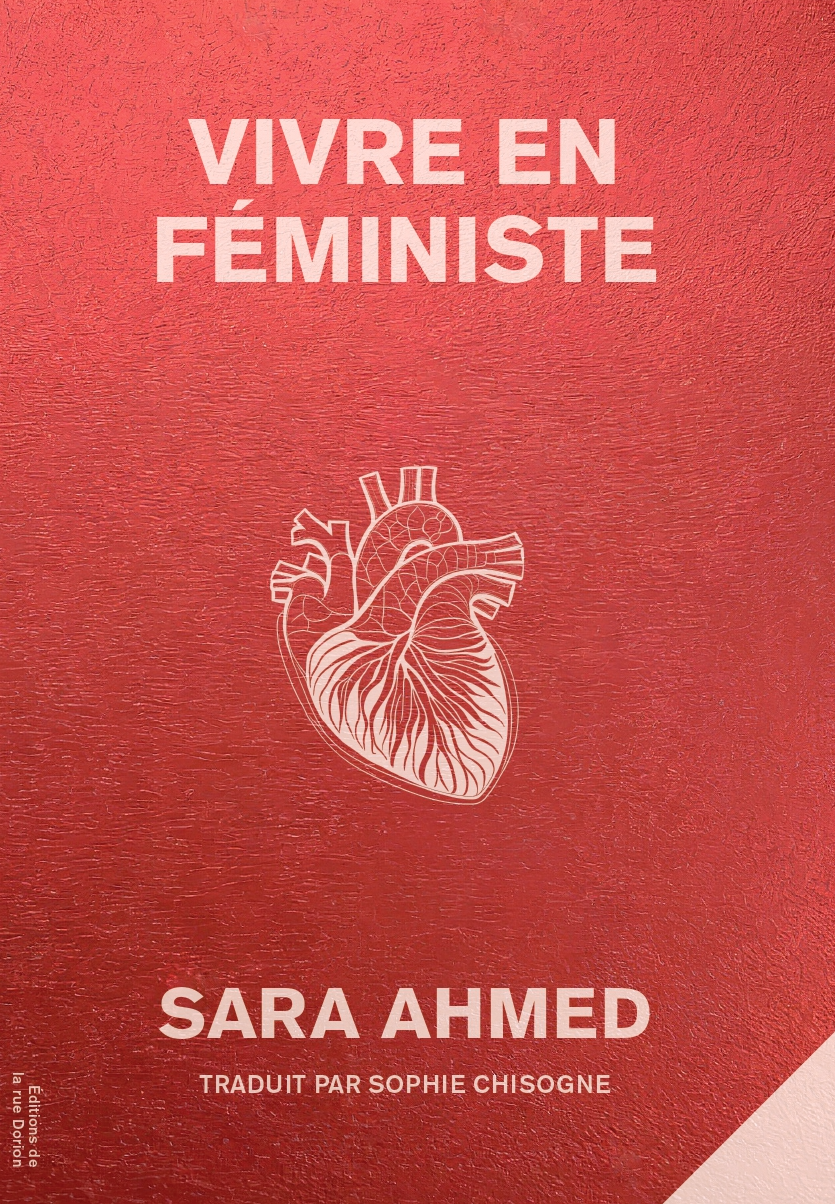
Comme je l’ai déjà mentionné, nous pointons des structures quand nous montrons que seuls certains corps sont invités à intervenir dans un colloque. Le fait de pointer une structure est interprété comme un recours à l’identité. Nous assistons peut-être à un effacement de la structure sous l’identité, non pas du fait des personnes qui prennent part à ce qu’on appelle les revendications identitaires, mais de celles qui se servent des revendications identitaires pour décrire la scène où se produit un engagement. Ou, pour reformuler cet argument avec plus de force, c’est comme si tout ce que vous faisiez en pointant une structure se résumait à projeter votre identité sur la situation, comme si, en nommant les absences, vous ne vous souciiez que de la vôtre. La généalogie des hommes blancs est protégée par le présupposé selon lequel toute personne qui conteste cette généalogie est obsédée par elle-même. C’est ironique, en fait – ou peut-être pas : vous n’avez pas besoin de vous affirmer quand la généalogie le fait pour vous. Remarquez aussi que les deux sens du travail de diversité s’embrouillent, ici : comme si vous agissiez pour la diversité à travers le simple fait que vous êtes la diversité, puisque tout ce que vous faites consiste à être une personne racisée ou une femme préoccupée de sa propre exclusion (ou les deux; être les deux, c’est être beaucoup trop).
Cet extrait est tiré de l’ouvrage Vivre en féministe de Sara Ahmed, une traduction de Sophie Chisogne publiée aux Éditions de la rue Dorion. La publication de cet ouvrage est le fruit d’une collaboration avec les éditions Hors d’Atteinte, à Marseille, où l’ouvrage paraît sous le titre Vivre une vie féministe.
NOTES
a. Pour une analyse approfondie de ce problème et des exemples précis d’assimilation, par des féministes, du sexisme à un automatisme ou à une mauvaise habitude féministe, voir Sara Ahmed, « Introduction: Sexism — a Problem with a Name », New Formations, no 86 (2015), p. 5-13.
1. Sara Ahmed, On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life, Durham : Duke University Press, 2012 (ouvrage non traduit).
2. Sarah Franklin, « Sexism as a Means of Reproduction », New Formations, no 86 (2015), p. 14-33.


