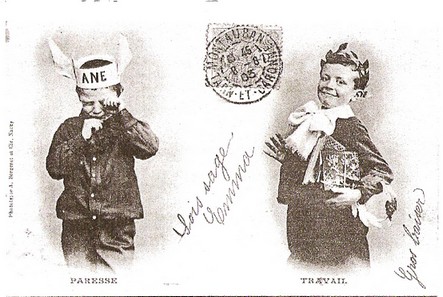
24 Mai Rupture de la dialectique : lutte contre le travail, crise financière et plus encore
Par HUGO DORGERE
Publié le 21 juin 2021
Repartir comme en quarante alors que le monde est aux prises avec une pandémie qui frappe cruellement les classes laborieuses, à la santé plus fragile et en première ligne sur le front du travail. Continuer de s’adresser à un gouvernement de forcené·e·s que l’un des mouvements populaires les plus puissants de notre génération, les Gilets jaunes, n’a pas fait bouger d’un iota. Croire par habitude insufflée que le sacrifice symbolique de la grève va suffire à mobiliser des gens happés par la précarité et la maladie. Il semblerait bien que ce soit la stratégie de la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU), Solidaires, la Confédération nationale des travailleurs (CNT), La Confédération Nationale des travailleurs et solidarité ouvrière CNT-SO et l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) qui se sont réunis en intersyndicale, dont on se demande bien quels sont ses objectifs, à part de persévérer dans leur être institutionnel, quitte à se satisfaire de petits monopoles de la contestation. La journée de mobilisation professionnelle du 4 février aura été une énième démonstration d’impuissance car elle a échoué à rassembler au-delà du militantisme traditionnel. Cela dit, elle aura au moins eu le mérite d’évoquer le terme de la précarité et d’être en phase avec la terrible situation que vivent les étudiant·e·s et qui en poussent certain·e·s vers le suicide. C’est un peu mieux que les organisations syndicales enseignantes qui ont réagi bien après le rendu des conclusions du Grenelle de l’Éducation, une mascarade bureaucratique organisée par notre ministre Jean-Michel Blanquer. -HD
Dans l’indifférence la plus totale, les enseignant·e·s ont défilé dans les rues le 26 janvier pour revendiquer une revalorisation de leurs salaires et l’élaboration d’un protocole sanitaire plus adapté. Cette journée n’avait pas commencé qu’elle était déjà morte, car elle se déroulait dans un autre espace-temps où la bourgeoisie s’inquiétait encore du nombre de réfractaires descendant dans les rues. Il faut le redire, mais ce mode d’action est complètement démonétisé et s’apparente à un rituel avec sa liturgie propre : les chasubles colorées, les bannières tenues à bout de bras, les slogans (« stop au mépris », « du pognon pour l’éducation », etc) et les camions musicaux avec les mêmes playlists qui tournent depuis vingt ans. Tout se déroule dans le périmètre fixé par l’État et les organisations syndicales (surtout ne pas en sortir!) et des escadrons de CRS qui escortent les enseignant·e·s jusqu’au rectorat puis les regardent se disperser, un peu goguenards. J’ai moi-même participé à des dizaines de manifestations de ce genre et jamais je ne me suis autant ennuyé que dans les cortèges syndicaux puisqu’il ne s’y passe jamais rien. La vie en étant absente, nous marchons, cornaqué·e·s par les forces de police ou les services d’ordre, vers la destination qui a été choisie arbitrairement par les organisations puis nous repartons sans nous être rencontré·e·s. Pour couronner le tout, cela dure de trop longues heures et je me dis que ce temps pourrait être employé ailleurs, à tisser les liens dont nous avons désespérément besoin. Combien de personnes se sont détournées de la lutte en voyant ce spectacle de résistance si peu désirable? Et surtout pourquoi perdre une journée de travail pour une revalorisation que l’on n’aura jamais?
Reposons l’état du rapport de force pour comprendre dans quelle impasse la communauté éducative se trouve si elle se contente de jours de grèves isolés. Le gouvernement Macron est resté insensible aux revendications des Gilets jaunes, un mouvement populaire exceptionnel, soutenu par des millions de français·e·s, qui souhaitait une moralisation de l’économie en faveur des plus pauvres et la participation du peuple à la vie politique. Il n’a pas non plus beaucoup bronché pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, pourtant portées par les secteurs les plus combatifs du salariat, les cheminots et la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Après avoir consacré l’héroïsme des soignant·e·s pendant la première vague du Covid-19, il reste sourd aux signaux d’alarme sur la situation désastreuse des hôpitaux publics, qui manquent cruellement d’effectifs et de moyens et qui ont continué de supprimer des lits alors que la pandémie faisait rage. Voilà donc à qui nous demandons une revalorisation, à un gouvernement qui ne reviendra pas sur son dogme d’austérité budgétaire (faire plus avec moins pour améliorer les performances) au risque d’établir un précédent potentiellement exploitable. Confronté à la contestation, Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l’Éducation nationale, suivant la ligne autoritaire de son gouvernement, n’a pas hésité une seule seconde à sanctionner les kidnappeurs et les kidnappeuses de copies pendant le mouvement contre sa réforme en 2019, ni à museler la liberté d’expression de ses enseignant·e·s· avec sa très orwellienne loi pour une école de la confiance. Mais le problème ne se résume pas à Blanquer ou à un gouvernement en particulier, il dépasse ce cadre-là et tient aussi au fait que ceux qui prétendent nous organiser partent d’un certain nombre de présupposés qui relèvent du mirage et se refusent à penser l’école en dehors d’un cadre étatiste bien délimité.
Dans cette perspective, l’école publique serait en quelque sorte une propriété collective œuvrant pour l’intérêt général qui aurait été dévoyée ou abîmée par des administrateurs mal intentionnés. Entre de bonnes mains, elle pourrait éduquer les citoyen·ne·s sans faire de distinction entre leurs origines et rendre de grands services à la nation. Un livre récemment publié s’inscrit dans cette tendance qui nous mène à la défaite et à l’impuissance, Le fiasco Blanquer, écrit par Saïd Benmouffok, un professeur de philosophie, aujourd’hui conseiller éducation d’Anne Hidalgo au Parti socialiste. Condensé très précis de l’action du ministre, il induit son lecteur et sa lectrice en erreur en lui faisant croire que Blanquer est un fiasco parce qu’il se comporte de manière autoritaire et cherche à soumettre l’école aux lois du marché. C’était un peu comme si le ministre rompait un pacte non écrit dans lequel il s’était engagé à respecter une certaine vision de l’école républicaine. Sauf que Blanquer n’est pas simplement un « techno »1 de droite, mais bien un bourgeois lui-même, issu d’une classe prédisposée à réussir, pour laquelle il reconfigure l’école sans changer sa nature profonde. En concentrant sa critique sur les réformes de Blanquer, Benmouffok limite singulièrement sa pensée et produit une étude d’insider plutôt étouffante dont la seule issue serait cette reconstruction qu’il propose d’opérer en fin d’ouvrage. Une sorte de thérapie douce dispensée par une bourgeoisie du Parti socialiste, qui ferait de l’école une sorte de sanctuaire à l’abri de la logique marchande, où l’on apprendrait à nos enfants à devenir des citoyen·ne·s. Il n’est guère étonnant de voir des membres de la classe dominante se mobiliser autant pour le contrôle d’une institution qui est un formidable outil de pacification des dominé·e·s.
Jules Ferry, notre saint républicain, l’ancêtre totémique de Blanquer, n’avait pas manqué de nous prévenir. Quand il a établi l’école laïque, gratuite et obligatoire en 1881-1882, ce n’était pas pour émanciper les masses, mais bien pour consolider la puissance encore fragile de la République française. Devant le Conseil général des Vosges en 1879, il fera la déclaration suivante :
Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. […] Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d’autres écoles ne se constituent, ouvertes aux fils d’ouvriers et de paysans, où l’on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d’un idéal socialiste ou communiste emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 24 mai 18712.
Loin d’être un « bouffeur de prêtres » (anticlérical), Ferry tenait néanmoins à ce que son école soit protégée de l’influence de la religion et initia un processus qui donnera à l’État ce qu’Ivan Illich appelait un monopole radical sur l’éducation. Il fait peser sur les parents une obligation de scolarisation qui les incitera à confier leurs enfants au système éducatif étatique, indépendamment du fait qu’il délivre des savoirs conséquents ou pas. Mais en dehors de l’école, point de salut, car c’est elle qui délivre des titres valorisés permettant l’accès au marché du travail. Cette prise d’otage en douceur permet à l’État de façonner les esprits de générations entières auxquels les fameux hussards noirs de la République, les instituteurs, vont inculquer l’amour de la patrie, le goût du travail et la soumission à l’autorité. Le souvenir de la Commune est encore frais dans l’esprit de celui que les Parisien·ne·s, du temps où il était maire de Paris, surnommaient Ferry-Famine pour ses restrictions alimentaires très dures. Au cœur des préoccupations du ministre se trouvait la nécessité d’empêcher les mouvements socialistes et anarchistes en plein essor à l’époque de propager leurs idées au sein de la jeunesse et de clore l’ère des révolutions3. Entre les mains de Ferry, l’école devient donc un organe de propagande : il habitue dès l’enfance à l’obéissance aux supérieur·e·s, aux bureaucrates, à la hiérarchie et vise à déjouer les insurrections avant qu’elles ne se produisent pour que la propriété bourgeoise ne soit pas menacée par une nouvelle Commune. Cette institution n’avait pas de nécessité à naître, en dehors des désirs de la classe bourgeoise, qui en plus de cela, désirait produire à la fois une main-d’œuvre qualifiée et une chair à canon suffisamment instruite et endoctrinée pour reprendre l’Alsace et la Lorraine aux Prussien·e·s.

Faisons un grand écart et revenons à notre époque, avec Blanquer, le meilleur ennemi d’un Parti socialiste moribond. Aujourd’hui, nous assistons non pas à une transformation de l’école mais à sa reconfiguration pour satisfaire les desseins de notre bourgeoisie acquise à la start-up nation. Et cette dernière voudrait bien débarrasser l’école de ses oripeaux étatistes, de ces extranéités à l’ordre marchand encore trop nombreuses à son goût : le statut du fonctionnaire, la gratuité de son savoir, sa liberté pédagogique, sa liberté d’opinion vis-à-vis de l’institution, les vacances scolaires, le bac, les organisations syndicales… Autant d’archipels qui pourraient faire naître chez les élèves ou les personnels des idées radicales. C’est bien peu, mais c’est déjà trop. En outre, les éditocrates rabâchent depuis des lustres que l’autorité est régulièrement foulée aux pieds, en particulier dans les établissements situés dans les fameux « territoires perdus de la République », concept-bannière des islamophobes de tout bord. En 2017, Jean-Michel Blanquer, alors directeur de l’École supérieure des sciences économiques et sociales (ESSEC), bastion de la reproduction sociale, pense qu’il est l’homme de la situation et envoie à tous les candidat·e·s à la présidentielle son livre L’école de demain dans l’espoir que l’un·e du groupe lui accorde le poste de ministre.
Dans cet ouvrage, il propose un modèle pour remanier l’école pour qu’elle acclimate le plus tôt possible les corps et les esprits à l’idéologie entrepreneuriale. Il préconise donc la généralisation d’un fonctionnement contractuel au sein duquel le ou la chef·fe d’établissement endosse pleinement le costume du manager des ressources humaines. Cette personne sera chargée de faire miroiter des augmentations aux enseignant·e·s qui font le plus réussir les élèves et une agence extérieure évaluera chaque école, collège ou lycée en fonction des résultats des équipes éducatives4. Ces notations pourront être consultées par les parents qui ensuite auront la liberté de choisir l’établissement le plus adapté à leur progéniture. Aucune ambiguïté ici ; le ministre ambitionne de plonger les parents et leurs enfants dans les eaux glacées du calcul égoïste, selon la formule consacrée par Marx, et de les constituer en individus libres de contracter où leur désir les porte. Pour les néolibéraux, cette mise en concurrence des êtres à tous les niveaux possède quelque chose de salutaire, de vivifiant. Elle permet de valoriser les employé·e·s et les institutions les plus performantes, autrement dit, ceux et celles qui acceptent de se soumettre ou de fabriquer de la soumission pour le compte des grands argentiers de notre pays. Une de ses principales vertus aux yeux de ses défenseurs et défenderesses, c’est de laisser sur le carreau les gens qui n’auront pas voulu ou su s’adapter, ceux qui ne sont rien. Heureusement, nous ne sommes pas encore à cette étape de l’organisation dystopique du darwinisme social, mais au vu des conclusions rendues par le Grenelle de l’éducation, il y a de quoi s’inquiéter.
L’esprit de ce projet fait beaucoup penser à ce que Johann Chapoutot met en lumière dans son ouvrage Libres d’obéir, le management du nazisme à aujourd’hui, notamment sur le rôle que l’État devait jouer dans le Grand Reich. Contrairement à ce que beaucoup croient, les nazis abhorraient l’État, le voyant comme une imposition étrangère sur la liberté germanique et désiraient réduire son rôle au minimum, pour que sa lourdeur ne musèle pas les forces vives de la nation, engagées dans une lutte historique pour la suprématie biologique. Cette compétition de « tous contre tous », entre une multitude fourmillante d’agences et d’organes de pouvoir, avait pour but de faire triompher les initiatives des plus performantes. Si Blanquer n’est pas un nazi, il puise dans les mêmes sources idéologiques qu’eux. Son rêve est de léguer à la bourgeoisie un système éducatif flexibilisé, ouvert à la rapacité entrepreneuriale, aux établissements en concurrence perpétuelle les un·e·s avec les autres, qui sélectionnerait les meilleur·e·s (les prédisposé·e·s à gouverner). Cette fabrique de l’élitisme se trouverait sous la férule de managers autonomes, spécialistes du recrutement et de l’évaluation, qui gouverneraient d’une main de fer gantée de velours. Il va sans dire que cette vision infernale de l’école, quasi kafkaïenne, n’a pas suscité l’unanimité dans la communauté éducative et que le pouvoir de Blanquer s’est vite retrouvé face à des limites, à ce que les êtres humains qui évoluent dans l’institution tiennent pour inacceptables.
À l’image de son gouvernement, Blanquer ouvre des fronts multiples pour prendre de court ses adversaires, les organisations syndicales. Prisonnières de l’appareil étatique, celles-ci n’arrivent pas et/ou ne souhaitent pas entrer dans une confrontation avec le ministre qui mettrait en péril leur place. Face à un projet aussi totalisant, qui renforce les déterminismes sociaux et cherche à produire des employé·e·s dociles pour les start-ups de demain, il n’est pas suffisant de se déclarer contre sa réforme et de s’appuyer sur l’existant. Nous sommes trop enclins à nous laisser enfermer dans les calendriers gouvernementaux sans produire de propositions suffisamment conséquentes, adressées à un public plus large que la simple base militante. De plus, la bureaucratie syndicale a tendance à se reposer sur des tactiques remontant aux grèves de 1995, qui consiste à organiser des « temps forts » pour faire monter la pression sur le gouvernement, en pariant sur l’augmentation du nombre de manifestant·e·s dans les rues. Force est de constater que depuis une vingtaine d’années, les politiques ont su trouver des parades face à la contestation, combinant propagande médiatique, répression féroce et mesures législatives pour rendre les grèves les moins efficaces possible (par exemple, le service minimum dans les transports). De son côté, l’intersyndicale, timide et fracturée, victime de l’inexorable décrue des adhésions, se révèle incapable de répondre aux demandes d’efficacité de sa base, se condamnant à un éternel repli. Cette configuration s’est mainte fois reproduite et c’est sur l’une de ces itérations que je voudrais me pencher, car elle présente une certaine singularité riche d’enseignements pour ceux et celles qui rêvent d’un en dehors à l’Éducation nationale.
La réforme du lycée de 2018 lancée par Blanquer intervenait dans un contexte politique brûlant. L’année avait été marquée par le mouvement des Gilets jaunes, une révolte populaire sans précédent, en dehors des partis et des syndicats, dont le nombre de participant·e·s reste encore à chiffrer. Le gouvernement ressortit ébranlé de cette séquence politique qui démontra que le concept de lutte des classes était loin d’être daté. En effet, ce conflit opposa des gens qui n’avaient plus assez d’argent pour terminer le mois et une bourgeoisie qui fit bloc pour les juguler. Pourquoi les mentionner ? Et bien, c’est que l’impact de ce soulèvement a été ressenti jusque chez les personnels de l’Éducation nationale puisqu’un collectif de profs en colère, les Stylos rouges, se forma sur Facebook notamment autour d’un slogan : « salaires-moyens-respect ».
Il faut dire que Blanquer représente tout ce que la communauté éducative déteste, au cours de sa carrière sous Sarkozy, il s’est distingué par des coupes budgétaires drastiques, 80 000 postes d’enseignant·e·s supprimés entre 2007 et 2012 mais aussi par un désir frénétique, obsessionnel de noter les jeunes êtres qui seront évalués ad nauseam. Sous le mandat de Macron, ce sont les écoles primaires qui firent les frais en premier de sa boulimie réformiste avec le dédoublement des classes de CP (Cours préparatoire) qui correspond en France à la toute première année des élèves après la maternelle, souvent déterminante pour leur avenir scolaire. Cette mesure s’applique dans les établissements REP ou REP+ (Réseaux d’éducation prioritaire) qui accueillent les enfants des milieux défavorisés. Le ministère a relevé qu’en dépit des dispositifs d’accompagnements mis en place au sein de ces réseaux, les élèves maîtrisaient toujours mal les fameux savoirs fondamentaux: lire, écrire, compter. Présenté comme une franche réussite, une réalisation sur le terrain d’un idéal de justice sociale, le dédoublement consiste simplement à fixer une limite de douze élèves par classe de CP pour qu’ils et elles apprennent dans de meilleures conditions mais cela s’est fait sans la moindre création de postes. Blanquer s’est contenté de puiser dans un pool d’enseignant·e·s déjà engagé dans d’autres missions, ce qui a eu pour effet de surcharger les classes ailleurs. Néanmoins, ce n’est pas ce coup marketing inepte qui poussera la communauté éducative dans ses retranchements mais bien la réforme du lycée général et professionnel.
Sans trop m’attarder dessus, je vais essayer de résumer ici à quoi œuvrait Blanquer avec cette réforme. Première étape de la contractualisation de l’Éducation nationale, elle sonnera le glas du caractère national du bac et soumettra les élèves à un tri social encore plus rude, organisé par l’algorithme de Parcoursup. En voici donc les principaux axes :
Les anciennes filières de la voie générale du lycée (baccalauréats littéraire (L), économie et social (ES) ou scientifique (S)) disparaissent pour laisser la place à des spécialités à la carte (mathématiques, histoire géographie, physique-chimie, humanités, littérature et philosophie, etc.), librement choisies par les élèves. Le déroulement du bac est considérablement changé ; le contrôle continu (c’est-à-dire, les évaluations au cours de la formation) compte pour 40% de la note globale et il y a seulement quatre épreuves terminales (philo, un grand oral/entretien d’embauche et deux spécialités). Cette transition d’un cadre national vers un certain localisme enchaîne davantage les élèves à leurs territoires. Ainsi la mobilité sociale des enfants du prolétariat est considérablement réduite puisqu’un bac obtenu dans un lycée de banlieue sera considéré de manière officieuse comme ayant moins de valeur qu’un bac d’un établissement de centre-ville. Quant aux spécialités, elles favorisent la liberté de choix des êtres nés dans les bonnes conditions, certaines ne sont d’ailleurs accessibles que dans des établissements bien spécifiques ; lieu de rencontre de la minorité qui se prépare à gouverner.
Pour ce gouvernement, il est impensable de créer de nouvelles places à l’université, voire même d’aider à son développement, il faut donc tarir les flux de nouveaux étudiant·e·s en mettant un glacis social sur leur route, la plateforme d’orientation Parcoursup. Les élèves de familles prolétaires sont ainsi les plus démunis face à l’injustice algorithmique de l’orientation, ils et elles sont peu accompagné·e·s dans leur prise de décision, ont tendance à s’auto-censurer, en particulier les filles et subissent de plein fouet la violence symbolique de la sélection sociale5. Les lycéen·ne·s issu·e·s de la bourgeoisie, qui convoitent les filières les plus sélectives, ont des stratégies éducatives bien rodées. Ils et elles vont candidater pour des formations très sélectives susceptibles de les rejeter et donc par sécurité, vont aussi émettre des vœux pour des formations moins prestigieuses, qui sont elles très demandées par les classes populaires. Histoire de ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais l’on est refusé·e à Science Po Paris, un institut d’études politiques, synonyme de triomphe scolaire. Pendant ce temps, les autres sont placé·e·s sur liste d’attente, doivent patienter en attendant que les mieux classé·e·s qu’eux libèrent des places. Parfois, ils et elles ne reçoivent jamais l’orientation demandée et doivent se contenter des filières où personne ne veut aller. Il s’agit ici d’amplifier un phénomène déjà bien installé.
Cette réforme, taillée sur mesure pour la bourgeoisie, provoque une rupture profonde avec les enseignant·e·s, pour la plupart attaché·e·s au diplôme du bac, perçu comme une institution républicaine, un rite de passage à la vie adulte et une garantie contre l’arbitraire de la naissance. Elle vient s’ajouter à toute une série de griefs que nourrit la profession depuis des années à l’encontre des décideurs et des décideuses : le gel délibéré des salaires, l’augmentation des tâches administratives au détriment de l’enseignement, l’imposition d’une culture de l’évaluation et du résultat et le sentiment d’une perte de prestige importante, intensifiée par l’afflux toujours plus haut de contractuels.
La grève des surveillances du bac, annoncée par l’intersyndicale en 2019, est une initiative inédite dans l’histoire des mobilisations de professeur·e·s. Soit ils et elles sont trop pétri·e·s de bonne conscience professionnelle pour oser boycotter un examen, soit les syndicats, effrayés par ce mode d’action hors-cadre, décident de les contrecarrer comme ce fût le cas en 1929 avec le Syndicat national de la CGT6. Cependant, cette fois-ci, le ministre est obligé de danser au rythme des grévistes et fait des pieds et des mains pour trouver des briseurs de grève, n’importe qui fera l’affaire, des enseignant·e·s à la retraite, des cadres administratifs ou des étudiant·e·s. Des fonds sont débloqués en urgence pour faire face à la crise et sauver l’honneur de Blanquer, qui fait la tournée des médias pour minimiser l’ampleur de l’affaire. La grève est un échec mais devant le relativisme méprisant du ministre, les professeurs mobilisés veulent aller jusqu’au bout et faire de la rétention de copies. Il est difficile de savoir à quel point les directions syndicales y étaient opposées mais plusieurs choses sont certaines, elles sont dépassées par leur base qui veut aller au bras de fer et craignent de voir les Stylos rouges occuper le devant de la scène contestataire. Ces dernier·e·s militent depuis la rentrée 2018 en faveur de la rétention de copies et ont prospéré sur la méfiance des syndicats de plus en plus répandue, même chez les profs. Les dés sont donc jetés et, selon France Info, au moins 120 000 copies sont retenues sur un ensemble de 4 millions7.
Nouveau branle-bas de combat au ministère : Blanquer tempête sur toutes les antennes et Macron compare les grévistes à des preneurs d’otages, presque des terroristes. L’usage de cette rhétorique ordurière masque à peine la hauteur des enjeux, la crédibilité de Blanquer est sur la table et pour la sauver, il est prêt à toutes les bassesses. Il se répand en menaces, promet qu’il sanctionnera très sévèrement les réfractaires et cette intransigeance pathétique impressionne les profs, peu habitué·e·s à l’âpreté de la lutte et effrayé·e·s à l’idée d’être placardisé·e·s ou de perdre leurs titres. Finalement, un noyau dur tient bon mais Blanquer, campé sur ses positions, publie les résultats alors que toutes les notes ne sont pas disponibles. Prenons un peu la mesure de l’arrogance ridicule de cet oligarque prêt à tout pour sauver son honneur.
Ce passage en force crée des situations ubuesques parmi les jurys du bac, qu’on invite fermement à compléter les notes qui manquent, en additionnant des moyennes ou en se basant sur d’autres matières. Certain·e·s refusent d’obtempérer ou se dédisent devant une rupture d’égalité aussi manifeste. Si Blanquer parvient à mettre l’opinion publique de son côté en faisant jouer tous ses réseaux médiatiques, c’est une victoire sans lendemain. Sa figure autoritaire cristallise toutes les hostilités et on ne lui pardonne pas d’avoir profané la dépouille du bac. Néanmoins, le vent de panique qui a soufflé rue de Grenelle et la pagaille qui s’en est suivie démontrent que la rétention de notes a une efficacité politique indéniable et qu’il serait peut-être pertinent d’en généraliser le recours.
Aussi audacieux et réellement courageux que j’aie connu des profs, je n’en ai jamais vu un seul qui ne notait pas au moins au moment du bulletin. Ne pas noter est la prise de position la plus radicale qui se puisse concevoir et c’est la raison pour laquelle tout le monde note parce que personne n’est radical. La structure, c’est la note. Les élèves sont notés par les profs, les profs sont notés par l’administration de l’établissement et les inspecteurs, l’administration de l’établissement et les inspecteurs sont notés par leur hiérarchie la hiérarchie est notée par le ministre à l’intérieur du ministère tout le monde est noté. Le pays France est lui-même noté8.
Dans ce passage de son livre Un hamster à l’école, Natalie Quintane attire notre attention sur l’un des rouages de la gouvernance capitaliste : la capacité de valoriser les choses, les êtres, les institutions ou les états qui se conforment au désir-maître. Cet étiquetage arbitraire a pour but de créer une illusion d’objectivité dans laquelle il serait question de mérite et d’équité entre les élèves.
Sauf que depuis l’étude sociologique de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, nous savons que les rejetons des accumulateur·e·s de richesses sont prédisposé·e·s à être les grand·e·s vainqueur·e·s de cette course aux titres scolaires. Tristes triomphes de ces jeunes enfants sélectionné·e·s pour dominer leurs camarades moins performant·e·s, que l’on décrit dans les bulletins avec quantités d’euphémisme : ensemble fragile, faible, doit se remettre au travail, cherche un sens à sa scolarité, etc. C’est que la note a pour fonction d’acclimater les corps et les esprits à l’évaluation, elle est le héraut de la logique marchande et/ou de l’autorité travestie. Si les évaluateurs et les évaluatrices font en général partie de l’encadrement ou de la bourgeoisie, tout le monde est invité à participer à cette grande évaluation du monde, nous pouvons même nous auto-évaluer et participer ainsi notre propre exploitation. De la note du prof à la review d’un livreur sur Delivroo, il n’y a qu’un petit fossé à franchir. Malheureusement, tout ceci relève encore du domaine de l’impensé politique et beaucoup continuent de faire des simagrées méritocratiques autour du système de notation.
Nombre de profs s’y accrochent encore, car il y a une grande illusion sur notre métier, un secret de polichinelle pas bien difficile à percer, mais qui peut parfois devenir source de dissonance, de malaise, surtout chez les enseignant·e·s en difficulté. Nous sommes convaincu·e·s que l’essentiel de notre travail se déroule dans la classe, à transmettre un savoir qui sera évalué de manière objective, démocratique, sous l’œil d’un arbitre fair-play. Mais nous ne faisons que valider la domination des prédisposé·e·s à performer scolairement et ce faisant, nous produisons une quantité absurde de notes, d’appréciations, de bulletins, de mots, de rapports, de relevés, de livrets de compétences et j’en passe. Et pendant les grèves, nous partons sans couper la machine, nous continuons de faire tourner la chaîne de production. Moi le premier, j’ai accumulé une quinzaine de jours de grève pendant la mobilisation contre la réforme des retraites et, en même temps, je remplissais doctement Pronote, le logiciel de contrôle social. Incontestablement, il aurait fallu débrancher la machine et laisser les managers d’âmes gérer le vide, le néant sur lequel est bâtie l’institution.
Soyons irréalistes et imaginons une seconde leur terreur si jamais l’ensemble des professeur·e·s renonçait à noter, à apprécier et à valoriser. J’imagine déjà le tollé médiatique, la fureur des thuriféraires du capital, les vitupérations des rectorats, les rodomontades menaçantes de Jean-Michel sur BFM-TV…. Bien entendu, tout cela relève du vœu pieux mais si au moins un tiers des enseignant·e·s s’y mettaient, cela produirait des effets politiques assez dantesques. Peut-être une contagion. Il suffit de voir à quel point l’administration s’est cabrée en 2019 pour comprendre que la seule sortie possible de l’école de Jules Ferry, c’est une grève générale des notes, combinée à une reconductible. Mais les enseignant·e·s mobilisé·e·s sont-ils et sont-elles prêt·e·s à renoncer à leur posture symbolique de résistance, à mettre leurs titres en jeu pour créer un mouvement de cette ampleur ?
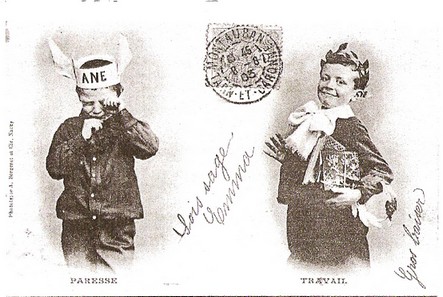
La tâche peut paraître insurmontable. Surtout à ceux et celles qui sont habitué·e·s à fréquenter les salles de prof, où il se dégage toujours une impression de pesanteur ou d’immuabilité. Notre métier repose sur une répétition à la fois confortable et dérangeante que Natalie Quintane a décrit avec précision dans le titre de son livre Un hamster à l’école. Chaque semaine, selon un emploi du temps calqué sur le rythme des usines, je me retrouve face à des groupes de jeunes humain·e·s que je dois faire obéir pour les trier dans les meilleures conditions. Et accessoirement les faire parler anglais. Le tout masqué. Mais cela n’empêche pas la bande de tourner en boucle, cette institution pourrait continuer de fonctionner à travers toutes les crises que nous réserve encore le système capitaliste. Et mon salaire continue de tomber à chaque fin de mois, avec une régularité métronomique. S’il n’est pas élevé, c’est tout de même une sécurité importante au temps du Covid-19, ne sous-estimons donc pas les liens de fidélité que cela peut créer.
Ici réside d’ailleurs toute la difficulté de l’exercice, défendre une proposition suffisamment désirable pour emporter les enseignant·e·s englué·e·s dans leur routine tout en impliquant les gens qui subissent l’école. Dépasser notre corporation me paraît aussi indispensable pour le succès des luttes à venir. Déjà, il y a d’autres employé·e·s avec lesquels nous pouvons conclure des alliances ; les surveillant·e·s, les secrétaires, les agent·e·s d’entretien, etc., mais il faut aussi/surtout s’adresser aux personnes qui subissent l’école, notamment les élèves et leurs parents. Je suis convaincu qu’une grève des notes bien préparée peut ouvrir le champ des possibles, cela pour plusieurs raisons :
Une majorité importante de collègues, d’élèves et de parents adhèrent à l’ethos méritocratique. Elle croit dur comme fer que la note est naturelle et que les places aux examens sont distribuées équitablement. Revendiquer la fin du système de notation, c’est pointer le doigt sur la politique qui s’exerce dans la salle, c’est repolitiser l’enseignement. Nous sortirions ainsi du triptyque des Stylos rouges, « salaires, moyens, respect », qui nous enferme dans un dialogue sans fin avec l’État et n’attire pas sur nous les sympathies.
Prouver que la note n’a pas de fondement, c’est desserrer les liens des êtres avec l’institution. C’est montrer que cette prise d’otage n’a pas vocation à exister et qu’il serait parfaitement possible de faire autre chose. En outre, cela nous fait sortir du schème de préservation de l’existant dans lequel nous nous enferrons trop souvent et forcera à réfléchir sur d’autres modes de transmission du savoir.
Cesser de noter, c’est in fine attaquer la domination bourgeoise qui est naturalisée par l’utopisme méritocratique. C’est jeter une lumière crue sur leurs privilèges injustifiables qui n’existent que par l’exploitation des classes laborieuses dont les enfants sont peu valorisé·e·s par le système scolaire.
En dernière instance, cela aura aussi le mérite de bien retracer les lignes et d’identifier très clairement nos ami·e·s et nos ennemi·e·s. Une grève des notes reconductible, c’est la fédération d’horizontalités multiples contre une verticalité uniformisante (État-capital-bourgeoisie). C’est à proprement parler une action révolutionnaire.
Indubitablement, cette grève qui pourrait commencer dès la rentrée prochaine doit être préparée avec soin car il va falloir produire un argumentaire en béton armé pour convaincre les élèves et les parents. Pour nous protéger des foudres de l’administration, nous pourrions très bien continuer de noter officieusement pendant un temps si jamais la grève ne prend pas.
Mais il faudra probablement aussi passer par un bras de fer avec les organisations syndicales, car ce genre d’initiatives ne recueillera jamais leur assentiment. J’ai pu observer l’action syndicale dans mon établissement et cela se limite à de la cogestion symbolique, je me demande même si factuellement certains syndicalistes ne deviennent pas des organes de direction de facto par leur capacité à influer sur les décisions des proviseurs. En ce moment, nos organisations sont accaparées par la diminution de la dotation horaire globale, qui est certes significative mais qui, encore une fois, nous enchaîne à des palabres interminables avec les chef·fe·s et les rectorats, auxquel·le·s nous n’avons plus à rien à dire. Tous nos efforts doivent être portés sur leur destitution. Heureusement, beaucoup de collectifs de lutte se sont constitués pendant la mobilisation contre la réforme des retraites et nous pouvons nous appuyer sur eux. Aujourd’hui, les syndicats sont devenus des petites féodalités de la contestation, nous n’avons pas besoin d’eux et s’il faut les neutraliser, eh bien, qu’il en soit ainsi. Nous ne leur devons rien et d’ailleurs, déjà en 2009, le Comité invisible rappelait que :
Tout mouvement social rencontre comme premier obstacle bien avant la police proprement dite les forces syndicales et toutes cette micro-bureaucratie dont la vocation est d’encadrer les luttes.9
J’irais même plus loin, je dirais que certaines organisations sont maintenant devenues contre-révolutionnaires. Leur existence dépend de la continuité du dialogue social, si celui-ci est rompu, elles ne sont plus rien. Les directions syndicales sont coupées de leur base, de ceux et celles qui mouillent vraiment leur chemise et prennent des risques, pendant qu’elles, salariées, s’assoient aux tables de négociations, sans se soucier des connivences engendrées par de telles proximités. Il est grand temps d’en terminer avec ce carnaval de l’impuissance politique organisée : l’intersyndicale doit mourir pour que les luttes puissent vivre. En guise de conclusion, par ces temps d’enfermement forcé, j’invite mes collèges professeur·e·s à ne pas oublier qu’ils peuvent déjà mettre en pratique une certaine idée de l’égalité en dialoguant avec leurs élèves sur la politique. Si certaines matières s’y prêtent plus que d’autres, ces échanges permettent de sortir du cycle de repli auquel nous condamne la négociation syndicale. Commençons maintenant à parler à nos élèves d’égal à égal parce que comme le dit Jacques Rancières, pour arriver à l’égalité, il faut commencer par l’égalité. Parlons-leur, parlons-nous entre égaux, ne réservons le silence qu’à nos chef·fe·s et à ceux et celles qui prétendent nous organiser. Et grève des notes à la rentrée !
NOTES
1. Saïd Benmouffok, Le fiasco Blanquer, Les Petits Matins, 2020, p. 13.↩
2. Cuervo (AL Paris Nord-Ouest), « Grégory Chambat : ‘‘Jules Ferry voyait dans l’école un instrument pour « clore l’ère des révolutions »’’, Union communiste libertaire, 5 juillet 2012, https://www.unioncommunistelibertaire.org/Gregory-Chambat-Jules-Ferry-voyait-dans-l-ecole-un-instrument-pour-clore-l-ere ↩
3. Laurence Biberfeld et Grégory Chambat, Apprendre à désobéir : petite histoire de l’école qui résiste, Libertalia, 2013, p. 15. ↩
4. Saïd Benmouffok, Le fiasco Blanquer, Les Petits Matins, 2020, p. 21. ↩
5. Ibid, p. 43. ↩
6. Laurence Biberfeld et Grégory Chambat, Apprendre à désobéir : petite histoire de l’école qui résiste, Libertalia, 2013, p. 65. ↩
7. Saïd Benmouffok, Le fiasco Blanquer, Les Petits Matins, 2020, p. 33. ↩
8. Nathalie Quintane, Un hamster à l’école, La fabrique éditions, 2020, p. 89. ↩
9. Pierre Belivisin, « Pourquoi (re)lire le comité invisible ? », lundi.am, 14 novembre 2019, https://lundi.am/Pourquoi-re-lire-le-Comite-Invisible ↩


