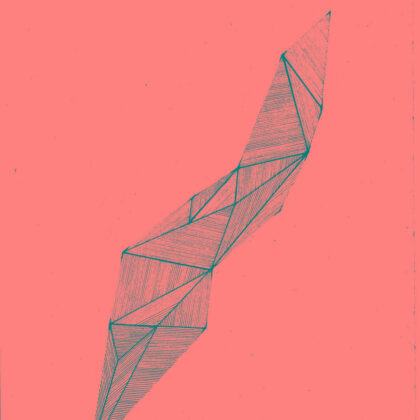
06 Juin Pandemonium: prolifération des frontières du Capital et déviation pandémique (préface)
Par MAX HAIVEN
Publié le 16 mai 2020
Ce court essai est le post-scriptum de Revenge Capitalism: The Ghosts of Empire, the Demons of Capital, and the Settling of Unpayable Debts, qui paraît en ce mois de mai 2020 chez Pluto Press. Écrit au début du mois d’avril, alors que la pandémie en cours prenait forme, ce livre est une vaste exploration des modes par lesquels la « vengeance » se manifeste et caractérise le moment contemporain du capitalisme. Il s’agit également d’une méditation soutenue sur la nécessité de prendre notre « revanche » sur le capitalisme: une distinction subtile, mais importante. Voici les 11 thèses qui traversent le livre:
1. La vengeance est la détermination téméraire d’un monde qui enlève toute valeur à ce que nous aimons et valorisons;
2. Lorsque nous vivons dans l’utopie de quelqu’un·e d’autre, il ne nous reste que la vengeance;
3. Les oppressions sont maintenues par la vengeance préventive des puissant·e·s, qui se justifie en tant que mesure de prévention contre les désirs de vengeance des opprimé·e·s;
4. Le capitalisme prétend avoir chassé la vengeance hors de ses frontières; en fait, la vengeance est en son coeur et se révèle le plus clairement dans ses moments de crise;
5. Alors que tous les systèmes d’oppression se vengent contre celleux qu’ils oppriment, le capitalisme est unique en ce que sa vengeance émerge des contradictions du système lui-même, sans que la méchanceté ou la haine soient nécessaires;
6. Les politiques de la vengeance auxquelles donnent lieu les systèmes de vengeance prennent souvent des cibles erronées, en partie parce que ces systèmes masquent leur propre vengeance sous le couvert des nécessités économiques, de la justice pacifique ou de la nature humaine;
7. L’histoire et le présent du capitalisme de la vengeance ne peuvent pas être dissociés des autres systèmes de vengeance, y compris le terrorisme patriarcal fondé sur le genre, la brutalité génocidaire coloniale et l’esclavage;
8. La condamnation directe de la vengeance est généralement une forme de narcissisme des privilégié·e·s. La vengeance n’est pas un nuage sombre à l’horizon. Le nuage nous couvre déjà et le condamner serait vain. La tâche est de fomenter un imaginaire de la revanche par la transformation révolutionnaire;
9. Les tenants et bénéficiaires du capitalisme de la vengeance ont des noms et des adresses. Il est aussi complètement possible que ces personnes soit remplacées. Le succès du capitalisme de la vengeance repose sur sa capacité à tou·te·s nous contraindre à sa reproduction, d’une manière ou d’une autre;
10. Parfois, le désir de vengeance est tout ce que l’on peut avoir. Cela dit, alors que ce désir vengeur implique de se faire dédommager par la même devise qui a causé le dommage, l’imaginaire de la revanche rêve d’abolir l’ensemble de cette économie (morale, politique);
11. Notre tâche est de prendre revanche au nom de l’avenir de paix, de care, d’abondance, de connexion et de prospérité qui nous est dû, mais que le capitalisme de la vengeance nous nie. Il nous faut également prendre la revanche de celleux qui sont mort·e·s et qui continuent de mourir, lentement ou rapidement, à force de reproduire ce système.
Les nouvelles formes de solidarité, d’entraide et de luttes communes qui émergent aujourd’hui, dans le contexte de pandémie, sauront-elles façonner ces luttes de demain pour un monde post-capitaliste ? – MH
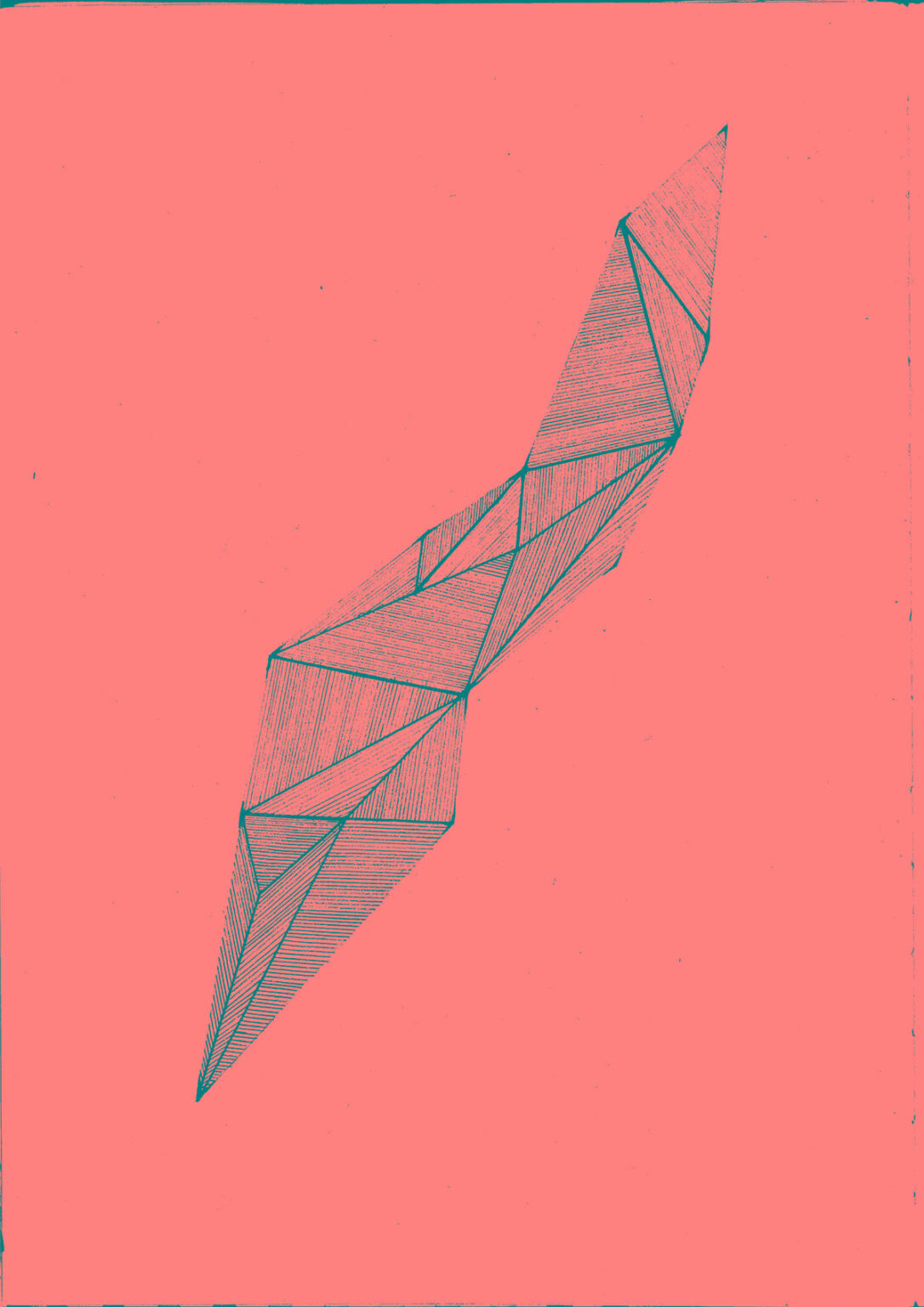
Strikes across the frontier and strikes for higher wage
Planet lurches to the right as ideologies engage
Suddenly it’s repression, moratorium on rights
What did they think the politics of panic would invite?
Person in the street shrugs “Security comes first”
But the trouble with normal is it always gets worse
— Bruce Cockburn, The Trouble with Normal
L’arrivée, au début de l’année 2020, de la pandémie de COVID-19, qui se déploie dans le monde entier au moment où j’écris ces mots, se gravera probablement dans les mémoires comme un changement d’époque. Dans cet hiver prolongé, alors que les frontières se ferment, que les confinements et les quarantaines se multiplient, que les gens succombent et se rétablissent, il y a un profond sentiment que, lorsque le printemps arrivera enfin, nous nous réveillerons dans un paysage radicalement changé.
Pour celleux d’entre nous qui sont maintenant isolé·e·s, malgré notre peur et nos frustrations, malgré notre chagrin — pour celleux qui sont mort·e·s ou qui peuvent mourir, pour la vie que nous vivions avant, pour l’avenir que nous espérions autrefois —, il y a aussi un sentiment que nous sommes bien, à l’abri, dans un cocon, en transformation, en attente, dans un rêve. C’est vrai: la terreur nous guette à travers le monde, notamment dans la manière dont le virus — ou nos mesures pour le contrer — met en danger celleux d’entre nous que nous avons déjà abandonné·e·s ou bafoué·e·s en tant que société. Beaucoup d’entre nous sont déjà superflu·e·s. Beaucoup d’entre nous l’apprennent seulement maintenant, trop tard. Ensuite, il y a le flou dangereux de la frontière entre les mesures humanitaires et autoritaires. Il y a la militarisation géopolitique de la pandémie.
Or, lorsque le printemps arrivera, comme il se doit, lorsque nous sortirons de l’hibernation, ce pourrait être le moment d’une profonde lutte mondiale à la fois contre la volonté de « revenir à la normale » — la même normale qui a ouvert la voie à cette tragédie — et la « nouvelle normale » qui pourrait être encore pire. Préparons-nous du mieux que nous pouvons, car nous avons un monde à gagner.
La vengeance annoncée de la nouvelle normale
J’imagine que les luttes à venir seront définies soit par la volonté désespérée de « revenir à la normale », soit par un refus généralisé de cette normale. Or, ce n’est pas un mélodrame manichéen.
D’un côté, il y aura celleux qui chercheront à nous ramener à l’ordre du capitalisme global de la vengeance auquel nous nous étions habitué·e·s: un système nihiliste d’accumulation globale qui semble exercer sa vengeance inutile et injustifiée sur tant d’entre nous, alors qu’aucun individu n’ait une quelconque intention malicieuse, ce qui engendre, en retour, le pire type de politiques de la vengeance.
Bien sûr, nous devons nous attendre à ce que l’exigence d’un retour à la normale vindicative provienne des bénéficiaires de ce système — les riches, l’élite politique — qui ont tout à gagner du business as usual. Or, nous devons également nous attendre à ce que des millions de personnes opprimées, exploitées et aliénées par ce système, dont la vie a été réduite à une mort lente en son sein, l’exigent aussi.
Après des mois de chaos, d’isolement et de peur, le désir de revenir à la normale, même si la normale est un système abusif, pourrait être extrêmement fort. Le décor est planté pour que ce désir s’accompagne d’un revanchisme frénétique. Voudrons-nous quelqu’un·e à blâmer, en particulier celleux d’entre nous qui perdent des êtres chers ? Du sang devra-t-il couler, figurativement ou littéralement ?: un baptême par le feu pour que l’ancien ordre — qui a, bien sûr, crée les conditions d’austérité et d’inégalité qui ont rendu ce fléau si dévastateur — puisse renaître sous une forme purifiée.
Bien sûr, les choses ne seront plus jamais « normales »: certain·e·s d’entre nous, les privilégié·e·s et les riches, pourront peut-être en avoir l’illusion, mais elle sera probablement portée sur le dos de la grande majorité qui travaillera plus dur, plus longtemps et pour moins, exposée à de plus grands risques pour moins de bénéfices.
Les dettes de la pandémie devront, au sens propre et figuré, être remboursées.
D’un autre côté — ou peut-être en même temps — nous pouvons également nous attendre à ce que, parmi les puissant·e·s et le reste d’entre nous, il y ait des appels à rejeter le « retour à la normale », mais afin d’embrasser quelque chose de pire encore. Il est probable que le chaos et les morts de la pandémie seront imputés à trop de démocratie, de libéralisme et d’empathie. Maintenant que les États montrent leurs muscles et prennent le contrôle de la société, nombreux·ses seront celleux qui ne voudront pas qu’ils baissent les bras. Nous pourrions assister, au cours de cette crise, à un recours à la force répressive contre les citoyen·ne·s — comme elle est déjà utilisée contre les migrant·e·s et les personnes incarcérées — et je crains que cela soit perçu par beaucoup comme justifié, un sacrifice humain pour nourrir les dieux de la peur.
Dans le sillage de la pandémie, nous pouvons être sûr·e·s que les fascistes et les réactionnaires chercheront à mobiliser des tropes au nom de la pureté, de la purification, du parasitisme et de la pollution — de la race, de la nation, de l’économie — afin d’imposer à la réalité leurs rêves de toujours. La fétichisation vindicative de la frontière, aujourd’hui plus politisée que jamais, nous hantera tou·te·s dans les années à venir. Le « nouvel » autoritarisme, qu’il mette l’accent sur l’État totalitaire ou sur le marché totalitaire — ou sur les deux — insistera pour que tou·te·s reconnaissent que nous vivons maintenant — et avons toujours vécu — dans un monde impitoyable et compétitif et que nous devons prendre les moyens pour nous emmurer du reste du monde et chasser les indésirables. À d’autres moments, l’autoritarisme sera peut-être plus furtif, dissimulé derrière une rhétorique de la science, du libéralisme et du bien commun.
Pendant ce temps, celleux qui se sont considérablement enrichi·e·s et ont assis leur autorité au cours des dernières décennies, notamment dans les secteurs entrelacés des technologies et de la finance, déploieront certainements des efforts pour tirer parti de leur influence et de leurs ressources, ainsi que de la faiblesse et de la déstructuration des institutions traditionnelles, pour diriger la réorganisation de la société selon des lignes néo-technocratiques. Tout en continuant à offrir généreusement les services de leurs puissants empires intégrés de surveillance, de logistique, de finance et de données pour « optimiser » la vie sociale et politique.
Cette dystopie entrepreneuriale peut afficher un visage humain: revenu de base, hypervigilance pour prévenir de nouvelles épidémies, médecine personnalisée. Leurs bras sont déjà chargé·e·s de cadeaux pour nous aider dans cette situation d’urgence: géolocalisation des vecteurs de maladies, interdiction de la désinformation, proposition de soutien aux États pour la gestion des données et des populations.
Derrière ces masques se cache une réorganisation de la société pour la faire correspondre au méta-algorithme hypercapitaliste qui, bien que commandé par les contradictions capitalistes, équivaudra essentiellement à un régime néoféodal pour la plupart d’entre nous: un monde de données et de gestion des risques duquel seule une petite poignée tire des avantages.
On nous dira que c’est pour notre propre bien.
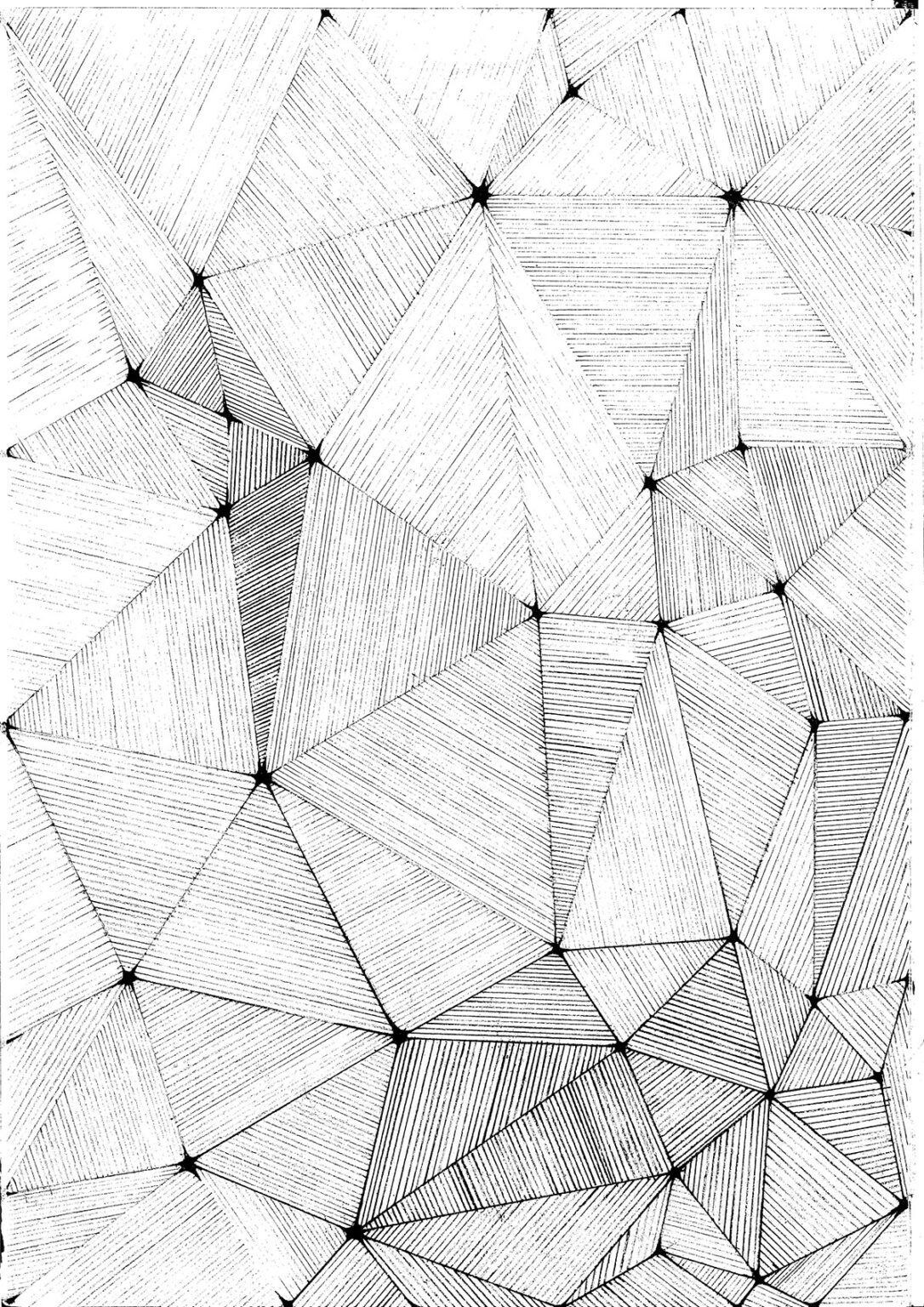
Notre refus comme revanche
Contre tous ces constats fatidiques, il y aura celleux d’entre nous qui refuseront de revenir à la normale ou de se conformer à la « nouvelle normale », celleux d’entre nous qui savent très bien que « le problème avec la normale, c’est qu’elle ne fait qu’empirer ».
Déjà, au sein de l’état d’urgence dans lequel la crise nous a plongé·e·s, nous voyons émerger des mesures extraordinaires qui révèlent que la prétendue nécessité de l’austérité défendue par le régime néolibéral était un pur mensonge. Le divin marché a encore une fois chuté. À plusieurs endroits, les diverses mesures introduites auraient été inimaginables il y a seulement quelques semaines. Parmi celles-ci, on retrouve la suspension des loyers et des hypothèques, la gratuité des transports en commun, le déploiement de revenus de base, l’interruption des paiements de dettes, la réquisition, au nom du bien public, d’hôpitaux privatisés et d’autres infrastructures autrefois publiques, la libération de personnes incarcérées et la réorientation, sous la pression des gouvernements, de la production des industries privées vers les besoins communs.
Nous apprenons qu’un nombre important de personnes refusent de travailler, entreprennent des actions ouvrières autonomes, revendiquent leur droit de vivre de manière radicale. À certains endroits, les mal-logé·e·s saisissent des logements vacants.
Nous découvrons, à l’opposé de la logique renversée de la valeur capitaliste, qui enrichit une minorité au détriment de la majorité, quel travail a une réelle valeur: celui des travailleur·euse·s du care, des services et de première ligne dans le secteur public. Il y a eu une prolifération de revendications radicales de la base pour des politiques du care et de solidarité non seulement en tant que mesures d’urgence, mais à perpétuité.
Les think tanks capitalistes et de droite paniquent, craignant qu’un demi-siècle de travail idéologique minutieux pour nous convaincre de la nécessité du néolibéralisme — qui a transformé jusqu’à nos âmes — soit dissipé dans les semaines et les mois à venir. Le goût de la liberté — non pas la liberté solitaire du marché, mais une liberté réelle et interdépendante — persiste en bouche comme un souvenir oublié depuis longtemps, qui devient toutefois rapidement amer lorsque son nectar est retiré. Si nous ne défendons pas ces gains matériels et spirituels, le capitalisme viendra pour obtenir vengeance.
Pendant ce temps, les personnes en quarantaine et semi-isolées découvrent, à l’aide d’outils numériques, de nouvelles manières de se mobiliser pour prendre soin et aider mutuellement celleux qui sont dans le besoin au sein de nos communautés. Nous retrouvons lentement nos pouvoirs perdus de vie en commun, cachés à la vue de tou·te·s, notre héritage secret. Nous apprenons à redevenir une espèce coopérative, en nous débarrassant de la peau claustrophobe de l’homo oeconomicus. Avec la suspension de l’ordre capitaliste de la compétition, de la méfiance et de l’agitation inutile et sans fin, notre ingéniosité et notre compassion refont surface comme les oiseaux dans le ciel sans smog.
Lorsque le printemps arrivera, la lutte devra chercher à préserver, à améliorer, à mettre en réseau et à organiser cette ingéniosité et cette compassion pour demander ni un retour à la normale, ni une nouvelle normalité. Partout dans le monde, il y a eu, au cours des dernières années, un niveau sans précédent de mobilisation et d’organisation de mouvements contre le capitalisme de la vengeance, parfois autour de candidats se présentant aux élections — par exemple, Corbyn au Royaume-Uni et Sanders aux États-Unis —, mais aussi autour de campagnes menées par la base: les grèves contre le nécro-néolibéralisme en France, l’anti-autoritarisme à Hong Kong, l’anti-corruption au Liban et en Irak, l’anti-austérité au Chili, le féminisme au Mexique, les luttes contre la gentrification et le nettoyage urbain dans les villes du monde entier, la solidarité avec les migrant·e·s en Europe, les luttes autochtones au Canada, la lutte climatique un peu partout.
Je pense que ces luttes pré-2020, bien qu’importantes en elles-mêmes, resteront dans les mémoires comme le terrain d’entraînement d’une génération à qui incombe désormais l’un de ces tournants décisifs de l’histoire. Nous avons appris à mettre à genoux une économie capitaliste grâce à la protestation non violente malgré une oppression écrasante et amplifiée par les technologies. Nous apprenons à devenir ingouvernables tant par les États que par les marchés.
De manière toute aussi importante, nous avons appris de nouvelles façons de prendre soin les un·e·s des autres sans attendre l’État ou les autorités. Nous redécouvrons le pouvoir de l’entraide et de la solidarité. Nous apprenons à communiquer et à coopérer à nouveau. Nous avons appris à organiser et à réagir rapidement, à prendre des décisions collectives et à assumer la responsabilité de notre sort.
Comme les héro·ïne·s de toutes les bonnes épopées, nous ne sommes pas prêt·e·s. Notre entraînement n’est pas terminé, mais le destin n’attendra pas. Comme tou·te·s les vrai·e·s héro·ïne·s, nous devons nous contenter de ce que nous avons: les un·e·s les autres et rien d’autre.
Alors que le monde ferme les yeux sur cette étrange et onirique quarantaine — à l’exception, bien sûr, des travailleur·euse·s de la santé, des services et des soins de première ligne qui, au service de l’humanité, ne peuvent pas se reposer et de celleux qui n’ont pas de lieu sûr pour rêver — nous devons nous préparer pour le réveil. Nous sommes à l’aube d’un grand refus du retour à la normale et d’une nouvelle normale: ces normalités de la vengeance qui nous ont mené·e·s à cette catastrophe et qui ne peuvent mener qu’à plus de catastrophes. Dans les semaines à venir, il sera le temps de pleurer et de rêver, de se préparer, d’apprendre et de connecter du mieux que nous le pouvons.
Une fois l’isolement terminé, nous nous réveillerons dans un monde où les régimes concurrents de normalisation vindicative seront en guerre les uns contre les autres, à une époque de profonds dangers et de profondes possibilités. Ce sera le moment de se lever et de se regarder dans les yeux.
History says, Don’t hope
on this side of the grave.
But then, once in a lifetime
the longed for tidal wave
of justice can rise up,
and hope and history rhyme.
So hope for a great sea-change
on the far side of revenge.
Believe that a further shore
is reachable from here.
Believe in miracles
and cures and healing wells.
— Seamus Heaney, The Doubletake
Traduction par Éloi Halloran.
Texte à paraître en anglais, le 20 mai 2020, en tant que post-scriptum au livre Revenge Capitalism: The Ghosts of Empire, the Demons of Capital, and the Settling of Unpayable Debts du même auteur.
Le texte a également été publié en anglais par ROAR Magazine, le 23 mars 2020.
Les illustrations sont tirées de l’oeuvre d’Alex Christensen.

