19 Déc Dans et contre l’État
Par Valérie Simard
Publié le 19 décembre 2023
Plus d’un demi-million de travailleuses et de travailleurs du secteur public se sont doté·e·s de mandats de grève générale illimitée pour affronter la négociation qui a cours en ce moment. Dans la plupart des syndicats, les mandats ont été adoptés avec des majorités écrasantes. Pour l’instant toutefois, seule la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente 65 600 enseignantes et enseignants, a déclenché une grève générale, sans date de fin à l’horizon. Pas de doute, les syndiqué·e·s de l’État, dont le salaire moyen tourne autour des 40 000$ annuellement, en ont marre et ont peut-être compris que la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans tous les domaines les place dans une position enviable, pour une fois.
Cette négociation se déroule dans le contexte particulier de « l’après-pandémie ». Les employé·e·s de l’État ont été au cœur de la gestion de crise et se sont montré·e·s dociles et serviables : quand on leur demandait de travailler de la maison, tout comme lorsqu’on leur demandait de donner un coup de mains dans les sites de vaccination. Mais une fois la tempête calmée, les travailleuses et travailleurs ont saisi un peu mieux leur valeur et que la grande flexibilité qu’on leur exigeait pouvait aussi se retourner contre l’employeur. Refus de passer des heures dans les transports en commun ou pris dans le trafic pour rentrer au bureau ; refus des cadences destructrices et des heures supplémentaires ; refus de la surcharge et des tâches connexes. Et si l’employeur se montre, lui, inflexible, c’est par centaine que les salarié·e·s donnent leur démission. Depuis le début de l’année scolaire, c’est déjà quelques 800 enseignantes qui ont claqué la porte. Pour la pensée managériale, la « grande démission » représente la hantise des employeurs vis-à-vis d’une génération qui n’accepte plus de travailler sous n’importe quelle condition ni de faire n’importe quoi.
De là part l’initiative d’auto-organisation dans le secteur public, La grande démission1. Pour nous, la « grande démission » incarne le refus du travail tel qu’il est, que cette résistance soit sous la forme d’une grève, d’un ralentissement de la cadence ou d’une démission massive, une arme redoutable qu’il faut se réapproprier et organiser collectivement. Si, pour les employeurs et le gouvernement, la pénurie de main-d’œuvre dans bon nombre de secteurs d’emplois doit être perçue comme une contrainte à travailler davantage, nous y voyons au contraire un contexte qui nous permette de saisir le gros bout du bâton.
Les négociations du secteur public sont pour nous l’occasion de participer au débat sur nos conditions de vie de même que sur le potentiel subversif des positions que nous occupons dans la société, mais nous comptons nous organiser bien au-delà de la signature des conventions collectives. Notre initiative a pour objectif de contribuer au renversement du rapport de force, à notre avantage, dans le conflit qui nous oppose à l’État employeur et aux classes dirigeantes, le tout dans un perspective de transformation en profondeur de nos existences et d’accession à des vies meilleures pour toutes et tous. — VS
Les employé·e·s de l’État démissionnent par milliers chaque année, entraînant une pénurie de main-d’oeuvre, ce qui pousse l’employeur à restructurer les services publics : réforme majeure de l’éducation et de la santé, réforme des politiques d’embauche dans la fonction publique. Si la masse des démissions individuelles provoque des transformations importantes, on peut croire que leur organisation collective a le pouvoir d’orienter ces transformations. Or des infirmières de Montréal et de Drummondville nous ont montré comment faire l’hiver dernier : une lettre de démission collective contenant des revendications et un ultimatum. Peut-on à la fois faire usage de ce rapport de force pour améliorer nos conditions de travail et combattre tout ce qui, dans l’État, nuit aux couches populaires et travailleuses? C’est le pari que nous faisons avec la présente initiative d’auto-organisation.
En 1979, un petit groupe d’employé·e·s de l’État basé à Londres publie les résultats de son enquête et de ses réflexions critiques sur le secteur public dans le pamphlet In and Against the State. L’objectif de l’ouvrage est de mettre en lumière les contradictions inhérentes au fait d’être employé·e par l’État tout en souhaitant son renversement : le groupe entend dépasser ces contradictions et, surtout, refuse de confiner son engagement politique en dehors des heures de travail. Ni gestionnaires, ni au bas de l’échelle, le groupe conscient de ses conditions de travail avantageuses a fait le choix de lutter au sein de la classe ouvrière, à partir de sa position. C’est dans le même esprit que nous entreprenons cette démarche. Sans prétendre que le secteur public est le terreau le plus fertile pour organiser la lutte des classes, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un terrain de lutte, qui plus est un espace privilégié pour l’auto-organisation.
En effet, il se trouve peu d’individus campés à l’extrême gauche qui considèrent les employé·e·s de l’État comme une force révolutionnaire. De façon générale, le secteur public est considéré comme un espace occupé par une certaine « classe moyenne » ou une « aristocratie ouvrière », des planqué·e·s qui bénéficient de bons salaires et d’avantages sociaux enviables. Pour la population dans son ensemble, la généralisation de la bureaucratie dans toutes les sphères de la vie a de quoi provoquer l’exaspération. L’État intervient même dans les relations sociales, jusque dans la sphère privée, définissant les catégories de couple, de famille, de handicap, de vieillesse et de jeunesse, etc.
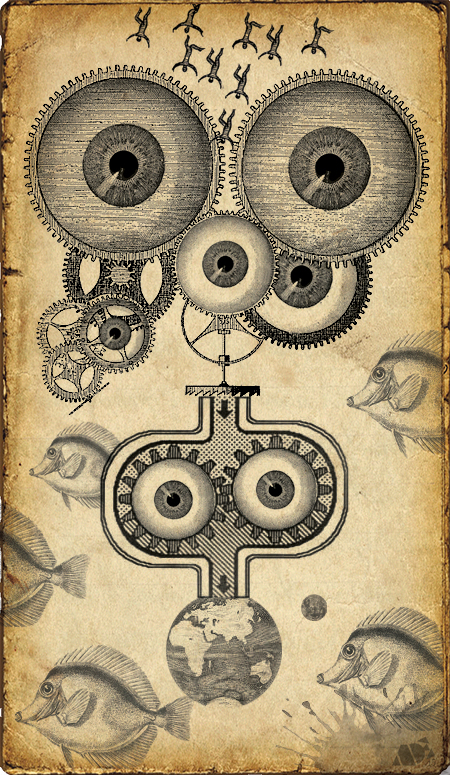
N’empêche que depuis longtemps, une large partie de la gauche s’est organisée autour de l’État-providence, soit pour exiger que l’État intervienne pour régler la pauvreté, les problèmes de logements, de violence genrée, etc., soit pour lutter contre les coupures dans les programmes sociaux. S’il est difficile de nier que des services publics sont préférables à la privatisation tous azimuts, il reste que devant le piètre état des systèmes de santé et d’éducation et de l’accès en général aux services publics, les masses ne se pressent plus pour lutter contre leur démantèlement. D’autant plus que les bénéficiaires sont les mieux placé·e·s pour connaître le caractère répressif des institutions publiques. C’est pourquoi, en tant qu’agent·e·s de l’État, il est inutile de se battre contre la réingénierie et les coupures et pour l’amélioration des salaires et autres avantages sociaux si on ne se bat pas en même temps contre le rôle de régulation et de contrôle des services et des institutions, qui affectent autant nos conditions de travail que la qualité de vie des « bénéficiaires », et qui ont pour fonction d’assurer aux employeurs une main-d’œuvre disponible, mais jetable.
De par son importance quantitative, il y a donc lieu de s’intéresser à ce bassin dans une perspective d’organisation et de lutte sur le terrain du travail. Le secteur public est aussi l’un des rares secteurs d’emploi qui connaît encore des cycles de luttes et de grèves. Mais c’est en particulier en raison de son rôle au sein de l’appareil étatique que se trouve l’intérêt de s’organiser de façon autonome dans la fonction publique. En tant qu’agent·e·s de l’État, les fonctionnaires comme les enseignant·e·s, les infirmières et les travailleur·se·s sociaux·le·s participent au projet nationaliste et à la régulation sociale. C’est aussi le cas des organisations syndicales qui au fil du temps se sont trouvées de plus en plus imbriquées dans l’État-nation et qui, plus souvent qu’autrement, font le pont entre le projet racial-colonial des gouvernements et la population blanche active.
L’exemple le plus récent de cette imbrication est la réponse syndicale à l’adoption de la loi sur la laïcité de l’État qui interdit le port de signes religieux par tout fonctionnaire en position d’autorité, dont les enseignant.e.s des écoles publiques. Cette loi vient imposer, à l’intérieur des murs de l’école, l’idéologie dominante portée par l’État en matière de laïcité, soit une interprétation qui cible particulièrement les femmes musulmanes portant le voile. Bien que contestée au niveau juridique par diverses organisations dont la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), l’adoption de la loi a somme toute rencontré peu d’opposition dans les établissements scolaires. Pire encore, certains syndicats locaux et nationaux d’autres secteurs ont adopté des positions visant à réclamer que l’interdiction des signes religieux soit étendue à tout le secteur public. Si quelques enseignantes et enseignants ont bien tenté de s’organiser de façon autonome contre la loi, son adoption a surtout représenté une occasion ratée de dépasser le corporatisme et de s’organiser dans une perspective qui dépasse le strict front du contrat de travail.
Heureusement, les occasions ne manquent pas de s’organiser dans la perspective d’un « nous » travailleur.euse.s qui ne sert pas l’État-nation. Pour les auteurs et autrices de In and Against the State, la lutte des employé·e·s de l’État passe notamment par la façon d’exercer ses fonctions. Leur proposition se déploie ainsi : contourner l’individualisation, rejeter les catégories réductrices et se définir en termes de classe; définir nous-mêmes les enjeux, s’extraire des contraintes de la définition de tâche, refuser les procédures officielles et les priorités managériales ; finalement, trouver des manières alternatives de lutter.
Il existe déjà des initiatives d’organisation dans le secteur public qui vont dans ce sens. On peut penser par exemple aux sit-in organisés par les infirmières pour s’opposer au temps supplémentaire obligatoire, opposition frontale à l’organisation capitaliste du travail. En 2015, des travailleurs et travailleuses du milieu de la santé avaient proposé une « grève inversée », parce que les conditions imposées par la loi sur les services essentiels obligeaient l’employeur à faire appel à plus de personnel par quart de travail que ce qui était prévu en dehors des périodes de grève. Mais c’est aussi dans l’organisation du travail au quotidien qu’on peut trouver des exemples d’organisation « contre l’État ». Récemment, élèves, parents, voisin.ne.s et personnel scolaire se sont mobilisés afin de sécuriser les rues vis-à-vis de la circulation routière autour des écoles et, en plein cœur de la pandémie, d’autres ont exigé qu’on maintienne la distribution des repas gratuits aux élèves.
Chaque occasion est à saisir pour définir nous-mêmes les enjeux et rompre avec l’idéologie étatique dominante. Dans tous les milieux, briser l’isolement pour refuser collectivement les priorités définies par en haut, rejeter la fragmentation arbitraire des tâches afin de développer une vision d’ensemble, viser les réductions de la cadence et des horaires de travail, définir nous-mêmes les problèmes et distinguer ceux qui appartiennent à l’État et ceux qui appartiennent réellement aux bénéficiaires… chacune des ces avenues permet de s’éloigner un peu d’un rôle passif en tant qu’agent·e·s de l’État. Si la voie stratégique « dans et contre » l’État reste imprécise, c’est qu’il faut impérativement qu’elle soit définie de façon autonome par chaque lieu de travail. Dans le contexte des négociations actuelles, il s’agit d’aligner les revendications au profit des plus vulnérabilisés ; les petits salariés et les précaires, mais aussi, les personnes en situation de handicap, les personnes immigrantes et racisées. Bref, faire de la position stratégique au cœur de l’appareil étatique un atout pour la classe ouvrière contre le projet national-colonial en cours au lieu de servir passivement les intérêts des dirigeants.
Les propositions des travailleuses et travailleurs de La grande démission vont dans ce sens:
- Réduire le temps de travail pour toutes et tous, sans réduction de salaire ;
- Augmenter les salaires au bas de l’échelle afin de tendre vers un salaire universel ;
- S’opposer à la loi sur la laïcité de l’État et à toute loi discriminatoire ;
- Politiser les démissions massives et les organiser de manière à infléchir les services publics à la faveur du bien-être réel de toutes et tous au lieu des objectifs de régulation sociale et de reproduction de main-d’œuvre pour les employeurs.
L’illustration est tirée de l’œuvre d’Angelo De Grande (CC BY-NC-ND 4.0).
NOTES
1. Voir le site de La grande démission pour en savoir plus. ↩
2. 23,8 % selon l’Institut Fraser, Comparaison de la rémunération des secteurs public et privé au Québec, édition 2023. ↩
3. Il y a aussi, évidemment, les acteurs de l’appareil d’État : les forces militaires et policières, les agents frontaliers, les services de renseignement, etc. Ce texte ne suggère d’aucune façon de s’organiser avec ces catégories de travailleurs, mais plutôt à celles dans les services publics. ↩

