14 Oct Ma mère est plus écolo que vos COP!
Par Nordine Saïdi
Publié le 14 octobre 2025
Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée «Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres: que peut l’écologie décoloniale ?». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB
Avant de parler d’écologie, de climat, d’énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd’hui, je dois dire Gaza.
Parce qu’il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours.
Impossible de parler de l’avenir sans nommer le sang versé.
Impossible de parler de justice sans dénoncer l’injustice la plus obscène de notre époque.
Impossible de parler d’écologie, de planète, sans parler de Palestine.
Nous vivons une époque de génocide.
C’est le terme exact utilisé par des experts de l’ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C’est le mot qui s’impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d’eau, de soins, d’abris.
Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n’est pas en reste.
Notre pays continue de commercer, de coopérer, d’armer, d’accueillir des représentants d’un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus «progressistes» — parlent du climat comme si Gaza n’existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu’un peuple est écrasé sous les bombes.
Chères sœurs, frères, camarades, ami·es,
Merci pour votre présence aujourd’hui.
Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait: le dérèglement climatique. Et pourtant, il n’a rien d’abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s’agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D’enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c’est une archive des violences coloniales.
Et aujourd’hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la facture.
Alors, permettez-moi de vous proposer un angle. Un angle non pas neutre – car il ne peut y avoir de neutralité dans ce monde – mais radicalement situé. Et si ce dérèglement climatique, au lieu d’être une simple catastrophe naturelle, était la vengeance des ancêtres ?
Et si les terres spoliées, les mines ouvertes à vif, les forêts décimées, les peuples déplacés… rendaient enfin leur verdict ?
Et si les tempêtes, les sécheresses, les incendies… étaient la mémoire terrestre de ce que l’empire a infligé aux vivants ?
C’est cette hypothèse que je vous invite à explorer. Non pas dans une perspective ésotérique ou mystique, mais dans une perspective politique, décoloniale et anti-impérialiste. Que peut l’écologie décoloniale face au désastre en cours ? Voilà la question.
Le climat n’est pas neutre: il porte la trace de l’Histoire
Il faut d’abord rappeler ceci: le changement climatique n’est pas une surprise. Il est le produit logique d’un modèle économique, colonial, racial, patriarcal, qui a mis le monde en coupe réglée au nom du profit.
Lorsque Christophe Colomb met le pied dans les Caraïbes en 1492, il n’ouvre pas seulement la voie à la colonisation des Amériques. Il amorce ce que certains historiens appellent le début de l’Anthropocène, Capitalocène, Plantocène colonial – cette ère où l’homme occidental, armé de son rationalisme, de sa foi dans la croissance et de ses fusils, commence à modifier l’équilibre planétaire.

Et que fait l’Europe dès qu’elle se répand sur la planète ? Elle extrait. Elle tue. Elle plante des monocultures. Elle assèche les marais. Elle arrache les populations. Elle tue les dieux des forêts. Elle transforme les territoires vivants en ressources.
Et cette transformation se fait dans le sang.
Des millions d’Africain·es déporté·es pour alimenter des plantations esclavagistes. Des millions d’Amérindien·nes massacré·es pour planter du coton, du café, du sucre. Des milliers de kilomètres de rails pour transporter du charbon, de l’ivoire, du cuivre.
Voilà la vérité: le dérèglement climatique est né dans les cales des bateaux négriers, dans les mines coloniales du Congo, dans les forêts détruites d’Amazonie.
Ce n’est pas une conséquence imprévue: c’est le résultat systémique d’un système fondé sur l’exploitation illimitée des humains et de la nature.
Le Sud global paye les dégâts du Nord global
Aujourd’hui, qui souffre le plus des conséquences du réchauffement climatique ? Pas les banquiers de la City, pas les patrons du CAC 40. Ce sont les pays du Sud global, ceux qu’on a déjà pillés pendant des siècles.
- En Somalie, des millions de personnes sont déplacées par la sécheresse.
- Au Mozambique, des cyclones dévastateurs reviennent tous les ans.
- Au Bangladesh, les terres disparaissent sous les eaux.
- Dans les îles du Pacifique, les peuples voient leur monde englouti, lentement mais sûrement.
Selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, le changement climatique risque de faire de nombreuses victimes dans plusieurs pays du globe à l’horizon 2050.
Les pays du «Nord global» (l’ensemble des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et des régions développées d’Asie), qui représentent 14 % de la population mondiale, sont responsables de 92 % des émissions cumulées de CO2 sur la période 1850-2015 ayant conduit l’humanité à franchir l’une des limites planétaires.
Or, ce sont au contraire les pays de l’hémisphère Sud qui vont davantage souffrir des effets du changement climatique, ont démontré les auteurs en combinant les risques de maladies calculés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec les projections de population humaine réalisées par l’ONU.
Les six pays suivants sont les plus concernés :
- la République démocratique du Congo,
- l’Angola,
- la République du Congo,
- le Gabon,
- la Guinée équatoriale, et
- la République centrafricaine.
Et pourtant, ces pays-là, ces peuples-là, n’ont pratiquement aucune responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre. L’Afrique, par exemple, ne représente que 3 % des émissions mondiales depuis 1850. Et pourtant, ce sont ses enfants qui meurent les premiers.
C’est cela, le racisme climatique. C’est cela, l’injustice écologique. C’est cela, la dette climatique du Nord envers le Sud.
Mais attention : la souffrance n’est pas passive. Partout, des résistances s’organisent.
Des communautés autochtones du Brésil qui s’opposent à la déforestation.
Des jeunes activistes en Ouganda qui dénoncent les projets pétroliers.
Des pêcheurs sénégalais qui refusent de voir leurs zones côtières confisquées.
Ce sont eux, les vrais visages de l’écologie radicale.
Une écologie indifférente à Gaza est une écologie coloniale
On nous parle de justice climatique. De sauver la planète. D’assurer un avenir à nos enfants. Mais quel avenir peut-on prétendre construire si l’on accepte l’extermination d’un peuple en direct, filmée, documentée, et normalisée ?
Quel sens cela a-t-il de parler d’écologie en oubliant que Gaza est l’endroit le plus pollué de la Méditerranée parce que ses stations d’épuration sont détruites, son eau imbuvable, son sol saturé de bombes et de toxines ?
Quel sens cela a-t-il de parler de justice climatique sans nommer qu’Israël utilise la destruction de l’environnement comme une arme de guerre, rasant les terres agricoles palestiniennes, brûlant les oliveraies, bombardant les infrastructures vitales ?
Quel sens cela a-t-il de parler de droits humains, quand on ferme les yeux sur l’utilisation de la famine comme outil politique ?
Il n’y a pas de neutralité possible face à un génocide.
Et il n’y a pas d’écologie possible dans une société qui hiérarchise les morts, qui pleure les forêts mais pas les enfants palestiniens.
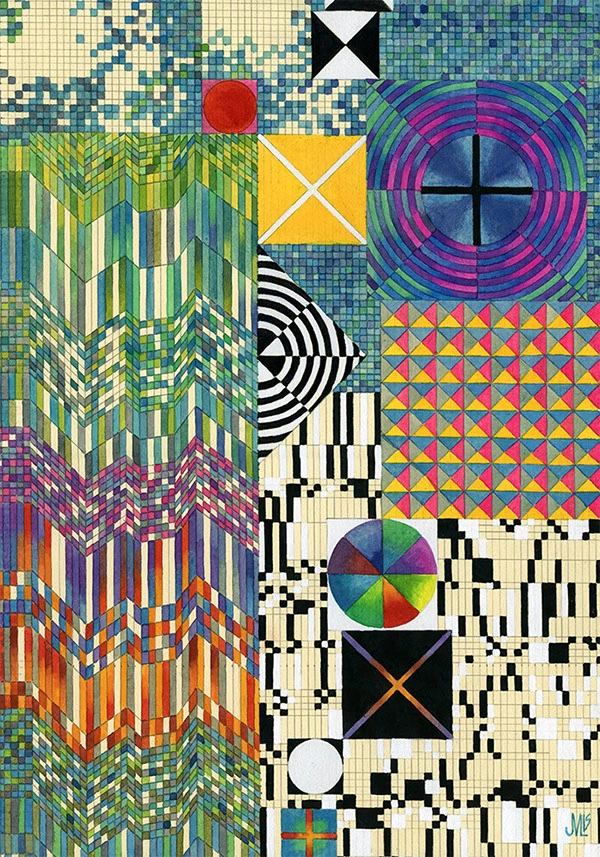
L’écologie que nous voulons: décoloniale, antiraciste, populaire
Si nous voulons parler d’écologie avec sérieux, nous devons reconnaître que le projet écologique ne peut pas être séparé des luttes anticoloniales et antiracistes.
Il ne s’agit pas d’un sujet «en plus».
Il ne s’agit pas de détourner le débat, mais de le recentrer sur ce qu’est véritablement la justice: l’universalité des droits, la fin de toutes les oppressions, la dignité pour tous les peuples.
Gaza est notre miroir.
Gaza nous montre à quel point l’Occident a échoué à défendre les principes qu’il prétend incarner: les droits humains, le droit international, l’interdiction de la torture, le respect de la vie.
Parler écologie sans Gaza, c’est parler climat sans humanité
C’est pleurer les glaciers qui fondent mais ignorer les enfants sous les gravats.
C’est vouloir protéger les dauphins et les pandas, mais pas les nourrissons de Rafah.
C’est prétendre défendre le vivant tout en fermant les yeux sur l’extermination d’un peuple.
Notre écologie est incompatible avec le colonialisme
Nous devons le dire sans détour: Israël est un État colonial.
Et toute écologie digne de ce nom doit être anticoloniale.
Cela implique :
- de boycotter les entreprises complices du massacre ;
- de dénoncer les liaisons diplomatiques avec l’État d’apartheid ;
- de soutenir les mobilisations palestiniennes, diasporiques, antisionistes.
Gaza est notre boussole
Alors oui, parlons de climat. Parlons de transition énergétique. Parlons de mobilités durables. Mais n’oublions jamais que notre écologie n’a de sens que si elle est solidaire.
Solidaire des peuples écrasés.
Solidaire des terres pillées.
Solidaire de la Palestine.
Tant que Gaza brûle, le monde est en feu.
Et tant qu’un enfant palestinien meurt, aucun futur n’est acceptable.
Là où l’on brûle des enfants, on ne parle pas de planète. On se tait. On agit.
L’écologie dominante: blanche, bourgeoise et amnésique
Face à cela, l’écologie occidentale dominante, institutionnelle, peine à se remettre en question. Elle se veut morale, universelle, technique, mais elle reste souvent aveugle aux rapports de domination.
Qui parle dans les conférences sur le climat ?
Qui négocie dans les COP ?
Qui définit ce qu’est une solution acceptable ou souhaitable ?
Ce sont des experts, des diplomates, des ingénieurs du Nord, des ONG bien financées.
Mais où sont les peuples ? Où sont les sans-papiers, les ouvriers, les femmes racialisées, les paysans sans terre ? Où sont les survivant·es des colonies ?
Dans les grandes conférences climatiques, on n’en parle jamais.
On parle de quotas carbones, de mobilité verte, d’économie circulaire.
Mais jamais des mines de cobalt du Congo.
Jamais des pipelines en Ouganda.
Jamais de la pollution des guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye.
Jamais des bombes, des drones, des bases militaires occidentales qui ravagent les sols, empoisonnent les nappes phréatiques, détruisent les écosystèmes humains et non-humains.
L’écologie occidentale est trop souvent une écologie de la culpabilité individuelle: trie tes déchets, arrête la viande, prends ton vélo. Mais elle évite soigneusement de nommer les racines structurelles du problème: le capitalisme, l’impérialisme, le racisme.
Or, sans cela, on ne peut pas construire un monde vivable. Une écologie qui refuse de se confronter à la colonialité de son histoire est une écologie qui échoue.

Soyons clairs: l’écologie telle qu’on nous la vend aujourd’hui est coloniale
Elle nous explique qu’il faut trier ses déchets, manger bio, rouler à vélo.
Mais elle ne dit rien sur les responsabilités historiques.
Elle ne dit rien sur les 500 ans de pillage et de pollution coloniale.
Elle ne dit rien sur les crimes environnementaux de l’OTAN ou des multinationales.
Elle ne dit rien sur le fait que les pays les plus riches sont responsables de 92 % des émissions historiques de CO₂.
Et surtout, elle ose nous faire la leçon.
À nous. À nos mères.
Comme si c’étaient elles qui avaient détruit la planète.
Moi, permettez-moi de vous dire ceci: mon modèle écologique, c’est ma mère.
Ma mère, ce n’est pas Greta. C’est Mimouna.
C’est une femme marocaine, musulmane, analphabète mais savante. Elle a fait de l’écologie sans le savoir.
Ma mère, qui a élevé six enfants sans gaspiller.
Ma mère, qui a cuisiné pour huit, dix, pour douze, pour quatorze si besoin, toujours dans la dignité, jamais dans l’excès.
Ma mère, qui a récupéré les vêtements de mes grands frères pour m’habiller.
Ma mère, qui a réparé, cousu, lavé, recousu encore.
Ma mère, qui faisait de l’écologie sans jamais l’appeler comme ça.
Ma mère, qui pratiquait la sobriété, la solidarité, la décence, pas par mode, mais par nécessité.
Ma mère, elle a fait de la décroissance avant qu’on invente le mot.
Ma mère, elle a pratiqué l’économie circulaire sans subvention, sans conférence COP, sans ONG.
Ma mère sait que le gaspillage est une ingratitude envers la terre… et envers Allah.
Et qu’on ne vienne pas lui expliquer aujourd’hui, avec un air condescendant de petit écolo bobo, que pour sauver la planète il faut trier ses ordures et rouler à vélo.
Ma mère n’a pas pollué le monde.
Ma mère n’a pas bombardé l’Irak.
Ma mère n’a pas financé des guerres en Afrique.
Ma mère n’a pas participé à la destruction du climat.
Elle a résisté. Elle a soigné. Elle a fait avec peu.
Ma mère est plus écolo que tous les sommets climatiques. Et jamais on ne la consulte. Jamais on ne reconnaît les savoirs des femmes du Sud global.
Alors oui, mon écologie vient d’elle. Elle vient de ces femmes racialisées, musulmanes, modestes, invisibles, qui depuis toujours pratiquent une écologie du soin et du partage.
Que peut l’écologie décoloniale ? Une proposition radicale
Alors… que peut l’écologie décoloniale ? Que peut-elle face à un monde ravagé par l’extractivisme, le racisme et la dépossession ?
D’abord, elle peut nommer le système: capitalisme, impérialisme, patriarcat, suprématie blanche.
Elle peut raconter une autre histoire. Elle peut rappeler que les savoirs écologiques n’ont pas été inventés à Paris ou à Genève. Que les peuples indigènes, africains, asiatiques, arabes ont toujours vécu dans des rapports de soin, d’interdépendance et de respect avec leur environnement. Que les ancêtres savaient. Et que ces savoirs ont été piétinés, moqués, exterminés.
Ensuite, l’écologie décoloniale peut refuser le monopole occidental sur la définition du vivant, de la nature, du progrès. Elle peut dire que la forêt n’est pas seulement du bois. Que la terre n’est pas qu’un support pour construire. Que l’eau est une mémoire. Que les humains ne sont pas au sommet de la pyramide mais au milieu d’un réseau de relations vivantes.
Elle peut refuser l’hypocrisie verte qui propose des voitures électriques pendant qu’elle explose des montagnes pour extraire du lithium.
Elle peut refuser les fausses solutions: l’écologie technocratique, les marchés carbone, les «compensations» climatiques…
Tout ça, c’est du greenwashing. Une manière de perpétuer la domination sous une nouvelle forme.
L’écologie décoloniale peut également construire des alliances entre les luttes: entre les peuples du Sud global et les quartiers populaires du Nord. Entre les femmes qui défendent leurs terres et celles qui défendent leurs corps. Entre les exilé·es climatiques et les sans-papiers. Car toutes ces luttes ont une racine commune : la volonté de se réapproprier la dignité, la souveraineté et le droit à la vie.
Enfin, l’écologie décoloniale peut nous obliger à choisir. Car, nous sommes à un carrefour. Soit nous continuons sur cette voie mortifère, soit nous prenons au sérieux ce que les ancêtres, la terre et les peuples opprimés nous disent: «Assez.»
Et dans cette bifurcation, ce sont les luttes des peuples qui nous montrent le chemin. Les zadistes, les zapatistes, les paysan·nes sans terre, les défenseur·ses de l’eau, les résistances afrodescendantes, les jeunes de Gaza, les bergers touaregs, les mères de Soweto ou d’Anderlecht, les femmes qui cuisinent sans gaspiller. Des enfants qui partagent leur assiette. Des migrants qui apprennent à faire avec peu, sans renoncer à leur dignité.… c’est dans leurs gestes, dans leurs récits, dans leurs chants que réside l’écologie de demain.
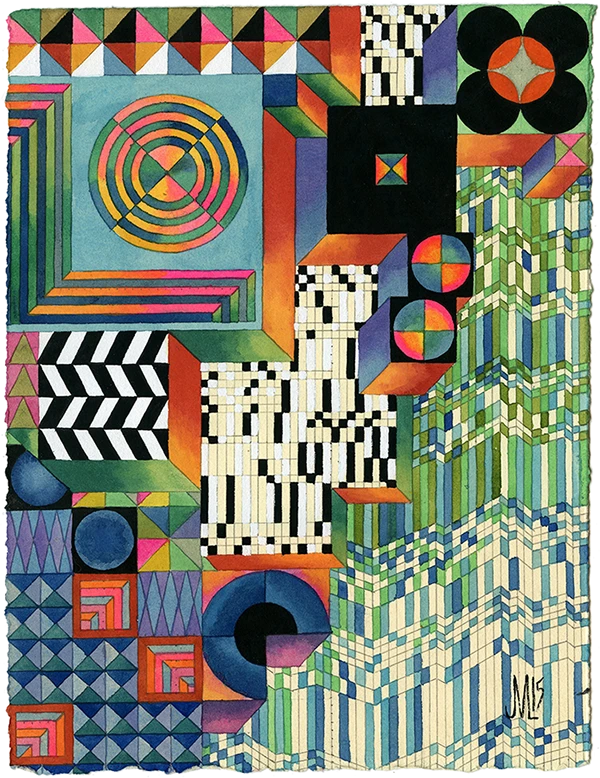
Conclusion: L’écologie comme devoir de mémoire et d’avenir
Ce monde ne s’effondre pas.
Il est déjà tombé pour les peuples du Sud global.
Gaza est en ruine. Haïti est affamée. Le Sahel est désertifié.
Alors oui, le dérèglement climatique est la vengeance des ancêtres.
Pas au sens d’une colère divine, mais comme une mémoire géologique des violences coloniales.
Le climat nous dit ce que nous n’avons pas voulu entendre.
Il nous rappelle que les crimes contre les peuples sont aussi des crimes contre la Terre.
Mais cette vengeance n’est pas irrémédiable.
Mais il y a encore des femmes qui cultivent.
Des jeunes qui luttent.
Des anciens qui transmettent.
Des mères qui partagent.
Cette vengeance peut devenir une renaissance si nous savons l’écouter.
Si nous renonçons à la domination.
Si nous revalorisons les savoirs autochtones, les solidarités populaires, les pratiques de soin, de partage, de sobriété joyeuse.
L’écologie décoloniale ne promet pas un retour en arrière.
Alors la question n’est plus: «Comment sauver la planète ?»
Mais: «Comment se sauver de ce système qui tue les vivants depuis 500 ans ?»
Et dans cette libération, nos mères, nos ancêtres, nos spiritualités, nos luttes sont nos guides.
L’intervention de Nordine Saïdi, lors de l’université d’été du QG décolonial, a été captée grâce à Paroles D’Honneur, elle est disponible sur leur chaîne YouTube avec le lien suivant : https://youtu.be/689zpbVscjo?si=Xs-N8QhjlcS8PhY4
Les images sont tirées de l’oeuvre de Jacob van Loon.

