23 Nov Une drôle de fin de scission: le travail de l’école à la maison
Par ÉLOI HALLORAN et CAMILLE TREMBLAY-FOURNIER
Publié le 23 novembre 2020
C’est pas clair si c’est parce qu’on est capable de nommer pas mal tout le monde qui fréquente le cégep ou si c’est notre condition insulaire qui a fait bouger les étudiant·e·s. On les connaît depuis le primaire les personnes anxieuses, celles qui vivent des situations difficiles, celles qui ont besoin de services adaptés. On ne peut pas faire comme si tout allait bien aller quand les collègues de classe habitent dans le canton voisin et quand on se croise entre étudiant·e·s à tout bout de champ à la crèmerie. Quand on nous a annoncé une reprise des cours à distance, on ne pouvait pas juste rien faire. — Étudiant·e·s du campus des Îles-de-la-Madeleine1

Plus que jamais, les étudiant·e·s travaillent pour leur cégep ou leur université: non plus à l’école, mais pour l’école. Avec l’annonce d’une autre session en ligne l’hiver prochain, c’est bel et bien de nouvelles conditions de travail étudiant qui s’imposent. Sous l’état d’urgence sanitaire, il devient plus évident que l’éducation est d’abord un travail avant d’être un lieu ou un milieu. L’école est fermée, mais elle continue de faire travailler. Dans ce contexte, les établissements d’éducation postsecondaire sont renvoyés à leur fonction d’organisation du travail étudiant, qui ne peut plus passer par les structures physiques qui l’ont toujours servi. Les campus sont majoritairement troqués pour la ou les pièces de la maison disponibles pour travailler. Les salles de classe sont transformées en une multitude de plateformes numériques auxquelles les étudiant·e·s se connectent en différé ou en direct.
Même si elle était prévisible, l’imposition d’une poursuite du travail en pleine pandémie, au printemps dernier, avait quelque chose d’étrangement dystopique. Un drôle de scénario que l’État a pourtant imposé sans trop hésiter. Alors qu’on répétait sans arrêt que la vie changeait et qu’un peu partout des vies s’éteignaient, nos vies, elles, ne faisaient que se renouveler dans leurs pires aspects. La dystopie ne marquait pas une rupture, mais une poursuite2. Bien sûr, on ne pouvait tout simplement pas se permettre de retarder des cohortes complètes de futures marchandises forces de travail: on devait continuer à travailler pour l’école. Il y aurait tout de même eu la possibilité que les sessions soient largement validées, même si incomplètes, comme l’ont fait quelques rares universités hors-Montréal. Certaines associations étudiantes ont ainsi investi beaucoup d’espoir et de temps dans la négociation de cette validation avec les administrations scolaires, mais sans grand succès. La tâche n’était pas simple: le ministère de l’Éducation a restreint les possibilités de validation des sessions.
Avec le recul, il semble clair que seule l’organisation d’un rapport de force aurait pu permettre aux étudiant·e·s de se saisir des modalités du retour au travail, voire d’affirmer un refus de reprise dans de telles conditions. Bien sûr, les mesures de confinement ont été une source de désarroi et d’anxiété pour plusieurs, ce qui a grandement complexifié les possibilités d’organisation. Ce n’est pourtant pas tout: il y a eu les vagues de grève des loyers, les importantes mobilisations antiracistes aux États-Unis suite à l’assassinat de George Floyd, les mobilisations de femmes en Pologne pour le droit à l’avortement… Dès les débuts de la pandémie, plusieurs mouvements ont réussi à prendre forme à travers le monde, malgré l’état d’urgence sanitaire et le virus. Si difficultés de politiser les conditions du travail étudiant en confinement il y a eu, elles ont moins reposé sur le contexte de crise que sur les structures traditionnelles et les conceptions de l’éducation du mouvement étudiant. Le caractère représentatif — et bien souvent nationaliste — des premières a limité les moyens et les possibilités d’organisation autonome et locale des étudiant·e·s. Les secondes, qui posent l’éducation comme un service à recevoir, n’ont pas permis une rupture avec le plan de l’État pour la poursuite du travail. Au contraire, la mise en ligne de l’éducation postsecondaire semble avoir renforcé l’emprise du travail sur les étudiant·e·s: au point où toute alternative devient difficile à penser. Une exception s’est toutefois dressée, au printemps dernier, à 200 kilomètres au large des frontières du Québec, en territoire acadien. Les cégepien·ne·s du campus des Îles-de-la-Madeleine sont parmi les rares étudiant·e·s qui se sont mobilisé·e·s contre le plan de relance en ligne de la session d’hiver 2020.
Les sessions se suivent et se ressemblent

Rien de nouveau sous l’état d’urgence sanitaire
Dans le contexte de pandémie, les structures physiques de l’éducation postsecondaire sont plus ou moins complètement remplacées par des structures numériques. Bien que cette tendance précède le contexte actuel, la mise en ligne de l’éducation postsecondaire repose maintenant presque exclusivement sur le domicile étudiant comme nouvel espace de travail. Le numérique passe ainsi d’une médiation du travail étudiant entre l’école et la maison à sa domiciliation presque complète3. Tout cela est médié par leurs connexions Wi-Fi, que les étudiant·e·s partagent bien souvent avec leur famille ou leurs colocataires, comme iels partageaient autrefois les chemins menant à leurs salles de classe. L’imposition du domicile comme milieu de travail devient la condition sine qua non de la mise en ligne de l’éducation postsecondaire. Étudier en ligne, c’est travailler à la maison.
Alors même qu’elle impose encore plus de travail aux étudiant·e·s, cette domiciliation de l’éducation postsecondaire complexifie la reconnaissance de leur activité en tant que travail. Comme toutes les formes de travail non rémunéré qui participent à la reproduction des individus en tant que force de travail, l’éducation postsecondaire n’est pas considérée comme un travail à part entière. C’est la prise de conscience du déroulement de ces activités au sein de la continuité sociale qui lie le bureau et l’usine au domicile, en passant par l’école et plus encore, qui permet de les politiser comme travail de reproduction sociale4. Le confinement de plusieurs activités de l’usine sociale au sein du domicile rend difficile cette politisation. Travailler à la maison, sans salaire, veut toujours dire ne jamais travailler pour de vrai.
Le télétravail tend effectivement à consolider l’idée selon laquelle le temps d’études n’est pas un temps de travail. En fait, c’est l’ensemble de notre temps qui s’accélère, s’allonge, se liquidifie et s’opacifie au point où la frontière entre le travail et le non-travail devient de plus en plus floue. Loin de signifier la fin du travail, cette aliénation de notre rapport au temps semble plutôt engager l’ensemble des activités humaines dans un processus de travaillisation5. Alors, quand la vie toute entière tend à devenir travail, il est difficile de nommer un travail un travail et, plus encore, de se nommer comme force de travail.
Tout cela n’est toutefois pas réductible au contexte pandémique. Ces tendances s’inscrivent dans les initiatives sans cesse répétées de recomposition du processus d’accumulation capitaliste face aux multiples crises de ce monde6. Et, comme toujours, la reproduction sociale suit tant bien que mal le pas de ce capital recomposé. Il ne s’agit donc pas de critiquer l’éducation postsecondaire à domicile, en ligne ou en pandémie, mais en tant que telle. Sa domiciliation numérique incarne la réalisation contemporaine de sa fonction dans le capitalisme: reproduire les êtres humains en tant que travailleur·euse·s. L’imposition du domicile et de technologies numériques dans l’éducation postsecondaire renvoie au rôle de ces lieux et moyens de production dans l’organisation du travail par le capital7. Comme ce rôle augmente avec la pandémie, l’imposition s’accélère: rien de nouveau sous l’état d’urgence sanitaire.
La maison qui rend travailleur·euse
Avec la mise en place d’un confinement par l’État de mars à mai, ainsi que son retour en octobre dans plusieurs régions, on pourrait croire que l’imposition du domicile comme lieu de travail se soit généralement bien déroulée. Tout le monde devait bel et bien rester « chez soi » pour limiter la propagation du virus. Or, la définition de ce qu’est une « maison » appartenait à l’État et, dans le cas des étudiant·e·s, aux établissements d’éducation postsecondaire. C’est ainsi que plusieurs cégeps et universités ont expulsé les personnes qui logeaient dans leurs résidences étudiantes pour des raisons « sanitaires ». Même dans son rôle de propriétaire de logements, l’école n’était plus un lieu — et encore moins un domicile. Comme la plupart de ces étudiant·e·s ne venaient pas de leur ville d’étude, iels ont dû retourner à la « maison », intégrer le logement d’un·e (petit·e) ami·e, se louer une nouvelle chambre à soi ou, dans certains cas, tout simplement retourner dans leur pays d’origine. En phase avec la rhétorique étatique, le domicile devenait pour ces personnes synonyme de classe, de famille, de monogamie, de nationalité, de responsabilité individuelle et, surtout, de travail.
C’est comme si pour l’État, l’école s’était tout simplement dématérialisée dans les réseaux qui se substituent à ses structures physiques. Cette logique voile la nécessaire matérialité de l’école, qui s’incarne toujours dans un lieu, des moyens et un travail. Si les établissements d’éducation postsecondaire peuvent s’engager dans cette perspective, c’est précisément parce que le gros de la charge matérielle de l’école a été externalisée auprès des étudiant·e·s. Sans cette imposition, le travail étudiant ne pouvait tout simplement pas continuer — et il le devait. Comme toutes les activités pour lesquelles c’était possible, c’est en ligne, à partir de la maison, que ça allait se passer.
Et pour maintenir leur matérialité malgré le confinement, les cégeps et les universités ont brusquement multiplié leurs communications en tous genres. Du jour au lendemain, les boîtes de réception se sont mises à se remplir et les notifications à s’accumuler à un débit beaucoup plus important que la normale. Chacune des pièces de la maison devenait un potentiel espace de travail, où l’on aurait potentiellement à recevoir ou à envoyer une quelconque information. Ce flux de courriels et de notifications nous informait tout autant sur les décisions du ministre Roberge en matière d’éducation supérieure, sur des astuces pour préserver sa santé mentale en contexte de télétravail ou encore sur les décisions administratives des modalités de poursuite des sessions. Être informé·e revenait donc à comprendre pourquoi et surtout comment on allait continuer à travailler à domicile, sans avoir de pouvoir sur le processus. Devant cette masse d’informations, l’idée même de refuser le travail et de remettre en question les modalités de poursuite devenait impensable. Dans un contexte de solitude et d’isolement des collègues de travail, il était plus complexe d’organiser une discussion fluide sur ce qui était imposé ou proposé, voire même de distinguer l’imposition de la proposition8.
Beaucoup de professeur·e·s ont d’ailleurs adapté le contenu de leurs cours au contexte d’urgence sanitaire ou, minimalement, aux deux semaines de « pause » du début de la pandémie. Cette adaptation n’a toutefois pas nécessairement été synonyme d’une réduction de la charge de travail des étudiant·e·s. Dans certains cas, les professeur·e·s ont cessé de donner des cours magistraux, ce qui a transféré une bonne partie de la charge de travail pédagogique aux étudiant·e·s, qui ont dû apprendre la matière à coups de documents Word, de textes en format PDF et de présentations Powerpoint. Il ne semble pas avoir été question d’annuler les évaluations: elles étaient nécessaires pour sanctionner les apprentissages et rendre visible le travail étudiant. Au cégep et à l’université, c’est souvent les évaluations, dont la figure emblématique de l’examen final, qui disciplinent les étudiant·e·s à se mettre au travail9. Cette logique se prolonge à domicile et en ligne par plusieurs méthodes et technologies de surveillance. Lors de certains examens, le travail étudiant est observé et, parfois, chronométré par les professeur·e·s. De même, plusieurs plateformes numériques utilisées par les cégeps et les universités permettent de retracer toutes les interactions des étudiant·e·s par leur intermédiaire. Les professeur·e·s peuvent ainsi savoir quand, à la seconde près, les étudiant·e·s remettent leurs travaux et terminent leurs examens, mais également s’iels ont lu les messages du forum de la classe, consulté les lectures obligatoires du cours ou pris connaissance des modalités d’évaluation des examens et des travaux. Qu’iels soient surveillé·e·s par un algorithme, une caméra ou une paire de yeux, les étudiant·e·s sont bel et bien les sujets d’un contrôle accru et d’une discipline accélérée.
Loin de s’être dématérialisée, l’école a trouvé une nouvelle forme matérielle dans le domicile étudiant, où elle s’est immiscée un peu partout, sans trop prévenir. L’école à la maison a pris la forme d’un flux incessant d’informations et d’une surveillance presque constante, qui se sont incarnés en un contrôle de la vie des étudiant·e·s à domicile et en une discipline du travail à tout prix. Les établissements d’éducation postsecondaire en sont ainsi venus à incarner un panoptique diffus, qui s’installe graduellement chez les étudiant·e·s.
On ne voit bien qu’en crise, l’essentiel y est visible
Ce plan d’imposition d’une poursuite du travail étudiant à domicile et en ligne était d’ailleurs explicite dès les premiers moments de la pandémie, en mars, alors que l’éducation postsecondaire était déclarée « service essentiel ». Comme des milliers de travailleur·euse·s précaires et sous-payé·e·s, les étudiant·e·s ont été contraint·e·s par l’État de continuer à travailler en pleine pandémie. En plus de former une bonne partie de cette force de travail jugée « essentielle » qui tenaient fonctionnelles les épiceries, les pharmacies, mais aussi les hôpitaux et les CHSLD, les étudiant·e·s devaient continuer à travailler à domicile pour l’école et, dans certains cas, pour une troisième journée de travail auprès des enfants, des familles et des conjoint·e·s. Ce partage entre travail rémunéré et non rémunéré s’est complexifié alors que l’État cherchait à combler les trous en éducation et en santé par des étudiant·e·s déjà aux études. Ce n’est donc pas seulement le travail étudiant qui a démontré sa valeur en contexte de pandémie, mais les vies toutes entières des étudiant·e·s comme potentielles forces de travail.
Il est encore plus dystopique de voir apparaître le caractère essentiel de ces vies sous l’état d’urgence sanitaire, alors qu’en temps « normal », l’activité des étudiant·e·s est le plus souvent présentée comme un choix, un investissement ou un privilège. Or, se révéler essentiel en pleine pandémie, c’est sans aucun doute se révéler comme travail. La vraie dystopie, c’est celle où l’on travaille sans cesse à faire tenir un monde qui ne reconnaît pas ce qui le maintient en place. Même si on ne les a pas nommé·e·s comme tel·le·s, les étudiant·e·s étaient bel et bien de ces travailleur·euse·s essentiel·le·s à qui on a imposé une poursuite du travail, et, pour certain·e·s, à la fois en tant qu’étudiant·e·s et travailleur·euse·s salarié·e·s.
La maison — quartier général de la reproduction sociale — s’est révélée être l’espace par excellence de relocalisation de ces multiples formes de travail. En plus, l’anxiété, la fatigue, le stress, le surtravail et tous les impacts du travail sur la vie des étudiant·e·s, qui ont pour la plupart été accentués sous l’état d’urgence sanitaire, pouvaient continuer à être traitées comme des problèmes individuels et non comme des conditions de travail. C’est encore plus facile de dépolitiser l’anxiété quand elle s’exprime à domicile ou d’individualiser la fatigue quand elle est entraînée par une suite sans fin de réunions Zoom avec les ami·e·s, les boss, les collègues et les profs. Encore plus difficile de politiser le surtravail quand on travaille tout le temps sans travailler pour de vrai, sans être payé·e pour ce que l’on fait. Travailler pour vivre une vie de travail, c’est ce qui arrive quand toute la société tend à fonctionner sur le mode du capital: la pandémie n’a pas changé grand chose à cela. L’état d’urgence sanitaire a tout de même mis à mal la scission que l’on fait normalement entre les différentes étapes de la chaîne de montage de l’usine sociale, en démontrant qu’elle fonctionne plutôt comme un tout à contrôler et discipliner10. Le revers de cette fin de scission, c’est la dystopie d’une extrême travaillisation de nos vies au sein d’un domicile qui en vient à prendre la forme d’un enchaînement presque sans fin de (télé)travail (non-)rémunéré.
La grève des Îles ou: quand la fin de session ne justifie pas les moyens
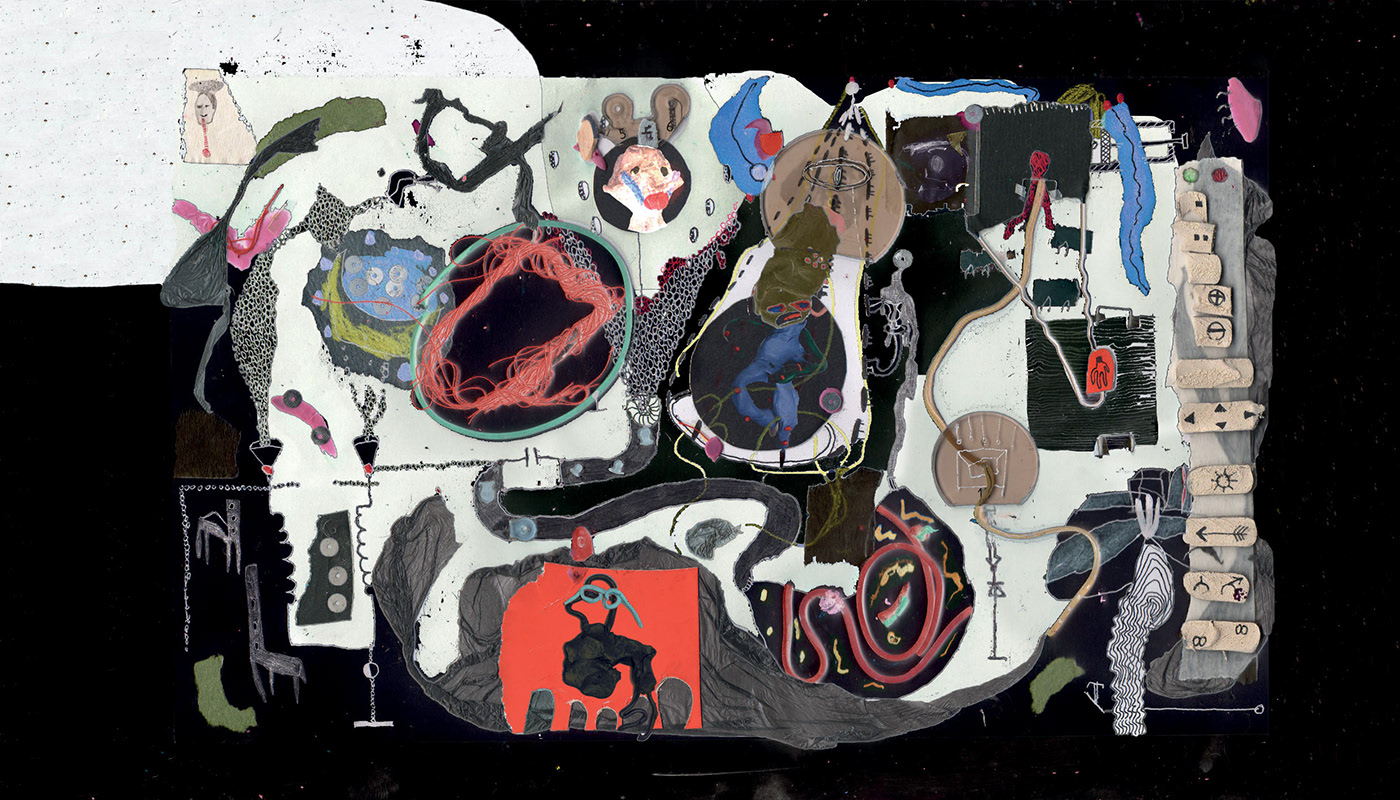
« T’as pas l’tchoeur d’aller voir la chronologie de la mobilisation sur notre groupe Facebook »
Une expression commune veut qu’« aux Îles, ce n’est pas pareil ». Sans affiliation nationale, avec peu de contact avec les autres associations étudiantes, les étudiant·e·s du campus des Îles de la Madeleine ne se sont pas tout de suite rendu compte qu’il n’y avait pas vraiment d’autres groupes étudiants qui s’organisaient pour résister à la poursuite des cours à domicile. Mais ce n’est pas quelque chose qui habituellement tracasse les habitant·e·s de l’archipel madelinot de faire bande à part.
Il faut dire que les étudiant·e·s des Îles ont eu une drôle de relation avec le confinement. Déjà isolé·e·s de la grande terre, les étudiant·e·s se sont retrouvé·e·s isolé·e·s dans leurs chambres de la maison familiale, avec pratiquement aucun cas de contagion sur l’archipel. Lors de la première semaine de pause, beaucoup ont passé leurs soirées au téléphone, à prendre des nouvelles de tout un chacun·e. L’anxiété était évidente, le stress devant l’inconnu palpable. Tout le monde était dans un drôle de mood. On avait le sentiment que l’école allait peut-être fermer pour de bon et qu’il y aurait beaucoup de temps pour penser à la suite. Si la société arrête de tourner un instant, l’école peut bien s’arrêter un peu aussi.
À ce moment, il n’y avait pas de nouvelles de la part des directions, les professeur·e·s ne savaient pas grand-chose et le ministre de l’Éducation demeurait évasif. De part et d’autre, on ne savait pas trop quoi faire, parce que l’autre non plus ne savait pas quoi faire. Les cours sont ainsi bien annulés pour deux semaines, mais on conseille fortement de continuer à avancer dans les travaux, de faire les lectures et, surtout, de lire les courriels. On comprend, entre les lignes, qu’il est fort probable que la session reprenne au bout des deux semaines, qui finissent par passer.
Comme plusieurs des jobs étudiantes, le cégep a été déclaré «service essentiel». L’association étudiante a fait un sondage pour savoir quelles étaient les préoccupations de la population étudiante. Les résultats sont tombés; c’était pas mal certain qu’on allait perdre des collègues pendant cette pandémie, collègues qui abandonneraient les études. Selon le sondage, dans un campus d’environ 130 personnes, il y en aurait au moins cinq. Cinq, c’est déjà trop. Il fallait créer un moment pour que tout le monde se parle, ensemble. Un genre de mobilisation de l’anxiété pour sortir de la paralysie.
Et les étudiant·e·s en ont long à dire. On note en tout deux pages de tours de parole. Il y a eu plus de 60 personnes connectées pour la première assemblée générale virtuelle. Ça, c’est environ la moitié des étudiant·e·s du cégep. Pour assister à l’assemblée générale, il y a des étudiant·e·s parké·e·s dans le stationnement du Tim Hortons pour capter un meilleur signal internet. Il y a des étudiant·e·s dans le sous-sol de la maison familiale avec leurs frères et sœurs. Il y a les employé·e·s des épiceries Coop et des pharmacies, qui participent avec leur téléphone, pendant leur pause. La connexion lâche à tout bout de champ. « Attends là, j’ai machine au téléphone. Je vais vous poser sa question ». Les assemblées générales sur Zoom sont devenues, en le temps de le dire, un happening: le social de la semaine.
Un petit groupe d’étudiant·e·s avait préparé pour l’assemblée générale une longue liste des inquiétudes concernant la reprise des cours. Deux grands enjeux en ressortaient: les accès inégaux à la technologie et au matériel nécessaires aux cours en ligne et les impacts psychosociaux anticipés — anxiété, dépression, stress, etc. — occasionnés par une reprise en ligne. On entrevoyait de grandes disparités entre les étudiant·e·s en ce qui concerne l’adaptation aux modalités de poursuite. L’assemblée générale vote finalement une position contre la poursuite des cours en ligne, dans la perspective d’une validation de la session. Dans le communiqué de l’association étudiante, la grève n’est pas écartée en cas de poursuite de la session.
Pourquoi les étudiant·e·s n’auraient-iels pas leur mot à dire sur le plan de reprise? Les mesures proposées par le ministre et leur application par les directions du Cégep allaient de toute évidence creuser les inégalités entre les étudiant·e·s. Plusieurs demandes ont été mises de l’avant en ce sens: que les crédits des cours pour lesquels une ou des évaluations ont eu lieu soient reconnus; que le contenu théorique restant de ces cours soit rendu accessible; et que les personnes en situation d’échec ou inscrites à un cours pour lequel aucune évaluation n’a encore été faite aient accès à une évaluation non-obligatoire pour avoir une note ou pour se rattraper.
De manière générale, on demande tout simplement que des mesures équitables et favorables à l’apprentissage et au bien-être de tou·te·s soient mises en place. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, les étudiant·e·s n’ont décidément pas la tête aux études. En plus, des universités du continent avec moins de moyens que celles des grands centres ont décidé de mettre un terme à la session, en attribuant des mentions d’équivalence aux étudiant·e·s. Le cégep ce n’est peut-être pas l’université, mais pourquoi ne pas faire de même au campus des Îles?
La deuxième assemblée générale arrive. Les membres de la direction sont là pour prendre la parole et rassurer les étudiant·e·s, mais leurs accommodements proposés ne semblent pas à la hauteur des défis qu’impliquent une reprise des cours sur l’archipel. Les membres de la direction quittent donc sans promesse d’adhésion au plan de reprise. De la Pointe-aux-Loups, une personne formule une proposition, mais la communication est aussitôt rompue. Une autre personne se lance à la rescousse, mais sa voix résonne comme la détonation d’une bombe. Les problèmes de connexion à l’assemblée générale donnent un avant-goût de ce qui viendra en cas de reprise des cours. C’est donc l’heure du vote de grève. C’est serré, mais la grève d’une semaine passe. Ce sera un moyen pour rendre concrète la position contre la reprise en ligne qui avait été adoptée la semaine précédente. Des étudiant·e·s écrivent une lettre au ministre de l’Éducation et au député de la région, un ancien prof du cégep, pour annoncer le débrayage. On espère que le moyen de pression portera ses fruits.
Il demeure qu’une semaine de grève, c’est court et difficile à tenir à distance. Les professeur·e·s sont divisé·e·s sur la question. Certain·e·s trouvent les demandes étudiantes intéressantes et raisonnables alors que d’autres veulent que la session se poursuive pour éviter un rattrapage en été. Avec la menace d’une autre semaine de grève, les directions ont répété les exigences du ministère: il y aura une poursuite de la session en ligne avec certains accommodements. Même si peu y croyait vraiment, on décida d’accepter le plan du cégep pour voir s’il tiendrait la route. Au pire, on reviendrait en assemblée générale.
Ce n’est pas la fin de session
Personne n’est retourné en assemblée générale. La grève a pris fin. La session a repris son cours. Les étudiant·e·s ont fini leur travail. On ne met pas une grève sur pause. Lorsqu’elle se termine, il n’y a pas de retour en arrière: l’histoire du mouvement étudiant peut en témoigner. Une semaine de pression de plus aurait sûrement permis de faire connaître par delà les frontières de l’archipel la mobilisation en cours et peut-être même enclencher une résistance plus large contre la poursuite des sessions de l’hiver 2020. On pourrait spéculer longtemps sur ce qui aurait pu arriver. Il reste que cette petite grève a eu lieu au campus des Îles, alors que le mouvement étudiant était partout dépassé par les événements, et ce, même dans les campus métropolitains habituellement organisés et combatifs.
Il va de soi que la réalité régionale particulière de ce petit cégep a été partie prenante de cette grève, comme ce fût le cas pour le campus de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en Outaouais lors de la grève des stages en 201911. Or, des campus ne maintiennent pas des grèves en solo simplement parce qu’ils sont hors de Montréal. C’est d’abord par la tenue d’assemblées générales que la grève au campus des Îles s’est organisée. Des étudiant·e·s ont utilisé leur confinement à domicile pour organiser une réponse collective à l’imposition d’une poursuite de la session. Ces étudiant·e·s ont formalisé des moments de discussion afin de se doter d’un moyen de pression. La grève a tenu tant bien que mal, jusqu’à ce qu’elle devienne un peu trop vraie. L’histoire du mouvement étudiant ne nous ment pas là-dessus non plus: la plupart des grèves finissent en queue de poisson. Cet échec laisse toutefois l’impression que la session à terminer n’est pas vraiment une fin de session normale, du moins, pas exactement celle qui était imposée au début.
C’est que la grève n’est pas seulement un moyen de résistance aux attaques de l’État et à la recomposition du capital. Même si elle échoue, la grève reste l’expérience concrète d’une alternative, qui marque les personnes qui la mettent en acte et le milieu où elle se déploie. Les petites grèves autonomes, comme celle du printemps dernier au campus des Îles, ont peut-être encore plus d’impact que ce que l’imaginaire collectif associe habituellement à la grève étudiante. Ancrées dans un espace politique concret et délimité, ces grèves n’ont pas à s’en remettre à une entité plus grande pour prendre forme. Elles permettent de développer une autonomie collective qui s’ancre dans des subjectivités et des temps qui ne relèvent pas nécessairement du nationalisme et de la représentation politique. Ces grèves partent du bas: elles nomment et s’opposent à des foyers particuliers de pouvoir, tout en remettant en question le pouvoir en tant que tel12. Les étudiant·e·s reprennent la parole et créent des dynamiques collectives qui peuvent dépasser ce qui est imposé pour travailler ce qui est possible. La grève implique de se sortir des sujets et des temps dominants pour se constituer un temps de lutte, aussi bref soit-il13. La pandémie rend plus urgente que jamais cette constitution d’autonomies collectives qui, seules, pourront nous sortir du monde que l’état d’urgence sanitaire chercher à reproduire dans ce qu’il a de plus dystopique.
Se donner les moyens d’en finir avec les sessions

Le refus de la mise à domicile et en ligne du travail étudiant ne s’est pas seulement limité à la grève des Îles. Partout, des étudiant·e·s ont abandonné leur session d’hiver 2020: pour garder leur job rémunérée, pour préserver leur santé mentale, pour s’occuper de leurs proches et plus encore (et tout ça, souvent en même temps). Des élèves du secondaire ont préféré annuler ou retarder leur rentrée au cégep cet automne pour continuer à travailler pour un salaire et éviter l’angoisse de se retrouver esseulé·e·s devant leur ordinateur. D’autres étudiant·e·s ont seulement déplacé la place du travail étudiant dans l’exécution de l’ensemble de leur charge de travail: un incomplet temporaire leur a permis de finir leur session au cours de l’été. Toutes ces stratégies de refus ont en commun d’être individuelles. Les personnes qui les ont mises en acte en ont probablement fait les frais à un moment ou un autre. Tou·te·s ces étudiant·e·s ont refusé le travail étudiant tel qu’on leur a imposé. Iels manifestaient un ras-le-bol envers leurs propres conditions: un réel besoin de grève, que seul un rapport de force aurait pu canaliser collectivement.
Il n’en reste pas moins que les établissements d’éducation postsecondaire ont prolongé cette domiciliation et cette mise en ligne du travail étudiant pour l’hiver 2021. Cette prolongation de l’école à la maison exacerbe également les inégalités sociales de classe, de genre, de handicap, de nationalités et de race aux conditions d’études. La fracture numérique précède d’ailleurs la pandémie, qui, en accentuant l’omniprésence de la technologie dans le travail étudiant, a renforcé des inégalités qui datent. Même chose pour la possibilité d’utiliser son domicile comme espace de travail: beaucoup d’étudiant·e·s le faisaient déjà, alors que d’autres dépendaient des structures physiques du cégep ou de l’université pour travailler. À domicile, en ligne, en pandémie ou en personne, les multiples enjeux qui traversent l’éducation postsecondaire ne se limitent pas à une question d’accessibilité.
Cette dernière s’est d’ailleurs peu transformée dans les derniers mois. Les étudiant·e·s doivent encore se reproduire en force de travail par la production de travaux, de stages majoritairement non-rémunérés, qui pour certain·e·s mettent leur santé en danger et, en plus, être évalué·e·s pour tout cela. Ce sont plutôt les conditions du travail étudiant qui sont affectées par la pandémie: encore plus d’informations, de surveillance et de travail et toujours moins de pouvoir sur leur propre activité. Les établissements d’éducation postsecondaire reconnaîtront d’ailleurs la majorité des différences et des inégalités entre étudiant·e·s dans ce processus avant de les reconnaître comme travailleur·euse·s. Cela impliquerait notamment que les étudiant·e·s soient payé·e·s: se (re)produire comme source de plus-value à extraire ne serait plus une donnée naturelle de la vie. En tant que travailleur·euse·s, les étudiant·e·s pourraient se saisir de leurs conditions de travail, voire du milieu de travail dans son ensemble. Ces salaires pourraient aussi leur permettre de refuser d’autres formes de travail salarié nécessaires à leur survie, tout en réduisant leur endettement. Une telle démarche impliquerait que des êtres humains limitent la travaillisation de leurs vies et se réapproprient leur reproduction sociale.
Bien qu’aliénant, le statut de travailleur·euse est ce qui a permis à beaucoup de personnes de s’en sortir dans les conditions de l’état d’urgence sanitaire. Dans les secteurs où il n’était plus possible de travailler, les salaires des travailleur·euse·s ont été remplacés par une allocation sociale d’urgence. Même lorsque le travail était maintenu à la maison ou en personne, c’est ce statut de travailleur·euse et le salaire qui y correspond qui ont assuré une certaine stabilité à la vie de pandémie. Les personnes qui l’ont vécu plus rough sont d’ailleurs celles qui ont difficilement ou tout simplement pas accès à ce statut: les travailleur·euse·s du sexe qui n’ont pas eu accès à l’assistance sociale d’urgence, les migrant·e·s qui ont perdu leur travail informel ou ont été poussé·e·s à combler les trous en santé, les parents qui ont vu leur charge de travail non rémunéré à la maison se multiplier… Les étudiant·e·s ne sont pas étrangèr·e·s à cette situation où la non-reconnaissance d’une activité comme travail contraint à un horizon de précarité duquel on ne se sort généralement que par plus de travail.
L’affirmation de besoins matériels n’aurait pas seulement permis aux étudiant·e·s de mieux vivre la pandémie et le travail. Refuser les dettes qui nous sont imposées, revendiquer les salaires qui nous sont dû, se saisir des conditions de travail qui sont les nôtres, c’est entamer une transformation de l’éducation postsecondaire et des rapports qui la structurent. C’est reconnaître la reproduction sociale à laquelle on nous contraint, de l’école à la maison, comme quelque chose d’étranger que l’on peut refuser et se réapproprier. La réalisation de ces besoins matériels par un refus collectif à organiser pourrait rendre possible une sortie du plan du capital, qui s’immisce encore et toujours plus dans nos vies. C’est, du moins, commencer à refuser ici et maintenant, avec d’autres, la vie de travail à laquelle nous fait travailler l’école.
Toutes les images sont tirées de l’oeuvre de Katerina Lukina.
NOTES
1. Cet article est inspiré d’entretiens réalisés avec des étudiant·e·s du campus des Îles-de-la-Madeleine à l’été 2020 ainsi que des communiqués de presse produits par l’association étudiante du campus des Îles pendant la mobilisation contre la reprise des cours à l’hiver 2020. ↩
2. Dans Le Réalisme capitaliste, Mark Fisher développe « l’idée généralement répandue que le capitalisme est non seulement le seul système politique et économique viable, mais aussi qu’il est même impossible d’imaginer une alternative cohérente à celui-ci ». Dans ce contexte, même la forme dystopique ne peut plus projeter « l’émergence de nouveaux modes de vie »: le monde qu’elle représente « ressemble davantage à une version extrapolée ou exacerbée du nôtre qu’à une alternative à celui-ci ». Sous le réalisme capitaliste, la dystopie tend à se rattacher « à l’idée que la fin est déjà survenue, la pensée selon laquelle il se pourrait bien que le futur ne promette que réitération et repermutation. » (Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste. N’y a-t-il aucune alternative?, Genève-Paris, Entremonde, 2018, p. 8). ↩
3. Dans un texte publié au début de la pandémie, Camille Espedite et Anna Borrel situent la possibilité de l’imposition du confinement dans la stratégie de domiciliation qui marque le passage progressif des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. Suivant les travaux de Gilles Deleuze sur le sujet, Espedite et Borrel affirment que les espaces clos d’enfermement propres à la discipline, comme l’école, l’hôpital ou l’usine, sont progressivement remplacés par les domiciles, qui seraient les espaces par excellence du contrôle. « Ce serait là, à domicile, que les disciplines, au sein des gouvernementalités libérales, trouveraient leur nouveau point d’appui, en lieu et place des anciens espaces asilaires (de type panoptique). Il n’est pas difficile d’étayer cette hypothèse et de la prolonger jusqu’en 2020. Il n’y a qu’à citer quelques exemples frappants: domiciliation du travail ménager (grâce à l’électro-ménager), domiciliation des loisirs (télévision, jeux vidéos, coaching sportif via Internet, etc.), domiciliation de la socialisation (via les réseaux sociaux, les apps de rencontre qui permettent de se rencontrer et de se retrouver « chez soi », ou même les sites pornographiques), domiciliation du travail et de la formation (via la formation à distance), domiciliation de la consommation (les livraisons à domicile, le commerce en ligne, etc…), et même domiciliation du tourisme (avec, par exemple, la Réalité virtuelle ou encore le développement d’Airbnb qui invite à voyager en se sentant “comme chez soi” dans des appartements aménagés) : tout un pan de processus qui effacent progressivement les espaces collectifs (lieux de travail, écoles, hôtels, hôpitaux, prisons, bordels, bars, etc…) au profit du chez soi (familial ou individuel) et rendent possible voire désirable le confinement général de la population comme moyen efficace de lutte sanitaire. » (Camille Espedite et Anna Borrel, Pouvoir, domicile, mort : à l’ère du Covid-19, lundi.am, 13 avril 2020). Cette perspective mérite d’être liée à la critique du domicile et de la famille mise de l’avant par Sophie Lewis avant et durant la pandémie. En soulignant les formes de domination et de violence qui traversent le foyer nucléaire, Lewis rappelle que ce dernier fonctionne d’abord et avant tout comme espace d’imposition de la discipline capitaliste. (Sophie Lewis, Faire d’un abri une maison, Ouvrage, 7 septembre 2020). Cette coexistence du contrôle et de la discipline au sein du domicile rappelle le caractère dialectique de la transformation du pouvoir prévue par Deleuze et son incorporation à la logique du capitalisme contemporain. ↩
4. Mario Tronti associe cette continuité au « niveau le plus élevé du développement capitaliste », qui donne lieu à une véritable « usine sociale » au sein de laquelle « le rapport social devient un moment du rapport de production, et la société tout entière devient une articulation de la production, à savoir que toute la société vit en fonction de l’usine, et l’usine étend sa domination exclusive sur toute la société. » (Mario Tronti, Ouvriers et capital, Genève, Entremonde, 2016, p. 26). Des féministes marxistes comme Mariarosa Dalla Costa et Selma James ont prolongé le concept pour préciser la centralité du travail non-rémunéré, notamment sous ses formes domestiques et sexuelles, des femmes dans le fonctionnement de l’usine sociale. CITATION. Au-delà du domicile, l’usine sociale se prolonge notamment à l’école, qui est, selon le groupe militant d’École en lutte, un véritable « atelier » de la reproduction de la force de travail: « Pourvoyeuse de la société-usine, l’École est devenue le point de passage obligé de toute la force de travail. Son rôle n’est pas de bichonner les héritiers ; c’est l’entreprise qui fabrique, ventile et stratifie la force de travail. » (L’école en lutte, L’école, atelier de la société-usine, Paris, 3 novembre 1973). Plus récemment, les comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) ont ravivé l’analyse féministe marxiste de l’usine sociale sur le terrain de l’école en organisant un mouvement de grève centré sur la reconnaissance du travail étudiant par des salaires. ↩
5. Développé par Romano Alquati, le concept de travaillisation renvoie au processus par lequel les vies humaines sont entièrement incorporées à la logique de production de valeur du capitalisme et, donc, entièrement mises au travail par le capital. À l’opposé des thèses sur la « fin » du travail dans l’ère « postindustrielle », ce concept insiste sur la continuité des différentes formes de travail au sein et au-delà de l’usine, qui n’est pas dépassée dans le capitalisme contemporain, mais diffusée dans l’ensemble de la société. Gianluca Pittavino introduit ainsi la travaillisation dans une présentation de la trajectoire militante et théorique de Alquati. « Dans le long processus historique de réification des rapports et de chosification des humains, le capitalisme est arrivé à convaincre les travailleur·se·s que l’enjeu de leur implication réciproque se limite à la négociation de la valeur de leur force de travail. Pourtant, Alquati insiste, le capitalisme a toujours exploité entièrement la personne porteuse de cette force (travail domestique, intelligence collective produite dans la coopération, qualités individuelles, affectivité). Ceci est encore plus vrai dans le passage à l’hyper-industrialité où on assiste à une exploitation intensive et à grande échelle de ces aspects (d’où le fait d’insister sur la reproduction) jadis considérés comme étant impossible à aliéner. Le processus du travail devient ainsi « processus actif », dans une mise au travail généralisée à la totalité de la vie humaine. Ce passage ne se résout pas dans une ontologie productiviste (comme c’est le cas dans les derniers ouvrages de Toni Negri), mais plutôt dans la conviction que toute activité humaine est prise dans un processus de « travaillisation » qui date du début de la civilisation capitaliste. Il parvient donc à la formulation de cette catégorie pour rendre compte de la fin de la différenciation entre le travail comme activité séparée et l’activité comme fait humain et social générique : aujourd’hui c’est toute la gamme des facultés et des qualités de la personne qui est exploitée et valorisée pour le capital. » (Gianluca Pittavino, Romano Alquati: de l’opéraïsme aux écrits inédits des années 90, Période, 22 février 2018).↩
6. Au sein des théories opéraïstes, la lutte des classes renvoie à la composition politique du prolétariat au-delà de la composition technique qui est imposée par le capital. Toutefois, comme le souligne Gigi Roggero, il n’y a pas seulement le prolétariat qui se recompose: « Le capital aussi se décompose et recompose continuellement, c’est-à-dire qu’il détruit et qu’il transforme: il appelle cela innovation. Aux mouvements révolutionnaires des années 1960 et 1970, le capital a répondu en premier lieu non pas avec la répression, mais avec l’innovation. L’innovation est une contre-révolution, en vue de renforcer le commandement et l’accumulation du capital. Ce changement porte avec lui le signe partiel de son antagoniste, dépourvu toutefois de la possibilité de rupture, subsumé et plié vers des fins systémiques. » (Davide Gallo Lassere et Gigi Roggero, Par delà opéraïsme et post-opéraïsme, Période, 6 septembre 2018).↩
7. Dès 1973, L’école en lutte fait une critique du rôle de la technologie à l’école qui résonne avec le moment contemporain. « Pour l’école comme pour l’usine, l’utilisation de la technologie n’est pas un produit neutre du « progrès scientifique » : elle obéit à un objectif de contrôle capitaliste sur l’école et son produit. » Ce contrôle vise la délégation aux machines la tâche de transmission des connaissances non pas dans le but d’améliorer leur mémorisation, mais de plier les étudiant.e.s au rythme de la machine, afin de les « préparer au travail partout médié par la machine. » Par machine, L’école en lutte désigne un ensemble de « méthodes audio-visuelles », qui « n’ont pas encore connu une expansion massive », mais qui rappellent drôlement la domiciliation et la mise en ligne de l’éducation postsecondaire dans le moment contemporain. Doublée par « une augmentation sournoise des horaires de travail qu’il s’agit de faire assumer par l’élève lui-même » et par « la dissémination du « lieu scolaire » [qui] visera à isoler les élèves et à éviter un comportement de masse », cette prédiction d’une généralisation des méthodes audio-visuelles était alors seulement une « vision « prospective » des planificateurs du Capital », qui s’est progressivement réalisé jusqu’à aujourd’hui. Selon L’école en lutte, cette introduction des machines dans l’éducation, qui faisait déjà l’objet d’une réforme de l’éducation nationale en 1973, n’est pas un enjeu moral, mais une tentative d’adapter et de contrôler la reproduction sociale dans le moment contemporain. Ces machines renvoient à « la volonté capitaliste de fabriquer dans l’école le type de force de travail de plus en plus nécessaire au développement du Capital. De plus, par l’utilisation capitaliste de la technologie dans l’école, et par l’impossibilité faite à l’élève de choisir son orientation, c’est-à-dire de refuser la place que veut lui assigner le Capital, serait atteint et parachevé le but majeur de la réforme: ôter à l’élève tout pouvoir de contrôle sur la production de lui-même en temps que force de travail. » (L’école en lutte, L’école, atelier de la société-usine, Paris, 3 novembre 1973).↩
8. Dans un entretien de 1987, Gilles Deleuze décrit ainsi le rôle des communications et des informations dans les sociétés de contrôle: « C’est pas très compliqué, tout le monde le sait: une information, c’est un ensemble de mots d’ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censés devoir croire. En d’autres termes: informer c’est faire circuler un mot d’ordre. Les déclarations de police sont dites, à juste titre, des communiqués ; on nous communique de l’information, c’est-à-dire, on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l’on croyait, on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. » Plus loin, Deleuze fait une prédiction sur l’impact du contrôle sur l’école: « Parce que, vous savez, les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d’enfermement. Même l’école, même l’école il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent, ça se développera que dans quarante ou cinquante ans, pour vous expliquer que l’épatant se serait faire en même temps l’école et la profession. Ah…, ça sera très intéressant parce que l’identité de l’école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n’impliquera plus forcément le regroupement d’écoliers dans un milieu d’enfermement. Heu…, ha…, ça pourra se faire tout à fait autrement, cela se fera par Minitel, enfin tout ça heu… tout ce que vous voudrez, l’épatant ce serait les formes de contrôle. » Si l’on précise qu’un Minitel est l’équivalent d’un ordinateur connecté à Internet, l’actualité de cette prédiction ne manque pas de nous frapper. (Gilles Deleuze, Qu’est-ce que l’acte de création ?, Conférence donnée dans le cadre des mardis de la fondation Femis, 17 mai 1987).↩
9. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault souligne le rôle prépondérant de l’examen dans les espaces disciplinaires scolaires: « L’examen combine les techniques de la hiérarchie qui surveille et celles de la sanction qui normalise. Il est un regard normalisateur, une surveillance qui permet de qualifier, de classer et de punir. Il établit sur les individus une visibilité à travers laquelle on les différencie et on les sanctionne. […] De la même façon, l’école devient une sorte d’appareil d’examen ininterrompu qui double sur toute sa longueur l’opération d’enseignement. » Les évaluations comme l’examen appliquent un pouvoir disciplinaire, qui, bien que lui-même invisible, « impose à ceux qu’il soumet un principe de visibilité obligatoire. Dans la discipline, ce sont les sujets qui ont à être vus. Leur éclairage assure l’emprise du pouvoir qui s’exerce sur eux. C’est le fait d’être vu sans cesse, de pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l’individu disciplinaire. Et l’examen, c’est la technique par laquelle le pouvoir au lieu d’émettre les signes de sa puissance, au lieu d’imposer sa marque à ses sujets, capte ceux-ci dans un mécanisme d’objectivation. » (Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 217-218 et p. 220).↩
10. Dès les premiers moments de la pandémie, plusieurs personnes ont souligné l’importance de comprendre la pandémie en tant que crise de la reproduction sociale. Voir Aurore Koechlin, Crise du Covid-19: donner la priorité à la reproduction sur la production, Contretemps, 18 mars 2020; Françoise Vergès, Le travail invisible derrière le confinement. Capitalisme, genre, racialisation et Covid-19, Contretemps, 29 mars 2020; Tithi Bhattacharya, « Le capitalisme privatise la vie et socialise la mort », Contretemps, 26 avril 2020; Valérie Simard, La reproduction ne sera pas télédiffusée, Ouvrage, 24 août 2020; Isabelle Garo, Covid-19 et capitalisme : le triomphe de la biopolitique ?, Contretemps, 2 novembre 2020.↩
11.Lors de la grève des stages de l’hiver 2019, ce campus a été en grève de manière autonome pendant plusieurs semaines, dont la bonne partie en complète autonomie vis-à-vis du reste du mouvement, qui battait de l’aile. Comme le soulignaient des militant.e.s dans un texte de bilan : « Bref, malgré un bilan mitigé de la décentralisation régionale, on doit en partie la concession du gouvernement à mettre en place des bourses pour stagiaires dans de nombreux programmes à l’université, au cégep et dans les écoles de métiers à la ténacité des grévistes en enseignement de Saint-Jérôme. La contribution du CUTE UQO-Saint-Jérôme et l’indépendance des grévistes vis-à-vis de leur association étudiante incarnent particulièrement bien le potentiel de l’autonomie dans l’organisation d’une lutte au sein de laquelle on préfère un mouvement plus petit mais plus dynamique à un mouvement plus spectaculaire en nombre mais centralisé. On parle quand même de la première grève offensive à obtenir des gains importants en quarante ans. » (Stéphanie Gilbert, Éloi Halloran et Etienne Simard, Le mystère de Saint-Jérôme, CUTE Magazine, 6, automne 2019, p. 40-49). ↩
12. Dans un entretien de 1972 avec Gilles Deleuze, Michel Foucault présente une conception du pouvoir qui rappelle les petites grèves étudiantes comme celle du campus des Îles. « Chaque lutte se développe autour d’un foyer particulier de pouvoir (l’un de ces innombrables petits foyers que peuvent être un petit chef, un gardien de HLM, un directeur de prison, un juge, un responsable syndical, un rédacteur en chef de journal). Et si désigner les foyers, les dénoncer, en parler publiquement, c’est une lutte, ce n’est pas parce que personne n’en avait encore conscience, mais c’est parce que prendre la parole à ce sujet, forcer le réseau de l’information institutionnelle, nommer, dire qui a fait quoi, désigner la cible, c’est un premier retournement du pouvoir, c’est un premier pas pour d’autres luttes contre le pouvoir. Si des discours comme ceux, par exemple, des détenus ou des médecins de prison sont des luttes, c’est parce qu’ils confisquent au moins un instant le pouvoir de parler de la prison, actuellement occupé par la seule administration et ses compères réformateurs. » (Gilles Deleuze et Michel Foucault, Les intellectuels et le pouvoir, L’Arc, 49, 1972, p. 3-10). ↩
13. Dans un entretien au début de la pandémie, Jacques Rancière souligne l’importance de la subjectivité et du temps pour la pratique politique. En opposition aux intellectuels de gauche qui font de la critique sans penser son lien avec la pratique, mais aussi avec les pouvoirs des gouvernants, Rancière propose d’incarner la critique à même à la mise en place de contre-sujets et de contre-temps collectifs. « Le résultat est que le discours sur le temps est monopolisé par deux sortes de gens: d’une part, les gouvernants qui gèrent l’urgence selon les concepts et les méthodes bien rodés: crise à affronter, sécurité à assurer, dispersion des rassemblements, etc.; d’autre part, les intellectuels habitués à penser la fin de l’histoire ou celle de l’anthropocène. Ceux-ci nous disent volontiers aujourd’hui que l’épidémie est l’occasion de tout repenser, de renverser la logique capitaliste, de mettre l’humain avant le Capital ou de rendre à la Terre ou à la Planète les droits usurpés par les humains. Ils nous disent que, à la fin de l’épidémie, il va falloir en tirer les leçons et tout changer. Ce qu’ils oublient de nous dire, c’est qui se chargera de « tout changer » et en quel temps cela se passera. Un temps politique se tisse par des pratiques communes qui construisent des emplois du temps et des agendas. Or c’est précisément ce qui manque dans les conditions du confinement. Il n’y a pas de moyen de construire des temporalités qui préparent cet « après » dont tout le monde parle. En conséquence, les analyses qui prétendent répondre à la situation présente et préparer l’avenir sont en fait des analyses qui étaient toutes constituées avant, depuis la théorie de l’état d’exception et la critique de la société de contrôle et du totalitarisme des Big Data jusqu’à la nécessité de repenser de fond en comble les rapports de l’humain et du non-humain. Ce que le confinement révèle plus clairement que jamais c’est cette distribution bien réglée des rôles entre des gouvernants qui ont réduit le temps de la politique à l’urgence et fait de cette urgence leur métier à la petite semaine, et des intellectuels qui placent toute situation dans le temps multiséculaire du Capital ou de l’anthropocène et ne connaissent qu’une seule manière efficace d’y intervenir, à savoir le « retournement » radical de ce temps. Ce face-à-face peut durer indéfiniment. Le cours des choses ne change jamais que par l’action de ceux et celles qui travaillent le temps: ceux et celles qui font vivre quotidiennement nos sociétés en donnant les réponses qu’il faut donner à tout moment ; ceux et celles aussi qui, de temps en temps, envahissent les places, les rues ou les ronds-points pour suspendre l’ordre normal des travaux et des jours et inventer d’autres usages du temps. Tout le reste est imposture. » (Andrea Inzerillo et Jacques Rancière, viralité/immunité: dialogue italo-français pour interroger la crise, Institut français Italia, 2, 20 avril 2020). ↩

